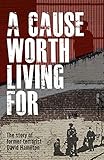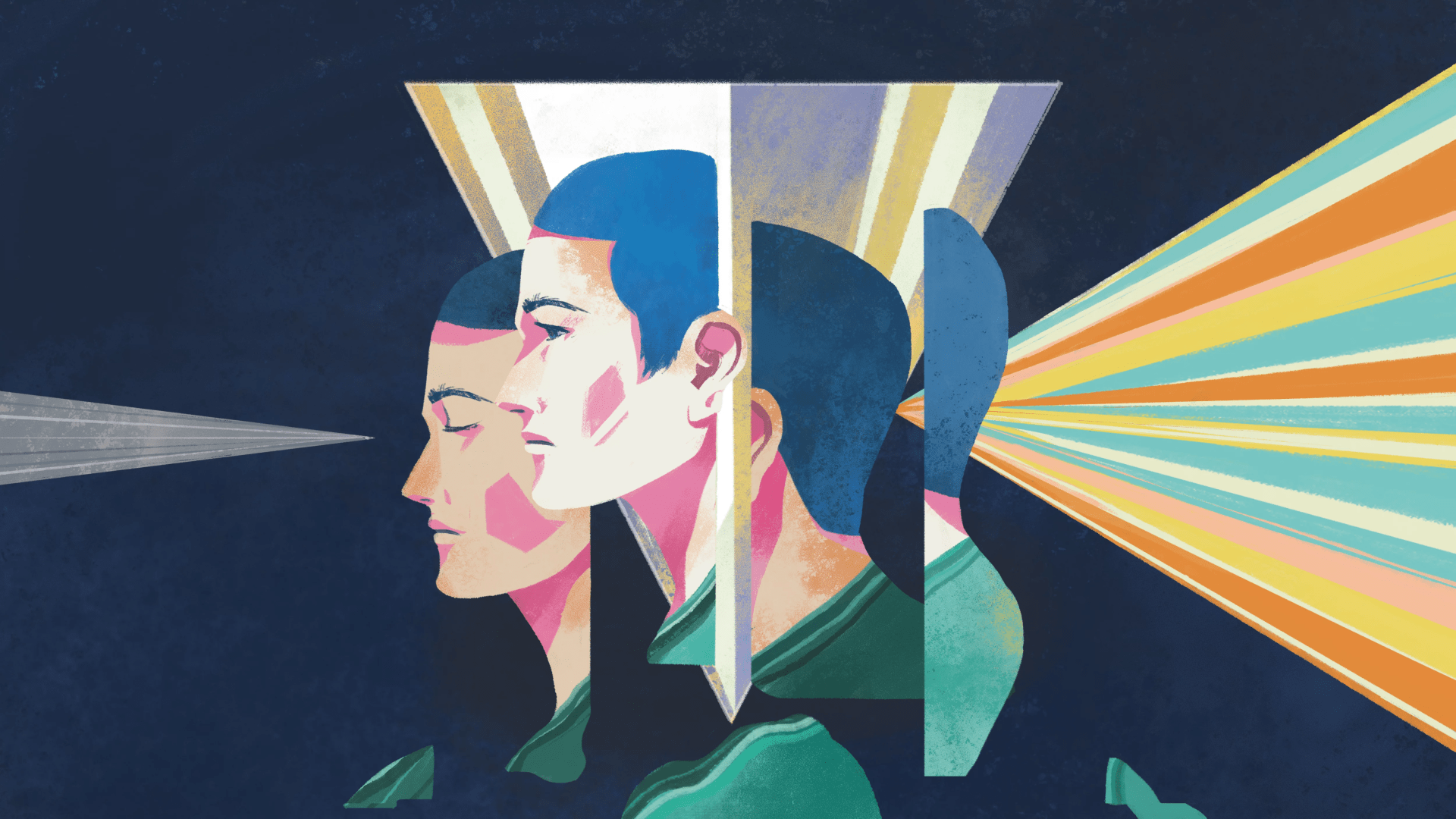J’ai grandi à Belfast, en Irlande du Nord, à une époque de conflits âpres et violents entre protestants et catholiques. Les protestants voulaient que l’Irlande du Nord reste au sein du Royaume-Uni, tandis que les catholiques voulaient unifier l’Irlande en une seule république indépendante.
A Cause Worth Living For: The Story of Former Terrorist David Hamilton
10Publishing
100 pages
$12.99
C’est à 14 ans que j’ai pris conscience pour la première fois des différences politiques entre protestants et catholiques. Ce jour-là, je séchais les cours avec un groupe de garçons, tous catholiques. Nous étions dans un vallon, parmi les arbres, où se trouvait une balançoire de corde attachée à une branche surplombant la rivière. Je me tenais là, à écouter ces garçons catholiques discuter de ce qu’ils allaient me faire. Ils décidèrent de me frapper et me jetèrent dans la rivière.
En sortant de l’eau, j’essayais de comprendre ce que j’avais fait pour mériter ça. Lorsque je leur posai la question, un des garçons me fit cette réponse : ils s’en étaient pris à moi parce que j’étais protestant. Jusque-là, je ne savais pas ce que signifiait être loyaliste ou républicain, pas plus que protestant ou catholique.
Ce jour marqua un tournant dans ma vie, et il me mit sur une voie destructrice. Je décidai que je n’aurais plus jamais d’amis catholiques. Et, encore adolescent, je pris la décision fatidique de devenir terroriste politique en entrant dans une organisation paramilitaire illégale appelée Ulster Volunteer Force (UVF). Je me voyais en militant vertueux luttant pour une juste cause : la loyauté envers la reine et le pays.
Le temps du changement
En tant que membre de l’UVF, j’ai commis plusieurs crimes dont un attentat à la bombe, un braquage de banque et plusieurs autres vols à main armée dont un m’a valu la prison à l’âge de 17 ans. Après ma libération un an plus tard, je me suis à nouveau impliqué, ce qui a abouti à une autre arrestation et à une peine de 12 ans.
J’étais en prison depuis quelques années quand quelque chose d’inhabituel se produisit. J’assistais à un service religieux juste avant Noël. Comme presque tout le monde, je n’étais pas là par conviction religieuse, mais seulement pour avoir l’occasion de sortir de ma cellule, de voir des prisonniers d’autres ailes de la prison et d’échanger de la contrebande et des potins. L’aumônier de la prison demanda tout à coup : « Un volontaire pour lire le passage de la Bible ce matin ? ». Alors que personne ne se manifestait, quelqu’un assis devant moi se retourna et dit : « Davey a dit qu’il le ferait ! ».
Mon premier réflexe fut de nier. Mais je savais que tout le monde se moquerait de moi. Alors je pris la bible et je lus le passage du récit de la Nativité dans l’Évangile de Luc. Quand j’eus fini, je me mis à sourire ! En un sens, ça faisait du bien. J’écrivis même une lettre à ma mère ce soir-là, expliquant ce qui s’était passé. Mais rien ne changea. Noël vint et repartit.
Début janvier, j’eus une autre expérience incroyable. Un soir, peu de temps avant de regagner ma cellule, je m’étais préparé une tasse de thé. Puis, une fois à l’intérieur, je remarquai un petit morceau de papier plié posé sur l’oreiller : un tract évangélique intitulé « Jésus-Christ revient bientôt ». Cela m’amusa. J’en fis une boulette pour la jeter par la fenêtre.
Mais une pensée soudaine me vint à l’esprit : « Il est temps pour toi de changer, de devenir chrétien ». C’était surprenant. Mais quelques instants plus tard, la pensée me revint à l’esprit.
Au début, j’en ris, pensant que Dieu ne s’intéresserait jamais à quelqu’un comme moi. J’étais un homme mauvais, coupable de bien des méfaits. L’UVF avait tué beaucoup de gens. Certains de mes amis étaient des meurtriers. Heureusement, je n’avais pris la vie de personne, mais ce n’était pas faute d’avoir essayé.
Je me ressaisis, quittant mes pensées pour revenir à la réalité, et posai ma tasse sur l’étagère, à côté d’une bible Gédéon. (Chaque prisonnier en gardait une dans sa cellule, non pas pour la lire, mais comme réserve de papier à cigarette.) Je feuilletai les pages par curiosité, lisant quelques lignes ici et là. N’y comprenant rien, je la remis sur l’étagère. Quelques minutes plus tard, j’essayai de lire une nouvelle fois. Cela n’avait toujours aucun sens pour moi.
Allongé sur mon lit, je pensais à ces moments où j’avais côtoyé la mort. Comme la nuit où l’Armée républicaine d’Irlande tenta de me tuer alors que j’étais au restaurant avec ma fiancée. Ou la fois où je posai une bombe qui explosa prématurément avant que je ne quitte le bâtiment. Bien que ma veste fût en lambeaux, je survécus sans une égratignure. Ou quand, dans la rue, quelqu’un posa un pistolet sur ma tempe et appuya sur la gâchette, et que le pistolet s’enrailla.
Peu de gens survivent pour raconter de telles histoires alors pourquoi étais-je encore en vie ? Soudain, une pensée me traversa l’esprit : « C’est Dieu qui m’a gardé en vie ! » Plus j’y réfléchissais, plus j’étais convaincu.
Tout d’un coup, je sus que je voulais devenir chrétien, même si je ne savais pas trop comment. Heureusement, le lendemain matin, je rencontrai le même homme qui avait mis le tract sur mon lit. À ma grande surprise, je me mis à confesser mon désir de devenir chrétien. Je pensais qu’il se moquerait de moi parce que je m’étais tant de fois moqué de lui à cause de sa foi. Au lieu de cela, il me prit simplement dans ses bras. Il me donna aussi plusieurs autres dépliants, de quoi lire pour un mois entier.
L’un des dépliants affichait une simple prière au verso :
Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, viens aujourd’hui dans mon cœur.
Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, viens y faire ta demeure.
Je fis cette prière six fois, juste pour m’assurer que Dieu me prenait au sérieux. Lorsque la porte de la cellule s’ouvrit pour que nous retournions au travail, je décidai d’en parler à la première personne que je verrai. À ma grande consternation, je l’entendis aussitôt crier : « Davey est chrétien maintenant ! Il a rejoint la brigade de Dieu ! »
Quand j’eus repéré l’aumônier de la prison, je criai : « Je suis chrétien maintenant ! ». Il s’arrêta et s’avança. « Quand est-ce arrivé ? », me demanda-t-il. Il m’invita à venir dans son bureau, où il s’assit et sourit pendant que je racontai mon histoire. Quand j’eus terminé, il ouvrit un placard et me donna la première bible que j’aie considérée comme la mienne, un petit nouveau testament Gédéon rouge. Quand il eut prié pour moi, je me sentais fort comme un bœuf.
L’espérance pour les désespérés
À l’époque, je n’avais pas imaginé que quelqu’un d’autre priait en coulisses : la belle-mère de mon oncle, une femme âgée nommée Mme Beggs. Le jour de ma condamnation, alors que ma mère pleurait son fils qu’elle croyait perdu, Mme Beggs secoua la tête et dit : « Si Dieu a pu changer le cœur de John Newton » — le capitaine du navire négrier qui a écrit « Amazing Grace » après sa conversion — « il peut changer le cœur de ton fils. Je prierai pour lui tous les jours. »
En fait, lorsque ma mère lui annonça la bonne nouvelle, Mme Beggs répondit qu’elle le savait déjà, parce que Dieu avait « enlevé le fardeau de son cœur ». Elle ajouta : « Dieu m’a dit que je devais prier pour son futur ministère, car il deviendra serviteur de Dieu ! » Maman pouvait à peine y croire, mais Mme Beggs avait raison.
Après ma libération, j’ai travaillé comme évangéliste pour Prison Fellowship Ministries, dont le fondateur Charles Colson m’avait rendu visite après ma conversion. Cinq ans plus tard, j’ai commencé à voyager à travers l’Europe comme évangéliste itinérant. Pour 12 autres années, je reçus un appel pour devenir pasteur d’une Église en Angleterre, ce que j’ai fait jusqu’à ma retraite. Aujourd’hui, de retour en Irlande, je continue à évangéliser à travers le pays.
Vraiment, il n’y a pas de cas si désespéré que Dieu ne puisse le sauver !
David Hamilton est pasteur à la retraite et vit en Irlande du Nord. Il est l’auteur de A Cause Worth Living For : The Story of Former Terrorist David Hamilton (« Une cause digne que l’on vive pour elle : l’histoire de l’ex-terroriste David Hamilton »).
Traduit par Philippe Kaminski
–