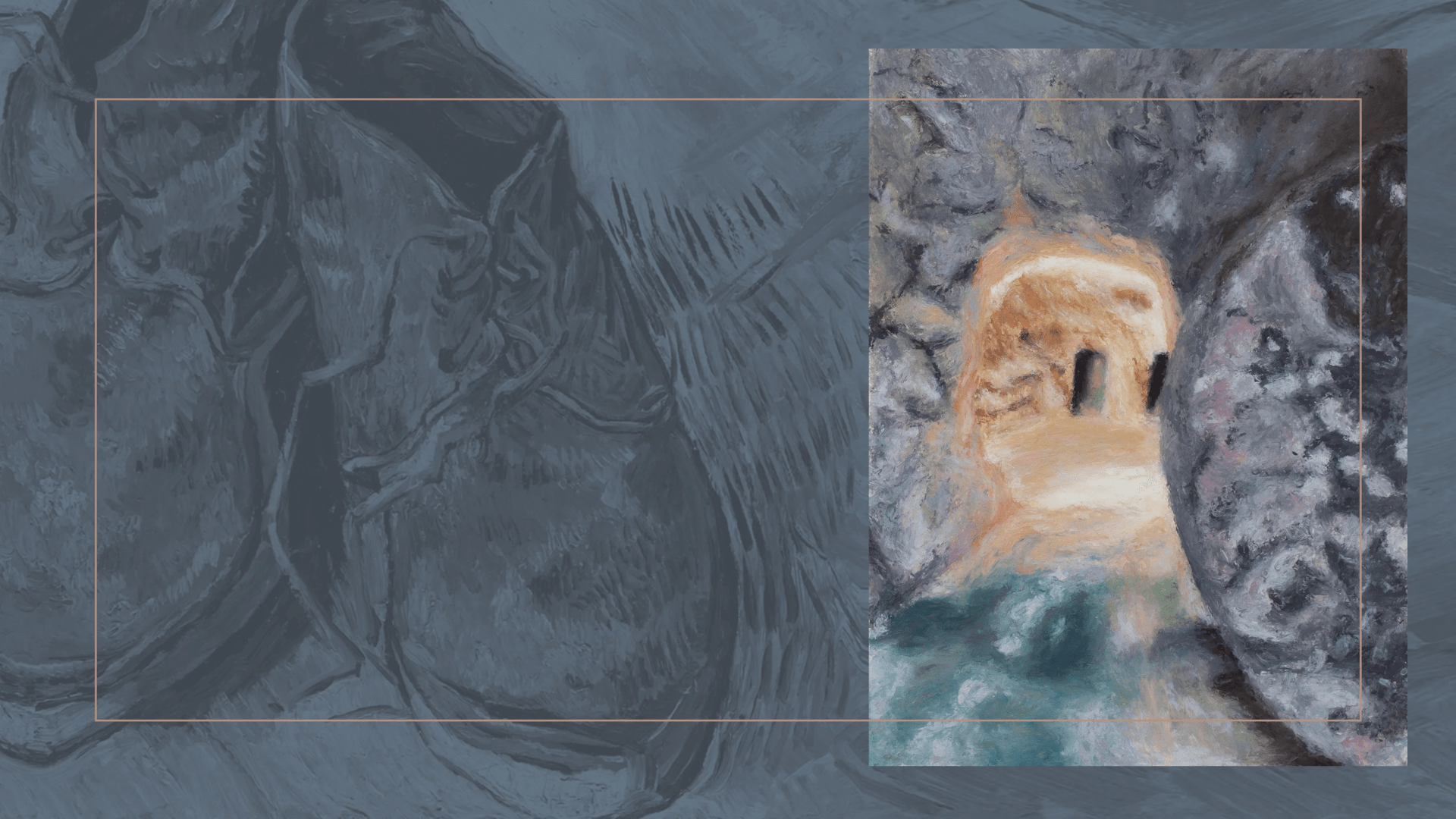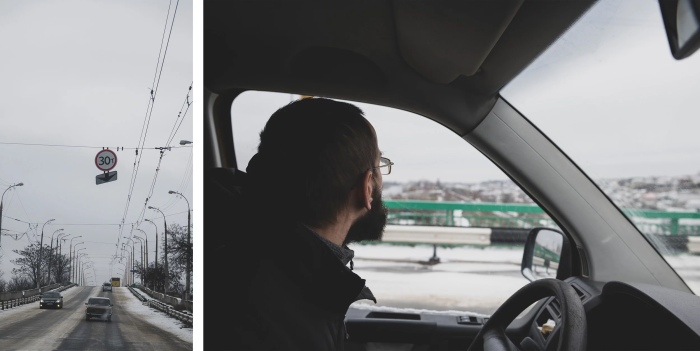Avons-nous gâché notre vie ? Cette question m’assaillit un beau matin, à mon réveil. Une vague de découragement m’avait subitement envahie, telle qu’en connaissent parfois ceux qui œuvrent au service de leur Église, comme en l’occurrence l’épouse de pasteur que je suis.
Mon mari et moi avons plus d’années derrière nous que devant nous dans notre vie d’Église. Cela ne m’attriste pas encore. Les larmes viendront probablement plus tard, lorsque mon mari, Brent, quittera la chaire et délaissera son col clérical. Mais ce matin-là, une question m’assaillait. Que restait-il des trente dernières années, des onze Églises dont nous avions d’une manière ou d’une autre fait partie, de tous les nouveaux départs avec les adieux puis les fêtes de bienvenue ?
Certes, dans notre vie personnelle et au sein de ces communautés, nous avons vécu énormément de belles et bonnes choses. Nous avons été profondément touchés par l’amour de Jésus et par cette chaleur que son peuple répand autour de lui et sur la terre entière, rayonnant de cet amour sans pareil, miracle de l’Église à l’œuvre dans le monde entier.
Au fil des ans, nous avons expérimenté cette chaleur et cette ferveur de mille et une façons : les coups de main pour rénover les maisons, les échanges sur l’art d’être parent, des sorties avec le club de jeunes, les pièces de théâtre, les concerts, les ventes de charité, le secours aux réfugiés, les célébrations du Vendredi saint, les soupes du midi, les délicieuses dindes de Noël, les parcours Alpha sous toutes leurs formes, sans oublier les cultes traditionnels et leurs versions « modernes », autant d’efforts mis en place par souci du bien des communautés dont nous faisions partie.
La plupart du temps, je pense, l’Église offrait son amour sans arrière-pensée. Nos mains ouvertes débordaient et ne demandaient qu’à servir. Mais parfois, sous ce débordement d’amour — du moins pour moi — se cachait un désir subtil de toucher les gens afin que nos Églises puissent être plus grandes, et donc meilleures. Meilleures, et donc plus grandes. Être cette Église que tout le monde connaît. Réussir en termes de créativité, de chiffres, de volume et d’impact. Une Église dont la croissance explose et gagne du terrain.
Ce désir, je m’en repens et je l’abandonne. L’évaluation honnête de nos motivations nous conduit presque toujours à nous repentir. Et je ne suis pas seule à genoux, ici, devant cet autel. Nous sommes nombreux à devoir nous repentir, non pas du désir que l’Église locale croisse, mais du désir de croissance pour la croissance elle-même.
Lors d’un récent petit-déjeuner à l’église, mon regard a été attiré par le collier d’une paroissienne plus âgée. Il était composé de perles en bois sculptées de petits éléphants. On aurait dit que chacun avait été choisi avec soin dans l’étalage d’un artisan sculpteur, en souvenir d’un merveilleux voyage. « Je l’aime beaucoup », ai-je dit à cette dame. « Merci », m’a-t-elle répondu en touchant le bijou. Mais alors qu’elle voulait poursuivre la conversation, elle s’est arrêtée, désemparée.
« Je ne trouve pas le mot », s’excusa-t-elle en tapotant la tête d’un petit éléphant.
« Je peux vous aider ? », ai-je proposé.
« Non, merci », a-t-elle dit. « Je préfère le retrouver moi-même ». Le petit éléphant entre les doigts, la dame fouillait désespérément dans sa mémoire, à la recherche d’un mot perdu. Nous ne parlions plus. J’aurais pu changer de sujet, mais c’eut été un manque de respect. La paroissienne réfléchissait toujours. Les instants passaient. Nous faisions toujours silence. Finalement, on nous a appelées pour manger. Nous nous sommes souri, avons haussé les épaules et avons rejoint la file qui se formait.
Cette conversation pourrait paraître improductive. Elle n’a rien apporté, changé ou réglé de concret. Nous nous sommes séparées et je suis allée chercher des croissants et de la confiture. Techniquement, en termes d’emploi du temps, il aurait paru difficile de parler de succès. Mais dans l’Église, une apparente perte de temps peut se révéler être une œuvre d’amour.
Quelques semaines plus tard, je me tenais au fond de la salle pendant la sainte cène et je regardais les gens aller et venir, comme j’aime le faire. Les fidèles s’approchaient par les allées latérales, puis retournaient à leur place par l’allée centrale, toujours marquée d’une suite de « X » placés au sol, reliquats des anciennes restrictions sanitaires.
Parmi eux, il y avait cette même paroissienne qui retournait à son siège par l’allée centrale. Elle tenait son bout de pain dans la main. Elle le prendrait une fois assise, rare règle que nous avions gardée de l’époque COVID. Derrière elle suivaient des dizaines de paroissiens. Ceux-ci marchaient au ralenti pour éviter de la dépasser. Elle n’était pas pressée. Elle souriait, sans doute inconsciente de la petite foule qui grossissait derrière elle. C’était un défilé très lent. Tout en douceur, la communauté accompagnait cette dame vers sa place. Cela m’a fait chaud au cœur.
Ce tableau que j’avais sous les yeux me montrait notre Église dans sa plus sainte réussite. Notre communauté était tellement belle dans cette marche lente et patiente que lui inspirait l’amour ! Ce cadeau précieux, l’Église locale peut l’offrir à ses propres membres bien-aimés et fragiles, mais aussi, pour l’amour de Jésus, à toutes les personnes qui croisent son chemin.
Chaque année, Pâques nous rappelle tout ce qu’il peut y avoir de merveilleux dans ce que le monde considère comme une perte de temps. Celui qui, aux yeux de tous, semblait être un messie défaillant est en réalité le Messie qui a accompli le plus saint des périples. La mort est vie et le tombeau, vidé de son corps, témoigne de l’accomplissement d’une promesse qui vient tout chambouler. Pâques est le plus flamboyant et le plus subversif des espoirs, tel un paon qui passe sous nos fenêtres lors des derniers soubresauts de l’hiver que nous connaissons chez nous au Canada. Ici, au sein de l’Église, humble et magnifique, la réussite n’a plus rien à voir avec la version qu’en donne le monde.
Pâques a prouvé une fois pour toutes que Jésus se tient à nos côtés dans cette longue, lente et sûre marche qui n’aura peut-être jamais des allures de succès, mais qui sera, pour nous, le plus saint et fidèle des cheminements.
Karen Stiller est l’autrice de The Minister’s Wife: a memoir of faith, doubt, friendship, loneliness, forgiveness and more, et rédactrice en chef du magazine Faith Today.
Cet article fait partie de notre série « À l’aube d’une vie nouvelle » qui vous propose des articles et des réflexions bibliques sur la signification de la mort et de la résurrection de Jésus pour aujourd’hui.
Traduit par Anne Haumont
–