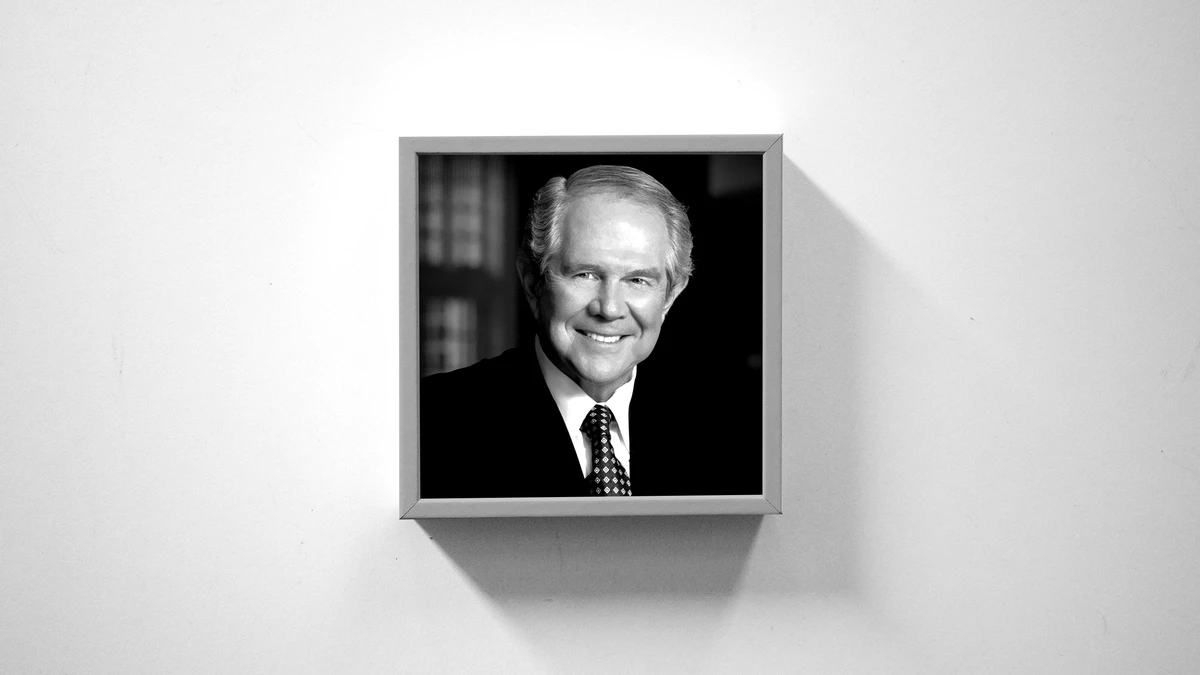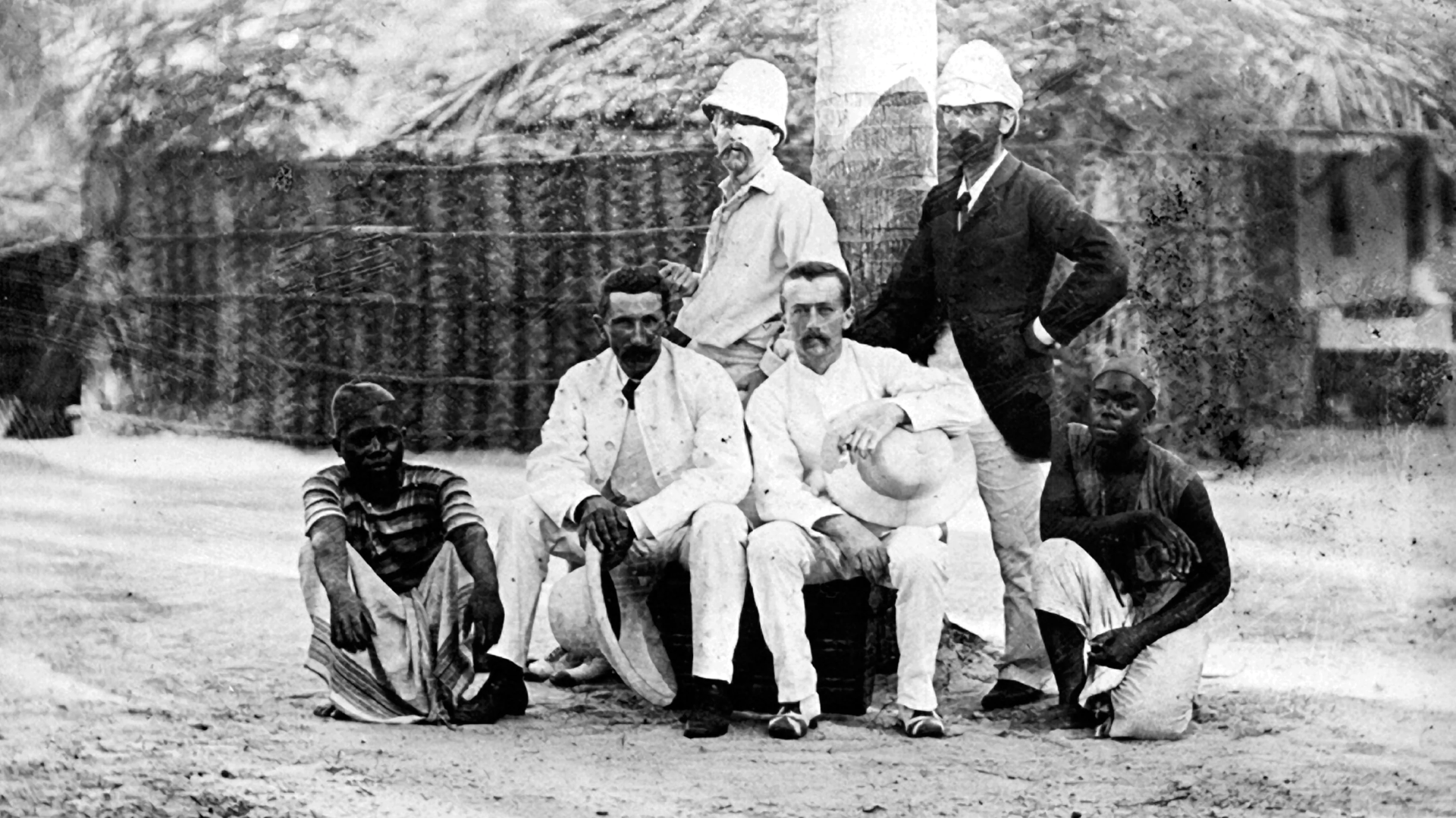« Plus de punch ! » me dicta la voix dans mon écouteur.
J’étais sur scène dans une salle obscure, presque aveuglée par les projecteurs. C’était la première fois que je dirigeais la louange lors d’un grand rassemblement pour étudiants, et l’un des responsables de la production, assis dans la cabine de sonorisation, me pressait de lever les bras plus haut, de bouger davantage, d’applaudir plus fort, de sauter, bref, d’être plus démonstrative.
J’avais toujours su que ce genre de rencontres étaient orchestrées, mais c’était la première fois que je faisais l’expérience de tous les détails de cette machinerie. À un moment donné, on me demanda d’imaginer que mes bras tenaient des frites de piscine pour les garder droits et les lever plus haut. Chaque chant était par ailleurs classé par « niveau d’énergie » de 1 à 5. Dans certaines rencontres, il fallait d’office dépasser le niveau 3.
Je me rappelle m’être posé la question : « Suis-je en train de manipuler les gens qui regardent, chantent et écoutent ? Est-ce que j’utilise la musique pour susciter une réaction émotionnelle dans la foule ? »
La réponse rapide, c’est oui. La musique de louange peut toucher et manipuler les émotions, voire façonner les croyances. La louange collective a des effets neurologiques et physiologiques. Martin Luther disait déjà de la capacité de la musique à émouvoir et à manipuler qu’elle était un don divin tout particulier. « À côté de la parole de Dieu », écrivait Luther, « seule la musique mérite d’être reconnue comme gouvernante des sentiments du cœur humain […] Même le Saint-Esprit fait à la musique l’honneur d’être l’un de ses outils de travail ».
Les auteurs-compositeurs et les responsables de la louange jouent avec les changements de tempo et de rythme, les tonalités et les variations d’instrumentation pour rendre la louange musicale attrayante, immersive et, bien entendu, percutante émotionnellement.
En tant que « public », nous ressentons ces choses. De longs interludes créent progressivement l’attente d’une mélodie familière. L’arrêt des musiciens au moment du refrain vient souligner les voix de la foule. Certaines paroles de chants sont choisies pour influencer notre comportement : « Je me tiendrai debout, les bras levés, le cœur abandonné. »
Il y a des questions intéressantes à se poser sur ce qui donne à la musique de louange contemporaine sa résonance — par exemple dans ce qu’elle a emprunté aux chansons d’amour, aux ballades pop ou aux concerts rock survoltés d’artistes tels que U2 et Coldplay. Mais les préoccupations que l’on peut avoir concernant le pouvoir de manipulation de la musique de louange ont, en réalité, beaucoup moins à voir avec les styles musicaux qu’avec les personnes et les institutions qui créent et interprètent cette musique.
La question que j’aurais donc dû me poser sur scène n’était pas celle de la musique — était-elle manipulatrice ou non ? — mais bien celle de la bienveillance et de la sagesse de ceux d’entre nous qui étaient responsables de l’ensemble du rassemblement — en étaient-ils des intendants et des bergers fidèles ?
Dans les moments de louange collective, nous sommes invités à suivre une direction spirituelle et émotionnelle. Cette ouverture nous rend vulnérables. Ainsi, parallèlement à l’ampleur que prennent ces manifestations dans les Églises s’élève cette question : les émotions de l’assemblée sont-elles entre de bonnes mains ?
« C’est ce qui est compliqué avec les émotions. [Avec la musique de louange], il se passe en nous quelque chose qui est à la fois volontaire et involontaire », explique l’ethnomusicologue Monique Ingalls, qui dirige les programmes d’études supérieures et de recherche sur la musique religieuse à la Baylor University, au Texas.
Les fidèles ont leur mot à dire ; ils peuvent décider dans quelle mesure ils s’ouvrent à cette direction émotionnelle. Même les situations extrêmes de propagande musicale requièrent de la réceptivité de la part de l’auditeur. La propagande musicale est plus efficace lorsque la musique est utilisée pour renforcer nos croyances, et moins pour ce qui est de les modifier. Mais malgré tout, une fois la confiance et l’adhésion acquises, une manipulation émotionnelle dangereuse et abusive est possible.
« Un pasteur qui manipule émotionnellement son assemblée dans un culte, c’est comme un berger qui conduit ses brebis vers un pâturage sans savoir pourquoi », écrit Zac Hicks, auteur de The Worship Pastor, où il aborde cette thématique de la frontière entre accompagnement pastoral et manipulation.
« La manipulation, dans le meilleur des cas, c’est un accompagnement pastoral sans but ou partiel », écrit Hicks. « Après une période d’aveuglement, un fidèle qui a été manipulé s’exclamera souvent : “Mais, attendez, qu’est-ce que je fais ici ?”. »
Plutôt que de considérer la réaction émotionnelle de la foule — mains levées, yeux fermés ou larmes — comme signe d’une prestation réussie, Hicks affirme qu’un pasteur réfléchi utilisera ce qu’il appelle les « contours émotionnels de l’Évangile » (« la gloire de Dieu », « la gravité du péché » et « la grandeur de la grâce ») pour orienter la musique du culte et éviter la manipulation.
Mais lorsque les fidèles soupçonnent que l’attention portée à ces motifs de l’Évangile a été supplantée par d’autres préoccupations, la confiance commence à s’éroder. A-t-on l’impression que le conducteur de louange se préoccupe davantage de son image sur scène que de son rôle pastoral ? Les moments d’émotion intense semblent-ils être devenus des préambules à la collecte de fonds ? Une assemblée craint la manipulation lorsqu’elle a des raisons de douter des intentions d’un responsable ou d’une institution.
« Il est facile de confondre manipulation émotionnelle et manifestation de Dieu, n’est-ce pas ? », déclare la journaliste et auteure Kelsey McKinney dans le documentaire Hillsong: A Megachurch Exposed (2022). « Est-ce que vous pleurez parce que le Seigneur est en train d’intervenir dans votre vie, ou est-ce que vous pleurez parce que les accords musicaux sont choisis pour vous faire pleurer ? »
L’idée qu’une suite d’accords puissent être « choisis pour vous faire pleurer » décrit cependant de manière trop simpliste la relation entre musique et émotion. Car si la musique agit sur l’auditeur, celui-ci lui répond. Il existe une dialectique entre l’individu et la musique dans laquelle chacun influence l’autre et lui répond.
On peut malgré tout comprendre la crainte d’être dupé par une musique soigneusement élaborée pour simuler une expérience spirituelle lorsqu’il semble que de puissants individus à la tête de mégaéglises utilisent la force de la musique pour encourager loyauté et dévotion – non seulement envers Dieu, mais aussi envers leur organisation.
Des scandales comme ceux qui ont touché Hillsong ces dernières années, ainsi que des informations selon lesquelles le milieu de la production de musique de louange serait de plus en plus soumis à des intérêts financiers, alimentent le scepticisme. Une part croissante de la musique utilisée dans les Églises provient d’un groupe restreint, mais puissant d’auteurs-compositeurs et d’interprètes que la plupart d’entre nous ne verrons jamais en personne.
Pour accompagner quelqu’un dans sa vie émotionnelle, Ingalls souligne que confiance et authenticité sont essentielles. Or ce sont deux choses que l’on retrouve rarement dans une relation entre une célébrité et un fan. « Je pense que la peur de la manipulation, la question de savoir si l’on peut faire confiance à une personne, est vraiment liée au débat sur l’authenticité », déclare-t-elle.
Les préoccupations relatives à la manipulation émotionnelle sont bien antérieures à Hillsong et aux méga-artistes de la louange de ces 20 dernières années. En 1977, un dossier intitulé « La musique doit-elle manipuler notre louange ? » faisait la une de Christianity Today et s’interrogeait sur les nouvelles formes d’expression « aux rythmes vigoureux et à la forte intensité émotionnelle » pratiquées par des groupes frénétiques de « gospel rock ».
Les styles musicaux ont certes changé, mais les recommandations d’alors restent d’actualité :
Si l’Église évangélique doit répondre de manière raisonnable à l’évolution rapide des modes d’expression musicale, nous avons besoin de responsables musicaux formés et soigneux, capables de guider leur assemblée pour éviter les pièges de l’esthétisme (culte de la beauté) et de l’hédonisme (culte du plaisir).
Nous avons besoin de musiciens qui soient d’abord des pasteurs. Ils doivent comprendre les besoins spirituels, émotionnels et esthétiques des gens ordinaires et contribuer à la conduite de l’Eglise dans sa quête de la Parole véritable et dans une expression créative, authentique et complète de sa foi. Ce type de ministère vise davantage à former des participants qu’à divertir des spectateurs.
Moyens et bergers imparfaits
C. S. Lewis, même s’il n’était pas musicien, était convaincu que la musique pouvait être « une préparation à la rencontre avec Dieu, voire un moyen de le rencontrer », tout en soulignant qu’elle pouvait facilement devenir une distraction ou une idole.
Selon le musicologue John MacInnis, la musique de Beethoven et de Richard Wagner a constitué une passerelle spirituelle pour Lewis. Lewis considérait ces moments de transcendantalité musicale comme des moments marquants de sa vie et, après sa conversion, en parlait comme d’expériences qui avaient rapproché son cœur et son esprit de Dieu.
Malgré tout, Lewis reconnaissait l’imperfection de la musique en tant qu’expression de louange ou de dévotion. « L’effet émotionnel de la musique peut être non seulement une distraction (pour certaines personnes à certains moments), mais aussi une illusion : en ressentant certaines émotions à l’Église, on risque de les prendre pour des sentiments religieux, alors qu’elles sont peut-être simplement naturelles. »
Lewis ne considérait pas son exaltation à l’écoute du cycle de l’Anneau de Wagner comme de la louange, mais il y reconnaissait une certaine forme de transcendance, de rencontre sublime et bouleversante.
Quand on assiste au spectacle visuel et sonore d’un concert comme ceux de la chanteuse Taylor Swift, on ressent une euphorie qui dépasse nos sensations habituelles et nous mène à un apogée émotionnel. La musique et son contexte peuvent nous amener au sommet de nos facultés émotionnelles. Nous pouvons être submergés par sa beauté et sa puissance, par tous les effets visuels qui la mettent en valeur, par les souvenirs qu’elle seule peut activer avec précision et force.
Comme Lewis, nous avons peut-être tout intérêt à nous laisser de temps à autre toucher par la musique en dehors de l’Église. Cela pourrait nous aider à mieux comprendre notre capacité à être émus par celle-ci et à mieux gérer notre ouverture émotionnelle lors du culte.
Les effets exacts de la musique sur les émotions restent impénétrables, même si de nouvelles recherches neurologiques en explorent davantage les effets sur le cerveau. Pour la plupart d’entre nous, derrière la peur d’être manipulés sur le plan émotionnel, se cache la crainte d’être contraints de faire ou de croire quelque chose. Nous craignons que nos émotions ne réagissent qu’à la musique et non au Saint-Esprit, et que ce que nous percevons comme une expérience spirituelle ne soit en réalité qu’un leurre produit par des musiciens habiles, une équipe de production et des mélodies bien écrites.
La transparence peut être un antidote à ces dangers. En ce sens, il serait pertinent que les musiciens et les animateurs de culte soient plus clairs sur la manière dont ils programment la musique et sur l’objectif de leurs sélections musicales. Par exemple, en encourageant l’assemblée à réfléchir à un passage de l’Écriture avant un chant méditatif. Le simple fait d’annoncer clairement un moment plus marqué par l’émotion est une marque de la sollicitude de l’animateur vis-à-vis de l’assemblée.
Ingalls suggère enfin d’analyser les expériences de louange musicale dans le contexte d’une Église ou d’un ministère particulier au regard des fruits que porte cette louange en dehors des lieux de culte. « Lorsque nous réfléchissons aux expériences émotionnelles intenses suscitées lors des cultes, demandons-nous quelle est la vie — en-dehors de l’Église — des personnes qui les font. »
Pour l’ethnomusicologue, si nous considérons que, quand nous chantons en assemblée, les moments émouvants, parfois déchirants, que nous vivons sont très souvent le fruit d’une coopération entre Dieu qui agit en nous et la musique qui nous entoure, il importe de garder un œil sur le travail de nos bergers et ses conséquences en dehors de ces moments.
« Que se passe-t-il sur le terrain ? », suggère-t-elle de se demander. « [Que fait-on] pour apporter le shalom de Dieu dans le monde ? Pour guérir les relations brisées avec Dieu, entre les gens, entre les gens et la terre ? »
Kelsey Kramer McGinnis est la correspondante de CT pour la musique de louange. Musicologue, éducatrice et écrivain, elle étudie la musique dans les communautés chrétiennes.
Traduit par Anne Haumont
–