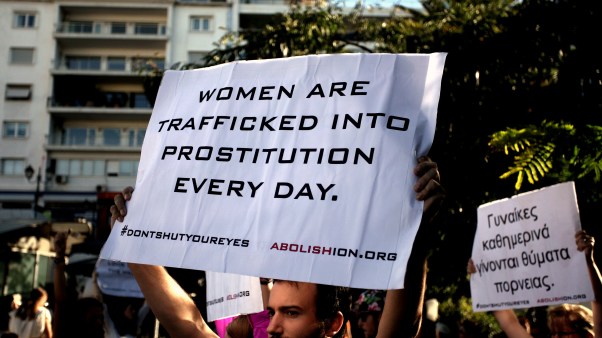La version française de cet article a fait l’objet d’une mise à jour.
Lorsque le personnel de l’hôpital m’a appelé au chevet de ma patiente, j’ai immédiatement pu constater la gravité de sa détresse. Elle était agitée et essoufflée. Son visage était marqué par la douleur et le dépit. « Je n’en peux plus », pleurait-elle.
Elle souffrait depuis des années d’une maladie chronique et avait été admise dans mon unité de soins intensifs pour des complications aiguës. Elle était affaiblie et épuisée. Sa peine et sa frustration avaient atteint leur paroxysme : « Je veux juste mourir. »
Son ami se tenait à côté de moi à son chevet, et il était manifestement bouleversé par sa détresse. « Demande juste une AMM », lui dit-il soudain, reprenant l’abréviation populaire de « aide médicale à mourir » la formule couramment utilisée ici au Canada pour parler de l’euthanasie et de l’assistance au suicide. « Tu pourras mettre fin à tout ça. »
J’ai été saisi par sa déclaration. Bien que la mort médicalement assistée soit possible dans mon pays, je ne m’attendais pas à ce que la conversation s’oriente dans cette direction. Je voyais là à quel point il se sentait désespéré et impuissant face à la détresse de son amie.
Après quelques interrogations en douceur, nous avons rapidement compris que cette patiente ne voulait pas vraiment mourir ; elle avait plutôt besoin d’être soulagée de sa douleur et de son anxiété et de mieux comprendre sa maladie et ce qu’elle signifiait pour son avenir. Elle voulait encore passer du temps avec ses proches. Nous avons travaillé sur ses symptômes et ses inquiétudes et elle s’est rapidement sentie plus calme et apaisée. En la voyant se reposer et converser avec sa famille, il était difficile de croire qu’il s’agissait de la même personne qui, quelques heures auparavant, réclamait qu’on mette fin à ses jours.
Ce qui est encore plus incroyable, c’est que la possibilité de mettre rapidement fin à sa vie est une option de plus en plus acceptable pour les patients canadiens, avec des conséquences qui se répercuteront dans le monde entier.
Dans ma jeunesse, je rêvais d’être médecin. Cette profession m’apparaissait comme une noble vocation, à la fois exigeante sur le plan intellectuel et profondément humaniste. J’ai donc entrepris le long parcours nécessaire pour devenir un médecin pleinement qualifié.
Au début, mon idéalisme quant au pouvoir de la médecine pour accompagner dignement la souffrance des êtres humains m’empêchait de prendre conscience de sa sensibilité potentielle à des changements culturels et sociaux plus larges — ou de voir les façons dont elle a aussi pu, tout au long de l’histoire, porter atteinte à la dignité humaine plutôt qu’elle ne la protégeait.
En 2014, peu de temps après la fin de ma formation de spécialiste en médecine intensive, le corps médical canadien et la société en général commençaient à discuter sérieusement de la possibilité de légaliser la mort assistée par un médecin.
Une affaire judiciaire très médiatisée impliquant deux femmes atteintes de maladies dégénératives et souhaitant mettre fin à leur vie a suscité une vague de soutien public à cette pratique. Donner la mort était de plus en plus considéré comme un acte de compassion plutôt que comme une menace existentielle. Nombre de mes collègues médecins se sont joints aux partisans de cette évolution du consensus moral. La société souhaitait ouvrir la possibilité d’une mort assistée par un médecin, et les professionnels de la santé avaient donc la responsabilité de l’offrir, par compassion et par respect pour les patients.
Je me souviens très bien du jour où j’ai compris que ceux d’entre nous qui refuseraient de contribuer à cette assistance à la mort seraient bientôt considérés comme des praticiens à l’éthique douteuse. Nous risquions d’en venir à être perçus comme plus préoccupés par nos propres dilemmes moraux que par le bien-être du patient. Si causer la mort était autrefois un vice, on en ferait bientôt une vertu.
Au nom du « progrès » moral, la profession prenait un nouveau rôle et s’arrogeait un nouveau pouvoir : non seulement sauver des vies, mais aussi mettre fin à certaines. Le sol se dérobait sous nos pieds. Qu’est-ce que signifierait ce changement pour ceux qui refuseraient de s’en accommoder ?
Sue Rodriguez était une femme de 42 ans, originaire de Colombie-Britannique, atteinte d’une maladie redoutable : la sclérose latérale amyotrophique (SLA), également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig. Confrontée à un handicap croissant, elle fit appel en 1993 à la Cour suprême du Canada pour qu’elle annule l’interdiction de l’aide au suicide prévue par le Code pénal, afin qu’elle puisse y recourir elle-même. Le tribunal rejeta son appel et confirma l’interdiction, déclarant que « cette politique publique fait partie de notre conception fondamentale du caractère sacré de la vie ». La Cour citait également « des préoccupations concernant les abus et la grande difficulté de mettre en place des garanties appropriées ».
Vingt ans plus tard, la Cour fut saisie d’une affaire très similaire. Cette fois, les choses étaient différentes. Des années d’observation des régimes libéraux d’aide au suicide en Belgique et aux Pays-Bas avaient semblé montrer que des garde-fous pouvaient protéger les personnes vulnérables contre une euthanasie contraire à leur volonté.
Selon d’éminents bioéthiciens du pays, les valeurs sociales canadiennes avaient également évolué. Un rapport influent préparé par des membres de la Société royale du Canada en 2011 affirmait que « les tentatives de faire appel à la dignité et au caractère sacré de la vie humaine ont été largement critiquées par les philosophes » et que « la valeur de l’autonomie individuelle ou de l’autodétermination […] devrait être considérée comme primordiale » parmi les « valeurs qui font l’objet d’un large consensus au sein de la société [canadienne] ».
Le rapport conclut :
il existe un droit moral, fondé sur l’autonomie, pour les personnes compétentes et informées qui ont décidé, après un examen approfondi des faits pertinents, que la suite de leur vie ne vaut pas la peine d’être vécue, à la non-ingérence dans les demandes d’assistance au suicide ou à l’euthanasie volontaire.
La possibilité légale suivit rapidement la possibilité morale. Gloria Taylor, également atteinte de SLA, porta son cas devant la Cour suprême du Canada. Elle demanda la possibilité d’une mort assistée : « Je vis dans l’appréhension que ma mort soit lente, difficile, désagréable, douloureuse, indigne et incompatible avec les valeurs et les principes selon lesquels j’ai essayé de vivre. »
D’autres témoins affirmèrent qu’ils « souffraient du fait de savoir qu’ils n’avaient pas la possibilité de mettre fin à leur vie de manière paisible au moment et de la manière qu’ils le souhaitaient. »
Dans une décision historique rendue en 2015, la Cour suprême estima alors que l’interdiction pénale du suicide et de l’euthanasie médicalement assistés violait la Charte canadienne des droits et libertés, en particulier le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne.
Fonder la liberté d’être tué sur le droit à la vie peut sembler contre-intuitif, mais la Cour estima que l’interdiction pénale de l’assistance médicale à la mort pourrait contraindre « certains individus à mettre fin prématurément à leurs jours, de peur d’être incapables de le faire lorsqu’ils atteindront le point où la souffrance sera intolérable ». En outre, la Cour estima que l’interdiction de la mort médicalement assistée constituait une ingérence dans les décisions individuelles relatives à l’intégrité corporelle et aux soins médicaux, qui relèvent des droits à la liberté et à la sécurité.
Un an plus tard, le gouvernement canadien suivait les conclusions du tribunal et légalisait l’aide médicale à la mort. Initialement, la loi stipulait que ce type d’assistance était limitée aux personnes atteintes de « souffrances aiguës et irrémédiables » et pour lesquelles « la mort était raisonnablement prévisible ». Toutefois, à mesure que la pratique s’est répandue et qu’elle a été mieux acceptée par la société, les restrictions destinées à protéger les personnes vulnérables ont été progressivement éliminées.
En 2021, l’exigence de « mort raisonnablement prévisible » a été supprimée, et les personnes en bonne santé souffrant d’un handicap physique sont devenues éligibles au suicide assisté. Au cours des délibérations parlementaires sur cette modification de la loi, j’ai témoigné devant le Sénat canadien aux côtés de deux femmes souffrant de handicaps physiques visibles et graves. Elles s’exprimaient clairement sur l’impact négatif que ce changement de loi aurait sur la communauté des personnes handicapées au Canada.
Il m’a été déchirant que le Canada déclare ces personnes éligibles à ce que l’on mette fin à leur vie, alors qu’une personne comme moi, sans aucun handicap physique identifiable, ne peut bénéficier d’une assistance médicale à la mort. Qu’est-ce que cela dit du regard porté par notre société sur les personnes handicapées ?
En six ans, le nombre de patients mourant avec l’aide d’un médecin au Canada a été multiplié par treize, passant d’environ 1 000 en 2016 à plus de 13 000 en 2022 — soit 4,1 % de tous les décès au Canada cette année-là, selon les rapports officiels du gouvernement d’octobre 2023.
Les données disponibles ne laissent pas penser que des patients auraient été contraints à l’aide médicale à la mort, mais une « culture de mort » (un terme que j’ai d’abord refusé d’utiliser parce que je le trouvais inutilement provocateur) s’est imposée de manière insidieuse et surprenante. La mort assistée n’est plus considérée comme une option désespérée de dernier recours, mais comme une « option thérapeutique » parmi d’autres, un moyen raisonnable et efficace de résoudre définitivement la souffrance, offerte non seulement aux mourants, mais aussi à ceux dont la vie n’est pas considérée comme digne d’être vécue.
Certains patients souffrant d’un handicap ou d’une maladie mentale ont déclaré que la mort assistée leur avait été proposée sans qu’ils abordent le sujet. Des personnes ont demandé et obtenu l’euthanasie parce qu’elles n’avaient pas accès à des possibilités de logement abordables. Il y a même certains rapports selon lesquels des patients ont bénéficié d’une mort médicalement assistée à la suite d’un diagnostic erroné, découvert lors de l’autopsie. Après un premier report, le gouvernement canadien envisage actuellement pour 2027 l’élargissement de l’aide médicale à mourir aux patients atteints de maladie mentale. Certains font même pression pour qu’elle soit autorisée dans certains cas pour les enfants et les jeunes.
Une fois que la mort sera considérée comme une forme de soins de santé, les « prestataires » de soins de santé seront censés pouvoir la proposer.
La logique de la mort assistée s’est montrée inexorable : si la mort est une thérapie permettant de traiter les blessures psychologiques liées à la souffrance et au sentiment que la vie n’a plus de sens, qui ne devrait pas être considéré comme éligible ?
Il est clair que cette évolution morale exerce une pression immense sur les médecins qui refusent de participer à l’aide à la mort. La pression exercée sur les professionnels de la santé ne porte pas tant sur la nécessité de pouvoir eux-mêmes accomplir l’acte de mettre fin à la vie que sur celle de pouvoir sciemment orienter un patient vers quelqu’un qui le fera. Mais référer un patient à un collègue n’est pas une chose anodine : nous sommes coupables si nous envoyons sciemment nos patients chez un médecin qui les traitera d’une manière que nous jugeons contraire à l’éthique.
Ainsi, le célèbre médecin autrichien Hans Asperger est récemment tombé en disgrâce pour avoir participé à l’euthanasie d’enfants pendant l’occupation nazie de l’Autriche. Bien qu’il ne les ait pas directement tués, il orientait des enfants atteints de déficiences intellectuelles vers une clinique du Troisième Reich qui les éliminait. Il s’est ainsi rendu complice de leur mort.
Un certain nombre de médecins canadiens se sont associés à des collègues du monde entier pour défendre la liberté de conscience dans l’exercice de la médecine, mais les pressions sont immenses. Plusieurs juridictions au Canada ont été les premières au monde à exiger que de telles orientations vers d’autres professionnels aient lieu, sous la menace d’une action disciplinaire potentielle, et ce n’est que via les tribunaux que des médecins chrétiens en Californie ont finalement eu gain de cause à ce sujet en 2023. Plus la mort sera considérée comme une forme de soins de santé, plus les « prestataires » de soins de santé seront censés la proposer.
L’euthanasie active est actuellement autorisée dans huit pays du monde, le Portugal ayant rejoint en 2023 la Belgique, le Canada, la Colombie, l’Espagne, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas. L’assistance à la mort est également légale dans dix États américains et dans le District de Columbia, où des milliers de personnes se sont vu prescrire légalement des médicaments pour mettre fin à la vie au cours des quinze dernières années.
Les chrétiens devraient accorder une attention particulière au cheminement de l’acceptation éthique et culturelle de ces pratiques au Canada, car d’autres pays pourraient bien suivre. Aux États-Unis, plusieurs États ont élargi les critères d’accès à l’aide médicale à mourir au cours des dernières années. En France, le débat sur une possible ouverture à l’euthanasie est toujours en cours et un projet de loi est prévu pour les premiers mois de 2024.
L’histoire de l’adoption de l’euthanasie au Canada est bien plus profonde que les seules délibérations des universitaires ou les tractations des tribunaux. Il s’agit en partie de l’histoire du triomphe de l’esthétique sur l’éthique.
Les arguments en faveur de l’aide à la mort ne reposent pas tant sur une délibération morale rationnelle que sur l’attrait de la maîtrise de la mort. Alasdair MacIntyre observe qu’une forme d’émotivisme est désormais le paradigme moral dominant. Pour les émotivistes, une chose est bonne simplement parce qu’elle paraît bonne. Et la mort assistée, seloncertains, paraît tout simplement bonne.
Cette évolution culturelle est aussi l’histoire de la façon dont la laïcité peut fonctionner d’une manière étonnamment religieuse. Il fut un temps où la peur de la mort nous empêchait d’utiliser celle-ci pour échapper à la souffrance terrestre. Envisageant de se suicider, le Hamlet de Shakespeare en est dissuadé par « cette crainte de quelque chose après la mort, ce pays ignoré, des bornes duquel nul voyageur ne revient. » La conscience, conclut-il, « fait des poltrons de nous tous ».
Lorsque la souffrance paraît absurde, il peut sembler naturel, voire rationnel, de choisir la mort.
Mais si Dieu est mort, la conscience n’appelle plus à la prudence. Nous supposons savoir ce que la mort apporte. Un prestataire canadien, dans des paroles plus semblables à celles d’un prêtre que d’un médecin, décrivait avec assurance la mort assistée comme « une transition paisible vers l’au-delà ». Ce genre d’affirmation ne pourra jamais être éprouvée dans le cadre d’essais cliniques.
La confiance dans le caractère paisible de cette mort n’empêche d’ailleurs pas les « innovations techniques » : un militant australien de l’euthanasie fait depuis 2021 la promotion d’une « capsule à suicide » imprimée en 3D pour une expérience de suicide assisté « raffinée et élégante ». Ces approches expriment une foi aveugle dans une vision du monde dépourvue de Dieu, mais non moins religieuse.
Mais avant tout, ces développements sont l’histoire d’individus qui luttent pour trouver un sens à leur vie et un but à leur souffrance. Citant Friedrich Nietzsche, Viktor Frankl, psychiatre juif et survivant d’Auschwitz, observait : « celui qui a un pourquoi à vivre peut supporter presque n’importe quel comment. » En tant qu’individus « libérés », nous tenons à trouver nous-mêmes le sens à notre existence, mais ce sens inventé s’avère creux lorsque nous sommes confrontés à une souffrance irrémédiable.
Comment la souffrance peut-elle avoir un sens ? Qu’est-ce qui ferait que la vie avec la souffrance vaille la peine d’être vécue ? Si la souffrance est absurde, il peut sembler naturel, voire rationnel, de choisir la mort. Comme l’a dit l’écrivain et dramaturge français Albert Camus : « Mourir volontairement implique d’avoir reconnu, même instinctivement […] l’inutilité de la souffrance ».
Comment pouvons-nous donc, en tant que chrétiens, répondre à la problématique de l’assistance médicale à la mort ? Tout d’abord, il nous faut faire appel à la raison et à la lumière de la nature pour affirmer de manière absolue la valeur de la vie.
L’euthanasie et l’aide au suicide sont présentées comme une question de respect. Mais valoriser une personne, c’est valoriser son existence. La volonté de mettre délibérément fin à l’existence d’une personne dévalorise nécessairement cette dernière. Si les gens sont importants, nous ne devons pas mettre intentionnellement fin à leur vie.
Deuxièmement, nos Églises sont appelées à être des espaces où la mort assistée est inconcevable parce que les plus faibles, les personnes âgées, les personnes handicapées et les mourants sont considérés comme des membres irremplaçables de la communauté. Nous pouvons être un lieu où ceux qui souffrent bénéficient d’une présence dévouée à leur côté, de l’amour et du soutien qui leur rappellent leur valeur et les réconfortent dans la douleur. Après tout, c’est à cela que nous aspirons tous.
Troisièmement, nous pouvons plaider en faveur de l’accès à de meilleurs soins médicaux et palliatifs pour les personnes souffrantes ou mourantes. Le concept moderne des soins palliatifs a été initié par une femme médecin chrétienne, Cicely Mary Saunders, et a transformé les soins médicaux de fin de vie. Pourtant, l’accès à des soins palliatifs de qualité au Canada comme dans le reste du monde est encore bien trop limité.
Nous pouvons également défendre le droit à la liberté de conscience des médecins et des infirmières qui s’occupent des malades et des mourants, afin qu’ils ne soient pas contraints de participer à l’aide à la mort.
Enfin, le message de la croix du Christ que nous portons pour le monde ouvre à la foi, l’espérance et l’amour face à la souffrance et à la mort. Nous avons foi dans les desseins de Dieu pour notre bien ultime. Nous avons notre espérance dans sa puissance rédemptrice. Nous avons son amour qui a été répandu dans nos cœurs.
La souffrance ne peut pas nous priver du véritable sens de notre existence : connaître celui qui s’est donné pour nous et communier avec lui. En réalité, par la grâce de Dieu, la souffrance permet même souvent d’approfondir cette communion. Partir et être avec le Christ est bien ce qu’il y a de mieux pour nous, mais avec patience et foi, nous attendrons l’appel du maître.
Ewan C. Goligher est professeur adjoint de médecine et de physiologie à l’université de Toronto. Si vous ou l’un de vos proches pensez au suicide, parlez-en à quelqu’un. Des lignes téléphoniques nationales et d’autres services dédiés sont prêts à vous aider.