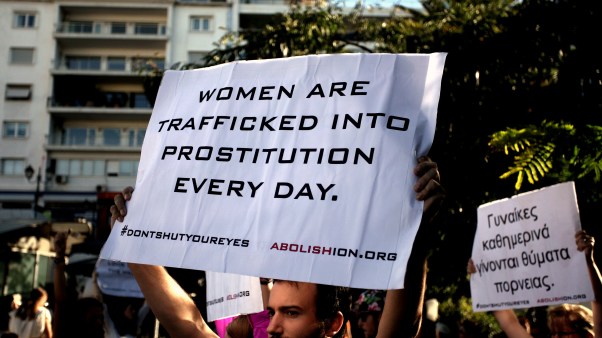L’année dernière, j’ai commencé à lire Moby Dick d’Herman Melville. J’ai rapidement été fascinée par les magnifiques descriptions qu’Ismaël fait de sa passion pour la mer. Mais au chapitre 2, je déchantais déjà.
Ismaël y tombe par hasard dans un service religieux noir, vraisemblablement chrétien. Ses descriptions deviennent choquantes. L’assemblée y est vue comme un « grand Parlement noir siégeant à Tophet » (un autre nom pour l’enfer) et le prédicateur comme « un ange noir du destin ». Dans le chapitre suivant, on rencontre l’Amérindien Queequeg dont les premiers mots sont : « Vous parler ! Vous dit qui vous êtes, ou crédieu, moi touer vous », avant d’être rapidement qualifié de cannibale.
Que faisons-nous des passages racistes de classiques comme celui-ci, en particulier en tant que lecteurs de couleur ?
Depuis toujours, je suis une amoureuse des livres et j’applaudis chaleureusement le fait que de nombreux chrétiens s’intéressent à la préservation et à la défense de la littérature classique.
Dans On Reading Well et divers articles, Karen Swallow Prior explique que les bons livres nous aident à cultiver nos vertus. De même, Jessica Hooten Wilson affirme que la littérature nous aide à être plus saints, en ce sens qu’elle affine notre vision du monde et développe notre empathie. Comme l’écrit Philip Ryken, la lecture de bons livres élève notre imagination et nourrit notre amour de la beauté ; elle peut même nous aider à devenir des enseignants, des prédicateurs et des responsables plus pertinents.
Cependant, en tant que chrétienne non-blanche, je déplore que dans les discussions sur la lecture des classiques occidentaux, on évite deux vérités difficiles à admettre. Ou on ne les mentionne qu’en passant.
Premièrement, même si un livre n’est pas ouvertement raciste, les lecteurs de couleur doivent presque inévitablement faire face à l’hostilité, à la condescendance et à la méfiance qu’ont exprimées envers les personnes d’autres races des auteurs classiques imprégnés de la période historique dans laquelle ils ont vécu.
Melville et Dickens, Brontë et Byron, Twain et Tolkien étaient tous ancrés dans des cultures qui soumettaient des continents entiers à l’esclavage et à l’impérialisme. Dire à un lecteur de couleur qu’il s’agit d’époques révolues ne suffit pas. Nous savons mieux que quiconque que le racisme existe encore aujourd’hui.
La deuxième vérité importante pour une grande partie de la littérature occidentale, notamment anglophone — et qui est difficile à concilier avec la première — est qu’elle fait partie de notre passé chrétien. De Chaucer à Joyce, le christianisme émaille les personnages, les intrigues et les thèmes de nombreuses œuvres classiques occidentales.
Assurément, cela fait de la lecture des classiques un outil éclairant pour les croyants. Kathleen Nielson écrit que « les chrétiens doivent lire les classiques, parce que les classiques racontent notre histoire. À l’évidence, de nombreux classiques de la littérature occidentale racontent de diverses manières notre histoire chrétienne parce qu’ils émanent de cultures façonnées par le christianisme ».
Mais c’est malheureusement cette « histoire chrétienne » qui heurte les lecteurs de couleur.
Outre le fait que la littérature occidentale fait souvent l’impasse sur l'histoire complète des débuts du christianisme en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, les classiques racontent (ou passent sous silence) des périodes d’esclavage et de lynchage, de discrimination et d’aliénation, d’incarcérations de masse déshumanisantes et de ségrégation, souvent œuvres de personnes qui se considéraient comme de fervents défenseurs de la foi.
Et bien que le visage du christianisme ait changé radicalement depuis lors, pour les lecteurs de couleur, les cultures mêmes qui nient les nôtres sont paradoxalement aussi les gardiennes historiques de la religion qui nous sauve. Ainsi, la littérature anglaise classique est pour moi un poignard et un mystère, mais aussi une passion qui fait vibrer mon être le plus profond.
Par exemple, Emily Dickinson, une chrétienne fervente et une poétesse que j’aime profondément, écrit ces mots : « Ses hérésies orientales / Exaltent l’abeille / Enflamment la terre et l’air / D’une joyeuse apostasie ». Dans ce poème, son image de ce que signifie « oriental » implique à la fois hérésie et exaltation, une sorte d’« apostasie » palpitante et vaguement menaçante.
Son point de vue est révélateur d’une époque où les femmes asiatiques étaient considérées comme des êtres exotiques plus ou moins sous-humains. Dans The Making of Asian America, Erika Lee décrit comment la première femme chinoise arriva aux États-Unis en 1834, alors que Dickinson avait environ quatre ans. Cette jeune fille de 19 ans, Afong Moy, était enfermée huit heures par jour dans un « saloon chinois » reconstitué. Les visiteurs payaient de l’argent pour la voir utiliser des baguettes et s’émerveiller de son « costume national » et de ses petits pieds liés. Lorsqu’elle prit de l’âge, elle fut vendue à un cirque avant de disparaître de l’histoire.
D’après les documents historiques de l’époque, on peut raisonnablement supposer que de nombreux visiteurs du saloon chinois étaient chrétiens. Dans un de ses écrits, Alexis de Tocqueville, déclare à propos des États-Unis qu’il avait visités dans les années 1830 : « Il n’y a pas d’autre pays dans le monde entier où la religion chrétienne conserve une plus grande influence sur l’âme des êtres humains. »
Bien entendu, la littérature classique ne se résume pas à ses contextes et passages racistes. Mais si nous ne reconnaissons pas les vérités difficiles et compliquées de notre passé, nous risquons de paraître sourds et aveugles à l’environnement de plus en plus diversifié qui est le nôtre.
Si nous voulons défendre les classiques, nous devons également répondre à la question difficile de savoir pourquoi les lecteurs non-blancs, en particulier les chrétiens parmi eux, devraient continuer à les lire.
Dans son analyse portant sur la croix de Jésus, l’auteur de Reading While Black, Esau McCaulley, pose la question suivante : « Quelle est la première réponse de Dieu à la souffrance des Noirs (et à la souffrance humaine au sens large, ainsi qu’à la rage qui l’accompagne) ? C’est d’y entrer à nos côtés en tant qu’ami et rédempteur. La réponse à la rage noire, ce sont les paroles apaisantes du Verbe fait chair. »
Cette incarnation peut avoir le même effet sur les pages de la littérature occidentale classique. Grâce à elle, nous pouvons entraîner nos yeux à regarder le passé en face. Nous pouvons utiliser notre imagination théologique pour nous représenter Jésus assis à nos côtés alors que nous lisons les grandes œuvres littéraires du passé — pleurant avec nous, en colère avec nous, aimant l’humanité avec nous.
Mais avant d’aller plus loin, soulignons que les discussions sur la littérature classique et le racisme qui y est inhérent ne sont pas nouvelles. De nombreux lecteurs d’aujourd’hui, chrétiens ou non, ont rejeté des œuvres classiques pour cette raison.
Certains ont accusé des classiques de la littérature enfantine comme Tintin au Congo, Peter Pan et La Petite Maison dans la Prairie d’être des « menaces pour le développement moral des jeunes qui ne sont pas encore désensibilisés aux séductions de l’apologétique néocolonialiste ». Ces attaques ont conduit à renommer des prix littéraires, à bannir certains livres ou à ne plus les éditer, ce qui a suscité une vague de controverses.
À l’autre extrémité du spectre idéologique, des chrétiens conservateurs de certains États des États-Unis — comme le Wyoming, l’Oklahoma et le Tennessee — défendent divers projets de loi qui proposent de faire payer les bibliothèques pour avoir certains livres en rayon, d’interdire les ouvrages traitant de sujets tels que l’identité sexuelle et de supprimer ceux qui contiennent de la nudité ou des mots grossiers.
Qu’ils soient considérés comme « néocolonialistes » ou, au contraire, « wokistes », de nombreux livres sont aujourd’hui sur la sellette. Un article du New York Times rapporte que « les parents, les militants, les responsables des conseils scolaires et les législateurs de tout le pays remettent en question les livres à un rythme jamais vu depuis des décennies. »
Néanmoins, pour moi, il se passe quelque chose d’intéressant lorsque des lecteurs chrétiens avisés se plongent dans une littérature « dangereuse », même si celle-ci a été écrite à une époque marquée par le sang.
Dans son essai « Reading Racist Literature » publié dans le New Yorker, Elif Batuman décrit l’expérience enrichissante qu’elle a vécue en assistant à une pièce de théâtre intitulée An Octoroon. Cette pièce est une réinterprétation moderne et stimulante d’un mélodrame raciste de 1859 intitulé The Octoroon (« L’octavon »), nom problématique car notamment utilisé autrefois pour décrire les personnes non-blanches en les assimilant à du bétail.
Mais voici la question rhétorique posée par Batuman : « Que faire de nos sentiments mitigés à l’égard d’un texte qui traite comme un simple décor l’insulte la plus grave et la plus mal cicatrisée de l’histoire américaine, surtout lorsque vous appartenez au groupe insulté ? […] Quel sens donner à notre amour pour des œuvres d’art fondées sur des valeurs sociales périmées et inhumaines — et pourquoi nous en préoccuper ? »
Elle poursuit : « Il est plus facile d’écarter les œuvres qui nous paraissent aujourd’hui aussi maladroites que “The Octoroon”. Mais si l’on ne rejette pas le passé, ou si l’on ne l’occulte pas, on peut arriver à quelque chose comme “An Octoroon” : une œuvre de joie, d’exaspération et de colère qui métamorphose l’insulte historique en force artistique. »
Comme l’écrit Batuman dans un autre essai sur Hadji Murat et Anna Karénine de Léon Tolstoï, ces histoires retravaillées peuvent « révéler différentes vérités à différents moments dans l’espace et le temps, peut-être même en déstabilisant les structures qu’elles avaient autrefois renforcées ». Elle poursuit en disant que c’est presque comme si « le sens du roman lui-même pouvait changer, et continuerait à changer ».
En d’autres termes, ces reprises ont souvent le pouvoir de faire évoluer les œuvres classiques elles-mêmes.
Un excellent exemple est Wide Sargasso Sea de Jean Rhys, écrit du point de vue de Bertha, la femme dans le grenier du roman Jane Eyre. Dans ce texte de Charlotte Brontë, Bertha n’est décrite qu’à travers les mots de son malheureux mari, Rochester, comme étant de descendance créole et native de Spanish Town, en Jamaïque.
En tendant le micro à Bertha, Rhys, elle-même femme originaire d’un territoire colonisé , remodèle le récit de Jane Eyre. Wide Sargasso Sea montre que la littérature classique n’est pas statique, mais bien organique.
Joseph S. Walker qualifie la relecture de Rhys de « re-vision » qui « change la nature et les lectures possibles » de l’œuvre classique parce qu’elle « parle depuis la marge et, ce faisant, en décale le centre ».
Notre acte même de lecture en tant que chrétiens de couleur fait réapparaitre les morts de l’histoire et poursuit leurs conversations inachevées. Non seulement nous parlons depuis ce qui est en marge du texte, mais nous pouvons aussi en réajuster le centre. Ce faisant, nous participons à l’œuvre de Jésus, qui consiste à faire toutes choses nouvelles, à restaurer la dignité de tous les peuples et à nous mener vers un véritable pardon.
Les lecteurs de couleur que nous sommes pouvons revisiter les récits répréhensibles non seulement grâce à nos réécritures, mais aussi simplement par notre lecture commune et notre présence.
Lorsqu’au lycée nous avons lu ensemble la scène de Jane Eyre où Rochester se farde le visage en noir, la discussion dans notre classe a été transformée du simple fait que mes camarades noirs étaient présents dans la pièce. Leurs perspectives ont façonné ma lecture du texte et la façonnent encore.
Nous abordons l’histoire, la littérature et le monde plus clairement lorsque des yeux de non-Blancs lisent les livres du passé. Notre histoire en tant qu’humanité est plus complète lorsque les peuples historiquement colonisés et marginalisés se plongent dans les courants de la littérature occidentale classique avec les yeux grands ouverts — parce qu’il y a des choses qu’ils sont les seuls à pouvoir y déceler.
Et de cette manière, les pages des classiques peuvent dévoiler plus clairement la Grande Histoire qui sera un jour racontée non plus seulement dans une seule langue par un seul peuple, mais par des personnes de toutes les nations, tribus et langages.
Après tout, l’Évangile est une histoire qui s’entremêle à toute l’Histoire. Croire en Jésus-Christ, c’est croire qu’il pourra un jour en restaurer même les parties les plus laides et douloureuses de cette Histoire. Et nous avons l’espoir qu’il le fait déjà aujourd’hui.
Karen Swallow Prior a écrit qu’Aristote considérait la littérature comme un terrain d’entraînement pour les émotions. Pour les lecteurs chrétiens de couleur, la littérature classique devient un autre type de terrain d’entraînement, celui de la pratique du pardon.
Pour nous, ce travail de pardon n’est pas un exercice sentimental/romantique. Au contraire, grandir dans l’amour de notre prochain à travers les pages de ces vieux livres est une tâche épineuse et parfois même insoutenable — un peu comme porter une croix.
C’est un travail inconfortable et difficile qui n’est pas à la portée de tous. Mais pour ceux qui peuvent l’endurer, les pages des grands livres nous permettent d’être aux premières loges pour répondre à l’une des plus grandes questions de la vie : Qu’est-ce que signifie aimer et pardonner à nos ennemis ?
Si nous voulons connaître la véritable histoire du christianisme, nous devons nous rappeler que Jésus n’était pas blond, blanc et anglais comme les enfants Pevensies dans les Chroniques de Narnia de C. S. Lewis. C’était un homme pauvre, à la peau sombre, originaire du Moyen-Orient, plus proche du personnage de Shasta dans ce même ouvrage. Jésus a passé sa vie non pas dans les palais de la Rome impériale, mais dans les bidonvilles asservis de Galilée, au milieu d’un peuple soumis à l’occupant. Sa vie a été marquée par le chagrin et le rejet.
C’est ce même Jésus qui est avec nous dans les pages de Melville comme au centre commercial, lorsqu’un gêneur nous crie des obscénités racistes. Jésus n’a pas peur de nos questions. Il voit nos blessures. Et, plus important encore, il ne laissera pas les choses en l’état.
Dans chaque remarque ou description raciste trouvée dans la littérature classique, le vent tourne lorsque nous réalisons que le vrai Jésus se tient dans les marges, souffrant tranquillement aux côtés des lecteurs de couleur et réajustant le centre même du monde.
Cette prise de conscience modifie notre façon de lire.
Cela m’horripile lorsque les gens discutent de la valeur de la littérature en termes de résultats mesurables et utilitaires. Devrions-nous lire les classiques uniquement s’ils nous rendent plus vertueux et plus efficaces en tant que responsables ? Devrions-nous soutenir les œuvres littéraires uniquement si des études montrent qu’elles augmentent notre intelligence ou nos centres d’intérêt ?
Beaucoup d’entre nous aiment la littérature avant tout parce qu’ils la trouvent belle. Dans Rembrandt Is in the Wind, Russ Ramsey écrit que les beaux mots, tout comme les belles œuvres d’art, « élèvent la recherche de la vérité au-delà d’une accumulation de savoir vers une proclamation et une application de cette vérité au nom de l’attention portée aux autres. La beauté nous entraîne plus profondément dans la dimension communautaire ».
Il poursuit : « On désire ardemment partager l’expérience de la beauté avec d’autres personnes, se tourner vers quelqu’un et lui dire : “Tu entends ça ? Tu vois ça ? Comme c’est beau !” »
La grande littérature nous parle d’éternité. Elle peut nous faire aspirer à Dieu et approfondir notre vision de notre réalité quotidienne. Elle peut ouvrir nos oreilles aux résonances culturelles à travers l’histoire et cultiver en nous l’humilité de notre temps et de notre lieu.
Je suis immensément reconnaissante envers les auteurs qui ont ouvert la voie aux écrivains de couleur d’aujourd’hui : Toni Morrison, Langston Hughes et Amy Tan, pour n’en citer que quelques-uns. J’encourage mes amis chrétiens blancs à explorer non seulement ces classiques, mais aussi le nombre important et croissant de livres écrits actuellement par des auteurs non-blancs, ainsi que les classiques des cultures non occidentales.
Que notre lecture nous aide à aimer les personnes réelles qui nous entourent. Qu’elle nous apprenne à exprimer humblement les mots de C. S. Lewis : « Mes propres yeux ne me suffisent pas ; je verrai à travers ceux des autres. »
Certaines œuvres littéraires ne survivront pas au passage à notre ère moderne. Mais enterrer chaque classique problématique dans des tombeaux inaccessibles serait un réel dommage. Si une œuvre littéraire est réellement un classique, elle brisera le cycle de l’injustice en se prêtant de manière subversive à notre imagination théologique, à nos re-visions et à notre participation à l’œuvre de Jésus qui fait toutes choses nouvelles.
Alors peut-être que ces œuvres d’art littéraires réimaginées pourront, pour reprendre les mots de Miroslav Volf, devenir « un pont entre les adversaires au lieu d’un ravin profond et sombre qui les sépare ».
À cette fin, les lecteurs chrétiens de couleur doivent aussi être présents là où l’on discute de la littérature occidentale classique. Ces œuvres ont encore beaucoup de choses à dire — et certaines de ces choses ne peuvent être dites qu’à travers nous.
Sara Kyoungah White est écrivaine et éditrice coréenne américaine. Elle est titulaire d’une licence en littérature anglaise de l’université de Cornell et est actuellement rédactrice en chef du Mouvement de Lausanne.
Traduit par Anne Haumont
–