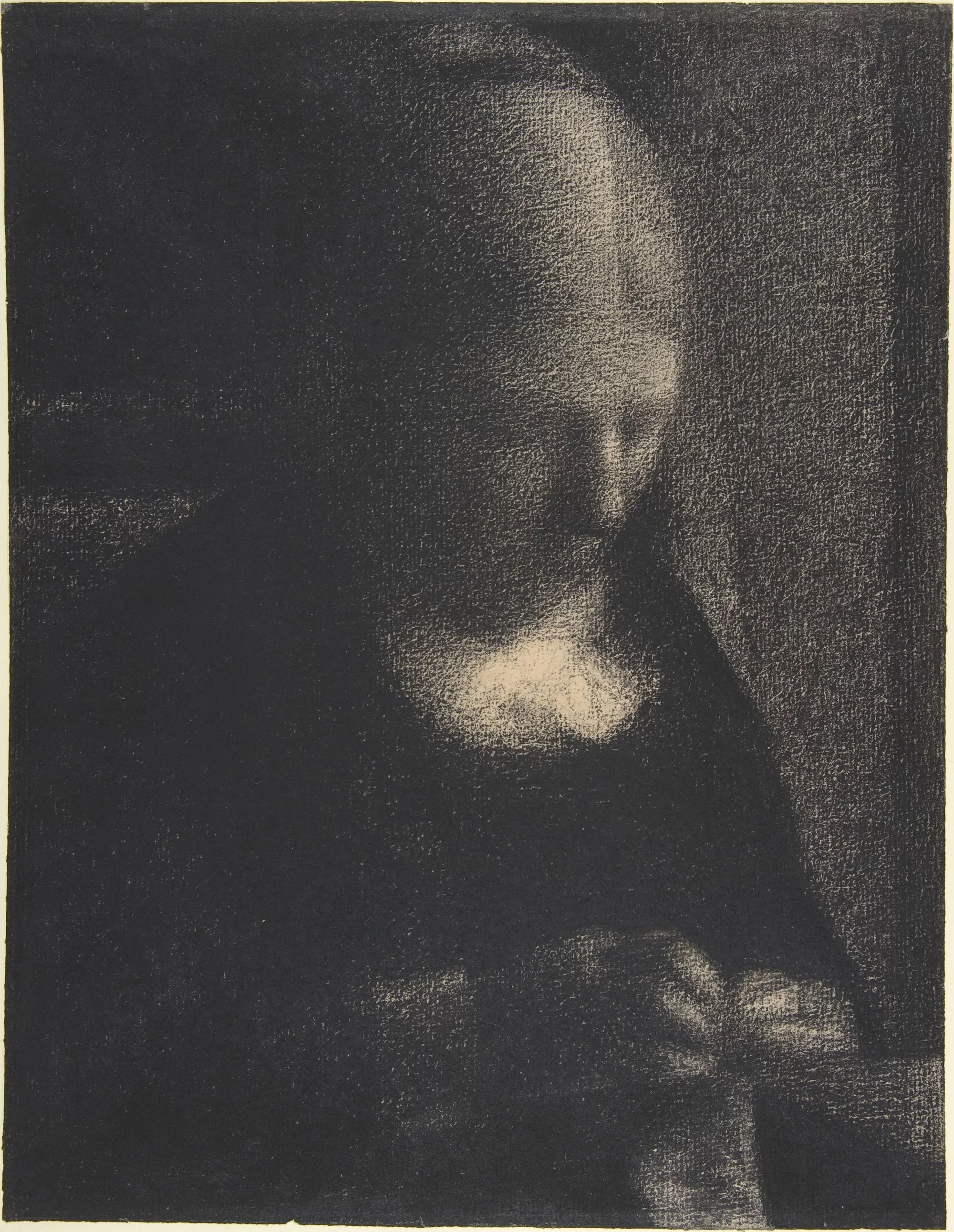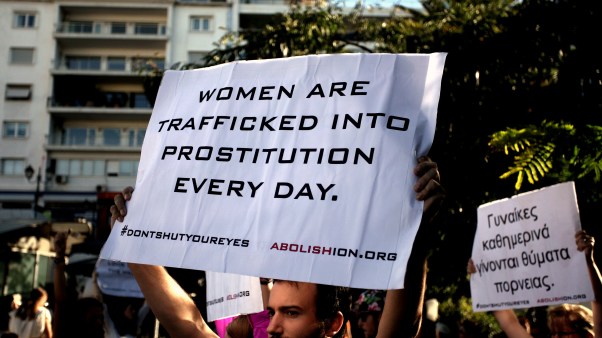Je trouve que les Allemands ont un mot qui résume parfaitement un sentiment qui m’habite ces derniers temps. Ils l’appellent Weltschmerz, tandis que les Français parlent de mal du siècle. Bien qu’ils me soient étrangers, ces mots décrivent un sentiment très familier : une douleur mélancolique au creux de l’estomac lorsque je réalise que le monde n’est pas comme il devrait être, que l’égoïsme et la cupidité envahissent les nations, que les humains sont capables d’actes de violence indescriptibles les uns envers les autres, que les choses les plus terribles peuvent se produire sans cause ni raison.
Aujourd’hui, je me suis tenue assise aux côtés d’une amie dont la fille est morte l’année dernière à l’âge de 11 jours. La mort d’un enfant est une douleur si insupportable qu’il est terrifiant de regarder ce chagrin dans les yeux, même de loin. Le fait que nous vivions dans un monde où une telle chose peut se produire suscite un malaise qui affleure à la surface pour beaucoup d’entre nous. Weltschmerz décrit cette prise de conscience, une sorte d’épiphanie où nous entrons en résonance avec ce que le philosophe Frederick C. Beiser définit comme « un sentiment de lassitude ou de tristesse à propos de la vie, découlant d’une conscience aiguë du mal et de la souffrance ».
Peut-être ce sentiment était-il plus facile à ignorer par le passé, lorsque les bannières des chaînes d’information câblées et les alertes des médias sociaux n’envahissaient pas nos espaces sécurisés. Pour beaucoup d’entre nous, le mal est désormais omniprésent et l’ombre de cette lassitude du monde peut grandir jusqu’à nous enserrer d’une manière qui n’était pas envisageable auparavant.
Comme de nombreux autres jeunes de la génération Y, j’ai été saisie par le sentiment aigu que le monde va de plus en plus mal et qu’une catastrophe se profile à chaque coin de rue. Des catastrophes climatiques à la polarisation, en passant par l’agitation politique et l’incertitude économique, nous avons été contraints de faire face à notre propre impuissance.
Je suis quelqu’un qui aime réparer les choses. Si je vois un problème ou si je suis témoin de la souffrance de quelqu’un, je ne peux pas m’empêcher d’essayer d’intervenir. Je suis devenue accro à l’approbation que l’on reçoit en jouant au héros. Mais une partie de l’inconfort du Weltschmerz consiste justement à prendre conscience que je ne peux pas réparer tout ce qu’il y a de brisé dans ce monde. Je suis soumise à cette précarité, incapable de m’en détacher. Offrir la plénitude à ce monde excède mes possibilités.
En cette période de carême qui nous mène à Pâques, je crois qu’il nous faut accepter que nous n’avons jamais réellement eu le contrôle des choses. Nous avons besoin de renoncer à une confiance en soi qui nous laisse à tort penser que nous pourrions être en mesure de réparer le monde au lieu de nous en remettre à Dieu, le seul capable d’arranger les choses. Comme l’écrit Saint-Augustin dans ses Confessions : « Mais vous, Seigneur, providence du ciel et de la terre, qui faites dériver à votre usage le lit profond du torrent et réglez le cours turbulent des siècles, même de la fureur d’une âme, vous avez apporté la guérison à une autre. »
Et pourtant, malgré la toute-puissance de Dieu, Jésus a pleuré. Le Dieu incarné, entré dans l’humanité, se tient à nos côtés lorsque nous rendons témoignage de la douleur et de la souffrance de ce monde. En ce temps de carême, nous nous souvenons de l’arrivée de Jésus à Béthanie les jours précédant sa mort, où Marthe et Marie sont dans la détresse, lui en voulant d’avoir laissé mourir leur frère Lazare. Jésus se tient avec elles dans leur tourmente émotionnelle et fait sienne leur douleur. Il pleure avec elles. Et dans le jardin de Gethsémané, lorsque Jésus supplie que lui soit enlevée la coupe de la souffrance et de la mort, il est dans une telle angoisse que sa sueur tombe comme des gouttes de sang. Non pas des larmes polies et contenues, mais un tourment qui monte du fond de son âme. C’est un Dieu qui pleure, un Dieu qui pleure de la manière la plus repoussante. Dieu connaît intimement la douleur du Weltschmerz.
Comment alors vivre en sachant que le monde n’est pas comme il devrait être, que nous ne sommes pas omnipotents, mais que Dieu l’est ? Peu de gens l’ont dit mieux que Fred Rogers, l’animateur d’une célèbre émission pour enfants : « Je suis assez convaincu que le royaume de Dieu est pour les cœurs brisés. Vous parlez d’« impuissance ». Bienvenue au club, nous n’avons pas le contrôle. C’est Dieu qui est au contrôle. »
On pourrait nous pardonner de répondre par l’apathie à cette lassitude du monde, de céder avec un haussement d’épaules à l’idée que « tout est vanité », comme on le lit dans l’Ecclésiaste. Mais nous savons que l’injustice du monde sera redressée par la venue du royaume de Dieu. Nous savons que nous ne devons pas nous affliger comme ceux qui n’ont pas d’espérance (1 Th 4.13).
Reconnaissant que nous vivons entre le déjà et le pas encore du royaume de Dieu, nous nous accrochons à notre espérance eschatologique que toutes choses seront faites nouvelles. Après la crucifixion de Jésus vient sa résurrection. La lumière fait irruption dans l’obscurité. Le voile de la souffrance, de l’obscurité et du désespoir est déchiré en deux.
En mettant fin à l’autosuffisance et à la confiance en nos propres forces qui nous laissent croire que nous sommes les seuls à pouvoir réparer les brisures de ce monde, en nous abandonnant à quelque chose — ou quelqu’un — de plus grand, nous échapperons à l’apathie stérile de ceux qui n’ont pas d’espoir. Jésus, dans le jardin, prie encore au milieu de sa douleur et de son angoisse. Jésus ne renonce pas à cette relation.
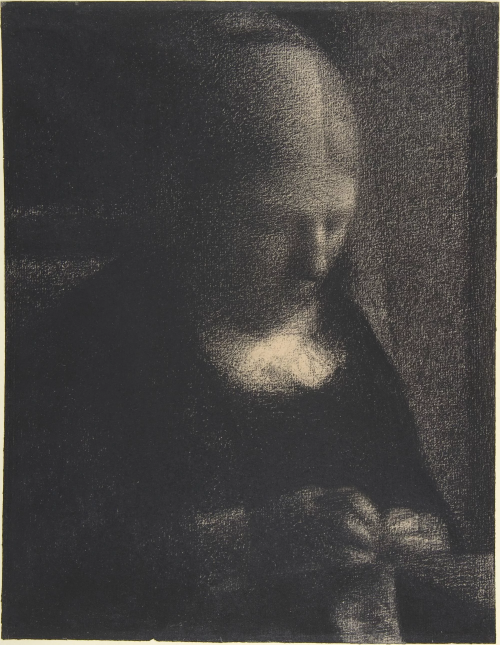 George Seurat/Wikimedia Commons
George Seurat/Wikimedia CommonsDieu est aux commandes, mais nous pouvons aussi jouer notre rôle. Plutôt que de nous abandonner au Weltschmerz, nous pouvons répondre présent au Dieu qui nous invite à collaborer à la construction de son royaume. Au lieu d’être paralysés par l’inaction et l’apathie, nous pouvons faire quelque chose — même la plus petite des choses — pour offrir à notre monde des lueurs de plénitude, de shalom.
Mon amie qui a vécu la mort tragique de sa petite fille l’année dernière a choisi de faire quelque chose plutôt que de se résigner à l’apathie existentielle que peut susciter une telle perte. Elle et son mari ont collecté des milliers de dollars pour l’hôpital où leur fille est décédée, qui serviront à financer des chambres dans lesquelles d’autres parents pourront séjourner pendant les premiers jours d’hospitalisation de leur enfant.
C’est à cela que ressemble l’espoir face à la lassitude du monde. Des prières ferventes au sein de l’angoisse du jardin de Gethsémané. L’action au lieu de l’apathie, l’amour au lieu de la haine, la prière au lieu du silence, et finalement la reconnaissance que, malgré la douleur familière du Weltschmerz qui affleure juste sous la surface, nous pouvons choisir l’espoir au lieu du désespoir, grâce à ce que Christ a fait sur la croix. Pour reprendre les mots de Jésus : « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage : moi, j’ai vaincu le monde. » (Jn 16.33)
Chine McDonald est écrivaine, contributrice radio et autrice de God Is Not a White Man: And Other Revelations. Elle est directrice de Theos, le principal groupe de réflexion britannique sur la religion et la société.
Cet article fait partie de notre série « À l’aube d’une vie nouvelle » qui vous propose des articles et des réflexions bibliques sur la signification de la mort et de la résurrection de Jésus pour aujourd’hui.
–