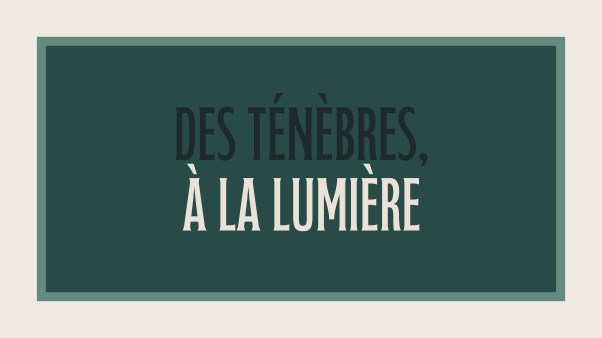Je déteste les affiches « Pass It On » (« Faites passer ») qui ont fleuri ces dernières années dans mon paysage. Avec leurs magnifiques photos de célébrités et leurs slogans positifs, elles veulent nous encourager à « faire passer » de belles valeurs à notre entourage. On y voit par exemple une superbe photo de Jane Goodall. Comme elle, soyons de bons intendants de la nature. Jamie Lee Curtis sort souriante de ses addictions. Nelson Mandela encourage à être inspirant, la Joconde à sourire et Abraham Lincoln à être de bons citoyens.
Si être américain était une religion, les affiches Pass It On seraient notre credo. À travers toute sorte de personnes en qui nous croyons collectivement, elles montrent ce qui, selon notre culture, devrait nous inspirer. Elles nous enjoignent d’aligner nos comportements sur ces célébrités.
En matière de croyances populaires, il est vrai que nous pourrions faire bien pire. Après tout, bon nombre des valeurs promues par cette campagne correspondent aux valeurs chrétiennes, ou du moins ne leur sont pas contraires : l’amour, le service, le courage, la confiance, la charité, le sacrifice. Même des valeurs plus discutables, comme l’ambition et l’innovation, ont des aspects positifs.
Alors pourquoi est-ce que ces panneaux me rebutent tellement ? Tout simplement parce que dans cette « religion », je ferais partie des damnés.
Prenons les affiches Pass It On qui mettent en scène des personnes infirmes ou atteintes de graves maladies, des personnes que moi, handicapée par une maladie chronique depuis l’âge de 27 ans, je serais censée prendre pour modèles. Je pense par exemple à la photo d’un diplômé de Harvard atteint de tétraplégie (Détermination : Faites passer !) ou à celle de l’acteur Michael J. Fox, atteint de la maladie de Parkinson (Optimisme : Faites passer !). Il y en a une sur la résilience, le dépassement de soi, l’inspiration, toutes ces qualités qui me font défaut. Où donc est la photo d’une personne malade qui pleure à chaudes larmes dans son oreiller ? Mode survie : Faites passer ! Ou la photo d’une personne malade qui attend désespérément près de son téléphone l’appel de quelqu’un, n’importe qui, qui l’appellerait pour lui dire bonjour ? Désespoir : Faites passer !
Si l’on en croit les panneaux d’affichage Pass It On, notre société préfère clairement les personnes malades fortes et inspirantes à celles qui sont tristes et en colère.
Je pensais que l’Église ne faisait que renforcer ces préférences.
Pensez, par exemple, à l’idée chrétienne de « bien souffrir ». Selon Marshall Segal, qui dirige à présent l’association Desiring God, fondée par John Piper, il s’agit de garder une foi inébranlable face aux épreuves tout en saisissant « l’opportunité remarquable d’encourager et d’inspirer d’autres croyants » à travers votre situation. Quand je pense à bien souffrir, je pense encore à des personnes comme Joni Eareckson Tada, cette artiste et autrice prolifique qui a fondé un ministère polyvalent pour les personnes handicapées, étant elle-même tétraplégique. Au début de ma maladie, elle venait de publier un recueil de méditations encourageant les chrétiens en souffrance à prendre l’habitude de chanter les louanges de Dieu. Si je trouve à présent ce recueil merveilleux, à l’époque, mon cœur n’était pas prêt à vivre selon ces préceptes.
Il est bon d’apprendre comment vivre la souffrance, et l’Église a raison d’honorer ceux qui endurent les moments difficiles avec une espérance inébranlable en Dieu. Après tout, le Christ a bien souffert en se soumettant à la volonté du Père et en « se dépouillant lui-même, prenant la forme d’un serviteur, devenant semblable aux hommes » et « se rendant obéissant jusqu’à la mort » (Phi 2.7-8). L’apprentissage d’un vécu chrétien de la souffrance est aussi au cœur du livre de Job qui n’a pas voulu maudire Dieu, alors même qu’il était assis dans la poussière et la cendre, couvert de furoncles qu’il grattait avec un tesson de poterie.
Mais il est évident pour moi que personne ne souffre « bien » tout le temps. Job a connu le désespoir : « Je crie vers toi, Dieu, mais tu ne réponds pas » (Job 30.20). Et je me situe moi-même plutôt à l’extrémité peu inspirante du spectre des chrétiens qui souffrent, trébuchant d’une crise de panique peu glorieuse à l’autre. Mon expérience quotidienne de la souffrance n’a rien à voir avec la joie de Paul dans la faiblesse ou les chants de louange de Joni Eareckson Tada.
Le Christ nous a sauvés par la grâce seule. « Bien souffrir » n’est dès lors heureusement pas un « must » de la vie chrétienne. Et il est normal d’être triste, en colère et probablement peu inspirant lorsque l’on traverse la vallée de l’ombre de la mort.
Alors pourquoi, quand je suis à l’église, est-ce que je me force à sourire ? Le dimanche matin, dans beaucoup d’églises très différentes, on estime que la question « Comment vas-tu ? » n’offre qu’un nombre limité de réponses possibles du type « Très bien », « Ca va bien » ou, à la limite, « Ca va ». Et si, dans quelques rares situations délicates, quelqu’un explique qu’il va mal, il s’entend souvent répondre quelque chose comme « Dieu fera tout concourir à ton bien », « Ceux qui espèrent en l’Éternel renouvellent leur force » ou « Dieu ne nous demande pas plus que nous ne pourrions supporter », cette dernière affirmation étant peu fidèle aux Écritures, voire souvent carrément fausse.
Ce n’est qu’il y a quelques mois que j’ai réalisé à quel point la fausse positivité était profondément enracinée dans ma propre église et dans mon cœur.
Ma communauté est petite, suffisamment petite pour que, pendant tout un temps, j’aie pensé en être la seule personne handicapée. Ainsi, lorsque je discutais avec quelqu’un avant ou après le culte, je prenais soin de minimiser les côtés pitoyables de mon expérience de la douleur chronique. Mes frères et sœurs ne pouvaient sûrement pas comprendre mon manque d’envie de prier, mon aversion pour la louange, ma honte constante de ne pas être plus forte. Ils semblaient toujours si heureux, si joyeux. Et lorsque je leur demandais comment ils allaient, ils me faisaient généralement une réponse positive standard.
Mais un dimanche, nous avons eu un moment spécial de prière pour la guérison. Je m’attendais à être l’une des seules personnes à m’avancer pour cette prière particulière. Il y avait bien dans l’église deux autres personnes souffrantes, mais, à part cela, j’avais l’impression que tout le monde allait bien.
Quelle ne fut pas ma surprise, lorsqu’après être retournée à ma place, une autre personne s’est levée pour recevoir la prière. Puis une autre. Et encore une autre. Une par une, près de la moitié de l’assemblée s’est avancée devant tout le monde pour demander à Dieu la guérison de l’une ou l’autre affection.
J’étais sous le choc. Se pouvait-il que la moitié des membres de mon église soit éprouvée autant que moi ? Et si tel était le cas, étais-je vraiment la seule à avoir autant de mal à supporter la souffrance ?
Au cours des semaines qui ont suivi, certaines personnes ont commencé à parler ouvertement de leurs difficultés. D’autres n’étaient pas prêtes. Mais cette expérience m’a ouvert les yeux. Comparés à moi, presque tous les membres de mon église m’avaient toujours semblé si équilibrés, si fidèles, si inspirants. Mais si, finalement, certains étaient aussi désespérés et incrédules que moi, je me trouvais soudain bien moins seule que je ne le pensais dans ma communauté. Et peut-être que si j’arrêtais de cacher mes difficultés aux autres, je pourrais trouver plus de réconfort face à la douleur.
Quelques dimanches plus tard, alors qu’on me demandait de diriger un moment de prière, j’ai décidé de faire tomber le masque, une fois pour toutes. J’ai commencé en partageant que je m’étais réveillée en larmes ce matin-là, terrifiée par une crise de douleur subie durant la nuit. J’étais terrifiée d’être aussi honnête avec les autres et de risquer le rejet ou, pire encore, des réponses banales.
Mais rien de tout cela ne s’est produit. Au contraire, ce jour-là, plusieurs personnes sont venues me voir avec des demandes de prière qui faisaient écho à mes peurs. Nous avons fini par avoir de nombreuses conversations sur notre difficulté commune à « bien souffrir », ce qui m’a vivement encouragée. Dieu avait ouvert des portes pour que nous soyons plus vrais les uns envers les autres.
Je ne veux pas dire que nous devrions systématiquement étaler tout notre linge sale en public lorsque nous venons prier le dimanche. Dans de nombreuses situations, la discrétion est de mise, et l’église ne remplace pas une thérapie.
Par ailleurs, beaucoup de mes frères et sœurs sont également en paix avec leur souffrance, et j’en suis reconnaissante pour eux. Ils reflètent l’image du travail que j’espère que Dieu accomplira dans mon propre cœur au fil du temps.
Mais pour l’instant, j’assume être une chrétienne qui ne supporte pas bien la souffrance. Même si les panneaux d’affichage tentent de le masquer, nous vivons à une époque anxiogène. Si l’Église veut offrir un espoir à notre monde, nous devons montrer nos souffrances honnêtement. De cette manière, elle sera un lieu accueillant non seulement pour les grands sourires, mais aussi pour les douleurs, les luttes et les pleurs.
Natalie Mead poursuit actuellement un master en beaux-arts tout en écrivant un mémoire sur la douleur chronique, les relations et la foi. Pour en savoir plus sur ses écrits, rendez-vous sur nataliemead.com.
Traduit par Anne Haumont