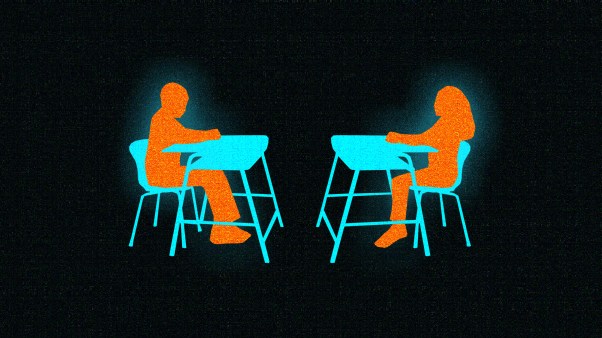Lorsque j’entre dans ce casino des Appalaches un vendredi soir, chacun de mes sens s’élargit sous l’assaut des stimulations. Dehors, l’air est frais. Le crépuscule tombe sur un parking tranquille rempli de pickups, de berlines et d’une limousine. Vénus est à peine visible dans le ciel.
À l’intérieur, en haut d’un escalator menant à une vaste salle, tout est englouti par un bruit semblable à celui d’un aigle hurlant ou d’un missile filant vers la terre. Et, au-dessus de moi, la voix d’Olivia Rodrigo chante : « Well, good for you, you look happy and healthy, Not me, if you ever cared to ask. » — « Tant mieux pour toi, tu as l’air heureux et en bonne santé. Moi pas, si jamais tu voulais poser la question. »
La salle est si grande qu’on a l’impression qu’elle pourrait se mesurer en hectares : rangée de machines après rangée de machines, des centaines de personnes jouent avec des combinaisons de mécanismes, de chiffres, de clics et de couleurs apparemment infinies, toutes fluorescentes. Chaque joueur, devant sa machine, adopte son propre rythme, plongé dans un monde entièrement clos.
Les machines enveloppent ces univers de mots qui s’enchaînent, comme les incantations des sorcières dans Macbeth : double-double, phénix, dragon, buffalo trouble, phénix (encore), platine, champagne, attaque de train, cash-cash-cash. Quelques joueurs un peu éméchés s’encouragent mutuellement autour d’une table de blackjack. Mise minimum : 25 dollars. Un peu plus loin, un homme en chemise à pois joue seul contre un croupier. Encore plus loin, une serveuse vêtue de noir apporte des boissons.
Le casino ne ferme jamais. Un mois ce printemps, il a encaissé 21 millions de dollars après avoir payé les gains. Un autre, il en a gagné 19 millions. Les habitants de cette ville ont un revenu médian de 44 700 dollars par an, plutôt bas sur la moyenne nationale. Le jeu continue, encore et encore.
Le temps est révolu où le jeu se passait à Las Vegas et restait à Las Vegas. « L’Amérique est désormais un grand casino », rapportait Business Insider en 2024. La plupart des États-Uniens vivent à moins d’une heure de route de machines à sous et de tables de blackjack et de craps. On compte plus de mille casinos dans le pays, et d’autres doivent encore ouvrir cette année et l’année prochaine dans plusieurs grandes métropoles comme Dallas-Fort Worth, New York et Chicago.
Et le jeu aux États-Unis ne se limite pas aux casinos. Quarante-cinq États ont mis en place des loteries publiques, transformant chaque station-service et chaque supermarché en point de jeu. Sur internet, on peut parier sur des événements réels : savoir si les États-Unis connaîtront une récession, le résultat d’un conclave au Vatican ou encore le sort du mariage de Jay-Z et Beyoncé.
Et puis il y a les paris sportifs. Ils étaient interdits par la loi fédérale jusqu’en 2018, lorsque la Cour suprême a statué que chaque État pouvait les légaliser s’il le souhaitait. Aujourd’hui, ils sont autorisés dans trente-huit États. C’est devenu le nouveau passe-temps favori de l’Amérique. Oubliez le base-ball, le football américain, le basket, le hockey, le football, le golf, le tennis, les arts martiaux mixtes ou les courses de voiture : désormais, on regarde les matchs pour parier sur les résultats. Les mises ont été multipliées par plus de dix en cinq ans, passant de 13 milliards de dollars en 2019 à 148 milliards en 2024.
Toutes ces pratiques soulèvent évidemment des questions morales et politiques. Mais en entrant dans ce casino situé à moins d’une heure de chez moi, je suis frappé par une interrogation plus fondamentale : qu’attendent exactement les Américains quand ils jouent ?
Je soupçonne que la réponse est spirituelle. À mes yeux, tous ces paris ressemblent à une prière irrépressible, mais mal orientée.
Philip est un ancien joueur compulsif en voie de rétablissement. Il travaille aujourd’hui dans une ligne d’assistance téléphonique pour les joueurs en difficulté. Il a contacté Christianity Today après que nous ayons publié un article montrant combien peu d’évangéliques s’attaquent réellement à la montée des paris sportifs, désirant partager son histoire. Philip avait l’habitude de parier sur des compétitions sportives depuis son téléphone. Il a gagné pendant un temps, puis il a perdu, encore perdu, et n’a plus pu s’arrêter.
Il pourrait perdre encore davantage. Il risque plusieurs années de prison pour avoir détourné de l’argent de son employeur — plus de 1,2 million de dollars en quatre mois — afin de continuer à jouer. En réfléchissant à ce qui a mal tourné, il estime qu’il y avait une raison spirituelle : son jeu était une soif mal orientée.
« J’y allais pour recevoir quelque chose — quelque chose qui comblerait un vide en moi », m’a confié Philip. « Je crois que toute addiction est une crise spirituelle. C’est tenter d’obtenir du monde ce que seul Dieu peut donner. »
Augustin approuverait. Le grand évêque africain affirmait que c’est là notre problème humain fondamental : nous cherchons l’éternel dans le transitoire. Nous voulons Dieu, mais ne savons pas où le chercher. Nous regardons autour de nous et nous voyons des choses, mais les choses changent toujours : elles sont instables, agitées — et nous le sommes aussi. Nous regardons en nous-mêmes et y voyons nos désirs, nos envies, notre soif. Mais même nos désirs ne sont pas stables. Nous croyons savoir ce que nous voulons, puis, en l’espace d’un instant, au retournement d’une carte, cela nous échappe.
« Élargis les filets de tes désirs insatiables, cupide », disait un jour Augustin dans une prédication. « Que tout ce que tu vois soit à toi ; que tout ce qui est sous les eaux et que tu ne vois pas soit à toi. Quand tu posséderas tout cela, que posséderas-tu en réalité si tu n’as pas Dieu ? »
Il est aisé de se perdre dans la convoitise. Les Américains s’y adonnent beaucoup ces dernières années, étendant largement leurs filets spirituels et attrapant toutes sortes de choses qui ne sont pas Jésus. L’identification à une religion organisée décline aux États-Unis depuis aussi longtemps que je peux m’en souvenir. Mais l’Amérique n’est pas devenue une nation de purs rationalistes qui ne croiraient qu’à ce qu’ils peuvent voir, toucher et tester. Au contraire, on assiste à un regain d’intérêt pour l’ésotérisme et tout ce qui pourrait promettre une forme de réenchantement du monde.

The country is awash in experiments with cosmic connection: grounding, crystals, yoga, chakras, channeling, astrology, and mNotre pays est inondé d’expérimentations en matière de connexion cosmique : ancrage, cristaux, yoga, chakras, médiumnité, astrologie, et bien d’autres encore. Les gens s’essaient à différentes idées du sens ultime et tentent de puiser dans l’ordre de l’univers pour ressentir une plénitude personnelle. Ils courent après des rumeurs d’anges, suivent des exorcistes sur TikTok, vivent des révélations de divinité à travers l’intelligence artificielle et en viennent même à se demander si les vampires existent.
Le sociologue Christian Smith décrit cette montée de l’expérimentation spirituelle comme une « occulture ». Aujourd’hui, explique-t-il, « un ensemble d’idées paranormales, magiques, occultes et New Age » a pénétré la vie quotidienne. Dans ses recherches pour son dernier livre, il a découvert que près de la moitié des Américains pensent que la réincarnation pourrait être réelle. Environ vingt pour cent affirment la même chose au sujet des sorts et des malédictions. Un quart des personnes interrogées croient fermement aux esprits de la nature ou aux énergies spirituelles, et près de quarante pour cent sont convaincus qu’il existe une force universelle comme le karma, qui récompense le bien et le mal et maintient l’équilibre. Près de la moitié se disent ouverts à la réalité des porte-bonheurs, des nombres fétiches et des symboles de chance.
Je crois pouvoir placer les jeux d’argent dans cette même catégorie culturelle. Pour beaucoup de joueurs, actionner une machine à sous, acheter un billet de loterie ou miser sur une compétition sportive est une tentative de trouver l’immuable dans le changeant, de s’accrocher à quelque chose de stable au milieu de motifs qui se transforment sans cesse.
Brian Koppelman parle lui aussi du jeu en termes spirituels. Il a écrit le film de poker Rounders, le film de braquage de casino Ocean’s Thirteen et la série télévisée Tilt sur les tournois de poker. D’origine juive, mais athée, il pratique aussi la méditation transcendantale. Et il considère que le jeu est, d’une certaine manière, spirituel. « Pour les personnes non religieuses », explique-t-il, « c’est une façon d’entrer en lien avec Dieu. »
Il ne s’agit pas seulement de gagner de l’argent. Le statisticien Nate Silver affirme que les joueurs sérieux et performants aiment bien sûr gagner. Mais ce qu’ils aiment vraiment, c’est le risque. Miser sur une partie, augmenter les enjeux, et soudain tout le reste disparaît : le jeu devient la seule chose qui compte au monde.
C’est aussi ce que vivent les joueurs moins fortunés. L’anthropologue Natasha Dow Schüll raconte que, lorsqu’elle a commencé à étudier les joueurs compulsifs accros aux machines à sous, elle pensait qu’ils étaient trompés, persuadés à tort qu’ils pouvaient battre les probabilités. Mais ils lui ont expliqué que ce n’était pas cela du tout.
Ce que ces joueurs recherchaient, plus que tout, c’était d’être en phase avec le jeu. Le fait de jouer leur permettait de se concentrer totalement, de bloquer le monde extérieur, ses problèmes et leurs propres soucis (y compris ceux créés par le jeu). Ils fusionnaient avec le rythme de la machine à sous et faisaient tout ce qu’il fallait pour rester immergés.
« Peu m’importe qu’elle prenne des pièces ou qu’elle en donne », a expliqué l’un d’eux à Schüll. « Le contrat, c’est que quand je mets une nouvelle pièce… j’ai le droit de continuer. » Un autre complète : « Quand je joue, je me sens connecté à la machine, comme si elle était une extension de moi, comme si, physiquement, il était impossible de me séparer d’elle. »
Au casino, je sors mon téléphone pour prendre des notes et je réalise que je suis le seul. Personne d’autre n’a de téléphone à la main. Tout le monde est concentré.
Je regarde une table de blackjack où tous les joueurs semblent perdre. Ils posent leurs mises : 25 dollars, 25, 25, 50, 25. Le croupier a un valet et un as : 21. Il rafle tout. Ils recommencent : 25 dollars, 25, 25, 50, 25. Cette fois, le croupier prend les jetons de quatre sur cinq joueurs, et ils rejouent encore, déposant leurs mises : 25, 25, 50, 50, 25.
Aucun n’a de téléphone posé sur la table pour y jeter un coup d’œil entre deux tours. Personne, à ce que je peux voir, ne met la main dans sa poche. Ils sont absorbés. Rien ne les distrait.
On dirait qu’ils méditent. Tout autour d’eux change, tourne, tourbillonne, dans un mouvement incessant. Le vacarme est assourdissant. Mais eux restent assis, comme s’ils s’étaient accrochés à quelque chose d’intemporel et comme s’ils ne voulaient jamais, au grand jamais, détourner leur regard.
Durant mon avant-dernière année à l’université Hillsdale, j’ai manqué d’argent et j’ai dû abandonner mes études. Je me suis installé en Pennsylvanie, où un ami suivait des études de théologie, et j’ai trouvé un emploi dans une station-service.
Mon travail consistait surtout à vendre des billets de loterie : tickets à gratter et tirages quotidiens où les clients misaient sur trois ou quatre chiffres. Ils me dictaient leurs listes, que je tapais dans une machine pour les imprimer. Beaucoup aimaient jouer le 222. D’autres misaient sur le 215 et le 610, les indicatifs locaux. Certains jouaient des dates importantes — anniversaires, mariages — ou simplement des nombres qu’ils appréciaient.
Parfois, à la fin de leur liste habituelle, les clients ajoutaient un numéro spécial, juste pour la journée. Je me souviens d’un dimanche après-midi où une femme noire d’âge moyen est entrée et m’a donné sa liste, avant d’ajouter : « Et mettez-moi le 828 et le 829. »
« D’accord », ai-je répondu, puis j’ai demandé : « Pourquoi ces numéros-là ? »
« C’est ce que le pasteur a prêché aujourd’hui », dit-elle. « Dans Romains : “Tout concourt au bien.” » (Rm 8.28)
Puis elle ajouta : « Encore un : mettez-moi le 3399. »
« Et celui-ci ? »
« Une sœur de l’église avait une nouvelle robe, elle a dit à tout le monde qu’elle l’avait eue en solde à 33,99 dollars. »
Il y avait aussi ce client, un homme blanc au nom italien qui dirigeait une entreprise de climatisation. Il achetait de l’essence et jouait le nombre de gallons qu’il venait de prendre. Une fois, il m’a demandé mon adresse. Quand je la lui ai donnée, il a joué ce numéro. Le lendemain, il est sorti au tirage, mais pas dans le bon ordre, et il m’a dit qu’il s’en voulait de ne pas avoir joué toutes les combinaisons possibles.
Les clients de la station-service avançaient dans la vie en cherchant des chiffres. Peut-être pensaient-ils que l’univers parlait en nombres et qu’en écoutant attentivement, vraiment attentivement, ils pouvaient s’accorder à sa vibration profonde.
Parfois, l’information leur venait d’un texte biblique — même si ce n’était pas le sens que j’y aurais entendu —, parfois d’une conversation de voisinage ou d’une plaque d’immatriculation aperçue dans un embouteillage. Quand ils gagnaient, ils avaient l’impression que le cosmos leur disait oui. Comme si le schéma secret les avait confirmés et bénis. La seule manière de comprendre cela, me semble-t-il, est d’y voir une forme de mysticisme, d’expérimentation spirituelle et d’« occulture ».
Il y a des époques dans l’histoire où le christianisme cesse de sembler crédible à certains groupes. De larges pans de la population se mettent à douter non seulement de la vérité de la théologie, mais surtout de l’efficacité des pratiques et disciplines de la vie chrétienne. Aller à l’église paraît inutile. La prière semble vide, mécanique. Écouter les pasteurs paraît stérile.
Beaucoup abandonnent tout. D’autres continuent, portés par la tradition ou l’obligation, sans expérience personnelle de transformation. Mais le désir profond de se relier à l’éternel au cœur du transitoire demeure chez tous. Alors, beaucoup se tournent vers d’autres techniques spirituelles.
Historiquement, les périodes de méfiance croissante envers le christianisme traditionnel, les Églises organisées et les autorités religieuses coïncident souvent avec une recrudescence du jeu. Quand de nombreux Américains se disent « spirituels, mais non religieux », un nombre croissant choisit de tenter sa chance… avec la chance.
L’historien Jackson Lears note que les protestants blancs du 19e siècle se sont tournés vers le jeu au moment où l’idée de la providence divine perdait son emprise sur l’imaginaire populaire. Quand les pasteurs puritains perdirent le pouvoir politique dans le Connecticut, par exemple, la vente de billets de loterie explosa. Le jeune P. T. Barnum, avant son célèbre cirque, se souvenait avoir vendu les billets aussi vite qu’il pouvait les imprimer. Quand les pasteurs regagnèrent ensuite un peu d’influence, l’une de leurs premières mesures fut de fermer les loteries, ruinant ainsi le commerce florissant de Barnum.
Pour ces puritains, la loterie relevait d’une hérésie. Ce n’était pas seulement un divertissement frivole ou une perte d’argent, mais une prétention théologique cachée : discerner un schéma divin derrière les numéros, comme si l’on accédait secrètement à la pensée de Dieu. Peut-être, disaient-ils, y eut-il un temps où connaître la volonté de Dieu passait par le tirage au sort, comme le firent les apôtres (Ac 1.26). Mais ce temps était révolu. Désormais, pour connaître la Providence, il fallait lire l’Écriture et consulter un pasteur.
Mais quand les gens ne faisaient plus confiance aux pasteurs ni à leur capacité d’expliquer l’ordre du dessein divin, ils se tournaient massivement vers les jeux de hasard. Après la guerre de Sécession, le pasteur unitarien Octavius Brooks Frothingham était consterné de voir des églises vides, mais des casinos bondés.
Entrant un jour dans un établissement de jeu, il observa un homme jouer à la roulette en tenant une petite boîte dont le fond était peint moitié rouge, moitié noir. L’homme y avait enfermé une araignée et regardait de quel côté elle se déplaçait pour savoir comment miser son argent.
Cet homme n’aurait pas écouté Frothingham ni aucun autre pasteur lui dire comment dépenser son argent ou orienter sa vie. Mais il faisait confiance à une araignée. Ou à un battement de cartes. Ou à une paire de dés. Il jouait à des jeux — mais ce n’étaient pas seulement des jeux, pour Frothingham. Pour cet homme, la boîte à dés était « la boîte du destin ». Le pasteur y voyait déjà une nouvelle spiritualité.
L’historien Jonathan Ebel a montré qu’une spiritualité similaire émergea parmi les soldats américains au front pendant la Première Guerre mondiale. Les autorités religieuses respectées — les pasteurs protestants les plus en vue du pays — expliquaient les horreurs de la guerre en termes de violence rédemptrice et de sacrifice héroïque. C’était, disaient-ils, une croisade pour la démocratie, une guerre pour mettre fin à toutes les guerres. Chaque mort était sainte, efficace, pleine de sens.
Mais beaucoup de ceux qui avaient vu la mort de près ne pouvaient concilier cette expérience avec une telle théologie. Rien n’avait de sens. L’un mourait, l’autre survivait, et c’était aléatoire. Alors, ils se tournèrent vers une spiritualité alternative : celle de la chance.
Certains soldats racontèrent même des expériences surnaturelles. Elmer Harden, un jeune homme du Massachusetts, parla à sa mère d’un être venu d’ailleurs qu’il décrivit comme un « homme-ange ». « J’ai su que c’était la Chance », écrivit-il, jurant que ce n’était ni son imagination ni un rêve, mais bien la vérité vécue. Il affirma avoir survécu aux combats uniquement grâce à cet être. « Ma foi en lui… était totale », dit Harden. « Il était mon Dieu. »
Selon Ebel, ce type d’expérience était rare, mais beaucoup avaient le sentiment de percevoir une force divine dans le caractère aléatoire du champ de bataille. Comme ils ne croyaient plus que l’ordre de l’univers pouvait se découvrir par la prédication, ils se tournaient vers le hasard, convaincus de pouvoir y discerner leur propre élection au milieu du chaos.
C’est la même spiritualité que j’ai observée chez les joueurs de la station-service. Ils voulaient toucher Dieu, même s’ils n’auraient pas employé ces mots. Ils voulaient s’accorder à une vérité immuable derrière toutes les choses éphémères qu’ils voyaient. Et ils croyaient pouvoir le faire en choisissant les bons numéros.
Au casino, j’observe trois amis d’une vingtaine d’années jouer au blackjack. L’un d’eux, petit, musclé, vêtu d’un T-shirt noir, gagne une main. Ses amis le frappent amicalement dans le dos et s’exclament « Kyle! » pour le féliciter. Puis ils rejouent. Kyle mise une pile de cinq ou six jetons. Il gagne encore, doublant ses 200 ou 225 dollars grâce à une main de 20 contre 17 pour le croupier.
Ses amis éclatent de joie, l’un manque de le faire tomber de son tabouret. Kyle se contente de sourire. C’est, me dis-je, le sourire de quelqu’un qui a le sentiment d’avoir été choisi. Il a trouvé sa résonance avec l’univers et rayonne comme quelqu’un de sûr que son élection est assurée.
Dan déteste cette idée. C’est un joueur professionnel qui a abandonné un doctorat en théologie pour jouer au blackjack. Avant cela, il suivait un cursus en philosophie morale, où il avait appris le poker. Un ami qui a étudié avec lui m’en a parlé. Je lui ai posé ma question : le jeu peut-il être envisagé comme une forme de spiritualité ?
Dan pousse un soupir. « Je n’aime pas les casinos. Il y règne beaucoup d’ondes déprimantes et malsaines. Si c’est ça le spirituel, alors non merci », m’a-t-il répondu.
Il passe pourtant beaucoup de temps dans les casinos, voyageant dans tout le pays pour jouer et gagner au blackjack. Mais l’émotion qui domine, dit-il, c’est la tristesse. Il l’enfouit pour pouvoir continuer à jouer. Car pour être un joueur professionnel, selon lui, il faut contrôler ses émotions.
La grande différence entre gagner et perdre, explique Dan, tient à la capacité d’éviter les « fuites ». Une fuite, c’est toute habitude qui fait perdre de l’argent : trop boire, miser impulsivement après une perte, donner de l’argent à un ami pour qu’il joue avec vous afin de ne pas vous sentir seul.
« Il faut être robotique. Tu dois t’entraîner à réagir comme si c’était juste une autre journée à la mine », dit Dan. Tout ce qui est trop humain devient une vulnérabilité.
À l’écouter, le blackjack est à moitié un jeu de comptage de cartes, à moitié un jeu de maîtrise de soi. Chaque partie confronte à un désir diffus. Carte après carte, la tentation est de s’attacher à une nouvelle illusion éphémère. Pour gagner, Dan doit résister à cette attraction spirituelle (et humaine), main après main.

Philip, l’ancien joueur en rétablissement, n’a pas su résister à la façon dont les paris sur son téléphone répondaient à sa soif spirituelle. Il a commencé en misant simplement sur son équipe universitaire de football, Florida State, pensant que le jeu rendrait le suivi du sport plus intense.
Puis le jeu lui a donné un sentiment de valeur : la joie de gagner, comme un signe positif de l’univers. Chaque pari en appelait un autre. Mais vite, une mise de 1 000 dollars devenait 2 500, puis 45 000. Il enchaînait, partait « en tilt », jusqu’à perdre plus de 220 000 dollars en trois ou quatre jours.
Il fréquentait une église évangélique à côté de son addiction au jeu, dit-il, mais c’était pure routine. Il préférait écouter des podcasts sur le stoïcisme. L’idée de maîtrise de soi lui plaisait, mais il en était incapable. Il pouvait parier sur 100 matchs en une journée, et 80 % de ses pensées étaient consacrées aux paris sportifs. La honte de son manque de retenue stoïcienne lui donnaient le sentiment d’être en train de se noyer.
Après son arrestation, la police le plaça une semaine sous surveillance contre le suicide. Il en est profondément reconnaissant. Privé de jeu, il avait peur de rester seul avec ses pensées. Dans sa cellule, il commença à prier.
« C’était brut. C’était juste moi qui demandais encore et encore à Dieu de m’aider », dit-il. « Finalement, j’ai eu la force de réciter le Notre Père. »
Son église l’a entouré et inscrit dans un programme de traitement. Il a passé six mois dans un groupe de rétablissement pour joueurs, puis a rejoint un groupe d’entraide général dans son église, avec des personnes dépendantes à la drogue, à l’alcool ou à la pornographie.
Il témoigne encore de son addiction et explique que, lorsqu’il est tenté, l’arme qui marche pour lui, c’est la prière.
« Là où j’aurais eu la compulsion de jouer, je transforme tout en prière », dit-il. « J’ai probablement prié 75 à 90 jours avant de voir un effet. Puis j’ai remarqué : wow, ça marche. »
Aujourd’hui, il commence par le Notre Père, puis prolonge avec ses propres mots. Désormais, il sait ce qu’il désire. Ce n’est pas un « quelque chose » mystique, une stabilité insaisissable dans le flux changeant. Il ne cherche pas à s’accorder à un ordre cosmique qui se dévoile un instant puis disparaît. Il veut Jésus.
Augustin écrivait dans ses Confessions : « Celui qui connaît la vérité connaît la lumière, et celui qui la connaît, connaît l’éternité. […] Vérité éternelle, amour véritable, éternité bien-aimée : tu es mon Dieu. »
Le casino est un tourbillon de sons, de lumières, de hasard et d’aspirations. « L’aspiration à la grâce reste au cœur de la culture de la chance », écrit l’historien Lears. L’espérance persiste : peut-être aurons-nous de la chance.
Je sais que Dieu peut répondre même à des prières folles. Dans le désert, les Israélites regardèrent un serpent d’airain et furent guéris (Nb 21.4-9). Gédéon demanda à Dieu d’imbiber une toison de rosée une nuit et de la laisser sèche une autre (Jg 6.36-40). Un eunuque éthiopien souhaita qu’on lui explique le prophète Ésaïe (Ac 8.31). Augustin voulait être chaste (mais pas tout de suite). Un ami à moi s’est converti après qu’une toilette bouchée a recraché une brosse à dents d’enfant.
« De même l’Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse », écrivait l’apôtre Paul. « En effet, nous ne savons pas ce qu’il convient de demander dans nos prières, mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l’Esprit. » (Rm 8.26-27).
Au casino, j’observe un croupier debout à une table vide, mélangeant les cartes en se préparant pour son service. Il porte sa tristesse comme un parfum. L’image de son visage enfant me traverse un instant l’esprit. « Seigneur, prends pitié de nous », pensé-je, cette prière que je répète quand je n’ai plus de mots. « Christ, prends pitié de nous. »
Un homme, casquette à l’envers, devant un jeu de craps automatique, plie imperceptiblement ses doigts pour déclencher un lancer de dés, encore et encore. Il cligne des yeux tous les trois lancers, comme sur un rythme. Je sors mon téléphone pour prendre note. « Seigneur, entends nos prières. »
Une femme joue au jeu du phénix où l’oiseau se relève dans des flammes pixelisées accompagné d’un cri digital. Elle porte une robe à fleur qui m’évoque Pâques. Plus loin, deux autres femmes, elles aussi en robes de Pâques, jouent sur d’autres machines. « Seigneur, entends nos prières. »
Dehors, les étoiles brillent. La nuit est tombée. Une deuxième limousine est garée près de la première, et un homme dans un pickup gratte un billet de loterie sur son volant.
Il y a tant de paris. Tant de désirs agités. « Seigneur, entends nos prières. »
Daniel Silliman est rédacteur en chef adjoint de CT.
Traduit par Jonathan Nabie.