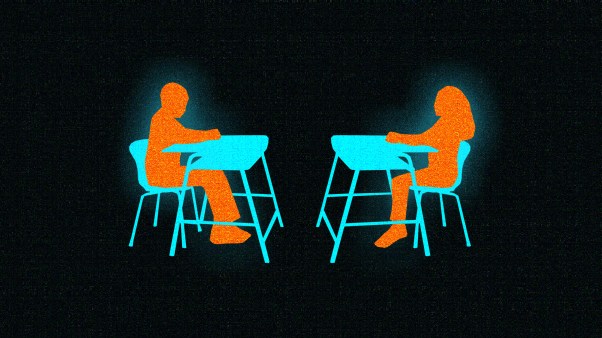Les moments les plus spirituellement formateurs de mon existence n’ont pas eu lieu dans le cadre d’un programme ciblant ma tranche d’âge. Ils ont eu lieu autour d’une table.
Sur la fin de ma vingtaine, Bill, un pasteur retraité de plus de 80 ans, m’a pris sous son aile. Nous ne nous sommes pas retrouvés autour d’un programme de l’église. Ensemble, nous avons pris des cafés, nous nous sommes baladés, nous avons bavardé des choses de la vie à la lumière de la grâce et de la vérité. Bill écoutait plus qu’il n’enseignait. Quand il parlait, ses paroles avaient du sens, car je pouvais déceler la vie qui se cachait derrière elles. Sa fidélité toute simple m’a aidé à imaginer comment moi-même suivre le Seigneur sur le long terme.
À cette même époque, où j’étais encore célibataire et continuais à découvrir ce qu’était la vie d’adulte, Lisa et Steve m’invitaient de temps en temps à manger. Nous partagions un repas pendant qu’ils nourrissaient leur bébé, coupant ses aliments en petits morceaux et essuyant régulièrement sa bouche barbouillée. Pas de programme d’études. Pas de discours hyper spirituel. Juste un aperçu tranquille et incarné de ce qu’est la patience, la vie de couple et la sérénité.
Voilà quelle a été ma formation, sans que jamais ce terme n’ait été utilisé. Et cette formation — lente, relationnelle, intergénérationnelle — me semble manquer dans de nombreuses églises. En essayant de se mettre au service des gens là où ils sont, certaines églises les ont classés par étape de vie — enfants, adolescents, jeunes adultes, retraités… — et les ont en quelque sorte isolés les uns des autres. La plupart des programmes partent de bonnes intentions et répondent à des besoins réels, mais il faut parfois s’arrêter pour évaluer si ce que l’on met en place n’aurait pas d’effet négatif.
Nous avons construit des systèmes qui relient les gens, mais les maintiennent séparés les uns des autres. Nous avons divisé les gens par affinités et fragmenté la formation spirituelle. Plus encore, nous avons subtilement enseigné aux gens une certaine manière d’aborder l’Église. Si nous construisons la vie communautaire autour de préférences personnelles et la présentons en termes d’expériences basées sur les affinités, l’Église apparaitra simplement comme un autre choix de consommation possible, où la commodité prend le pas sur la communion. Les gens s’y engageront selon leurs propres conditions plutôt que selon celles du Christ. Or, ce ne sont pas d’abord les programmes segmentés qui développent une maturité chrétienne profonde, mais bien une vie partagée entre les générations.
Le rapport de la société de sondages Barna de février 2025 intitulé « Discipleship Across Generations » révèle les conséquences négatives de cette tendance : alors que 87 % des chrétiens de plus de 55 ans affirment qu’il est important de continuer à grandir spirituellement, seuls 18 % déclarent que leur église les aide à créer des liens intergénérationnels.
Cette fragmentation n’était pas une stratégie intentionnelle au départ. Elle a été initiée comme un service à la société. L’école du dimanche, née en Angleterre à la fin du 18e siècle n’était pas une tactique de croissance de l’Église, mais une réponse évangélique au travail des enfants. Ceux-ci travaillaient de longues heures, six jours sur sept, sans avoir accès à l’enseignement. En réponse à ce problème, des fidèles ont renoncé à leur jour de repos pour leur offrir des cours d’alphabétisation et d’enseignement biblique. Ils allaient, non sans mal, à la rencontre des familles là où elles se trouvaient. Au fil du temps, cependant, l’action sociale s’est tournée vers l’intérieur et les programmes ont évolué vers des structures plus rigides et centrées uniquement sur le public des églises. Au milieu du 20e siècle, alors que les nouvelles théories éducatives et la culture de consommation façonnaient les institutions occidentales, les communautés ont emboîté le pas : elles ont organisé leurs ministères en fonction de l’âge de leurs fidèles, de leur période de vie et de leurs besoins présumés. Malheureusement, en reproduisant les catégories de la société, on hérite de son isolement.
Aujourd’hui, dans un contexte culturel déjà marqué par la solitude, par les écrans interposés et la méfiance entre les générations, nos structures cloisonnées risquent de renforcer les divisions que l’Évangile est pourtant censé dépasser. Paul insiste sur le fait qu’en Christ, il n’y a ni Juif, ni Grec, ni esclave, ni personne libre, ni homme ni femme (Ga 3.28). Nous pourrions ajouter : ni baby-boomer ni génération Z. En Christ, les anciennes catégories cèdent la place à un nouveau type de famille, unie non pas par l’âge ou les affinités, mais par la grâce.
Bien sûr, on peut trouver un précieux soutien auprès de ses pairs. Un de mes amis de la génération Z plaisantait en racontant que son groupe à l’église était le seul endroit où il pouvait rencontrer des filles qui aiment Jésus. Les personnes âgées trouvent du réconfort avec ceux et celles qui passent par les mêmes épreuves qu’elles : départ des enfants, regrets, deuils, soucis de santé… Les parents connaissent aussi le soulagement de pouvoir confier leur enfant à un bénévole qui sait comment s’y prendre. Je pense en ce sens à cette description que donne C. S. Lewis de l’amitié naissante qui nous fait soudain nous exclamer : « Quoi ! Toi aussi ? Je pensais être le seul. » Toutefois, si ces espaces cloisonnés ont leur place, ils ne sont pas l’objectif de l’Église et ne suffiront souvent pas à conduire vers la maturité chrétienne.
La psychologue Jean Twenge, spécialisée dans l’étude des générations, note que les divisions générationnelles d’aujourd’hui ne sont pas seulement culturelles, mais aussi numériques. Le temps passé derrière les écrans façonne profondément la manière dont les jeunes interagissent, apprennent et croient. Alors que la technologie redéfinit rapidement nos repères, un travail basé sur l’âge peut être crucial. Dans ce contexte, les responsables de jeunes qui comprennent ce qui provoque les addictions numériques constitueront un beau renfort pour les familles.
Nos affinités ne devraient cependant jamais constituer le fond de notre identité. Si l’on ne se rencontre qu’entre pairs, on court le risque de ne connaître que le calendrier des événements de l’église. On passe à côté de la famille qu’elle est censée constituer. Le danger n’est pas seulement l’isolement, mais aussi une dérive dans la formation des disciples de Christ. Lorsque l’église nous sert toujours ce que nous désirons en fonction de nos besoins et de notre étape de vie, alors la formation spirituelle devient elle aussi tout à fait sélective. L’individualisation constante nous présente l’Église comme un buffet où l’on choisit les services qui nous sont familiers, où nous privilégions les enseignements qui vont dans notre sens et où nous interagissons avec ceux et celles qui ont le même âge que nous.
Le résultat ? Notre formation spirituelle se fait sans les personnes qui pourraient pourtant nous aider le plus à mûrir dans notre ressemblance au Christ.
Les jeunes croyants aspirent à établir des relations avec des personnes plus âgées, mais pas si elles sont transactionnelles. Comme le décrivait un jeune de la génération Z : « Je sais que j’ai besoin de personnes plus âgées dans ma vie. Mais je ne sais pas comment les trouver. Et quand j’essaie, j’ai l’impression qu’elles ne m’écoutent pas vraiment. C’est comme si elles essayaient de m’enseigner plutôt que de communiquer avec moi, comme si j’étais un projet et non une personne. » Ce que les jeunes croyants recherchent, ce n’est pas une attention qui dissimule une critique. C’est une véritable présence relationnelle, un mentorat qui prend vie autour d’une table de cuisine, avec un bon café et une vraie conversation.
Certains croyants plus âgés hésitent à s’engager dans une relation avec des jeunes. Ils craignent un fossé culturel immense, des modes de communication inconnus et un rythme de vie épuisant. « Je ne veux pas trouver d’excuses ou paraître déconnecté », m’a dit un membre plus âgé de l’église. « Je ne sais tout simplement pas ce que les jeunes attendent d’un vieux de la vieille comme moi. »
Cette hésitation est compréhensible. Mais les Écritures offrent une perspective différente. À ceux qui craignent de paraître hors de propos ou dépassés, les Proverbes nous rappellent que « les cheveux gris sont une couronne de gloire ; ils s’acquièrent par une vie juste » (16.31). Il faut toute une vie pour acquérir la sagesse, et les jeunes croyants en ont besoin. Ils n’ont pas besoin de quelqu’un qui a toutes les réponses. Ils ont besoin de quelqu’un qui est passé par les questions.
Les jeunes croyants, de leur côté, ont peur d’être mal compris, regardés de haut ou pris à la légère. Mais Paul dit à Timothée : « Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle […] dans tes paroles, dans ta conduite, dans l’amour, dans la foi, dans la pureté » (1 Tm 4.12). La maturité spirituelle ne se mesure pas nécessairement à l’âge, mais à la fidélité.
Les relations multigénérationnelles connaîtront des moments délicats. Il y aura des rendez-vous manqués et des attentes incompatibles. Mais c’est peut-être aussi là leur sens. Nous n’avons pas seulement besoin de relations faciles. Nous avons besoin de relations qui nous font grandir. Et souvent, c’est précisément quand nous nous sentons désorientés que nous avons le plus besoin de nous approcher des autres.
Cette manière de grandir ne vient pas uniquement d’une doctrine. Elle vient d’une proximité de vie, de rythmes interrompus, de repas partagés, d’un long cheminement de foi quotidienne. Pour suivre Jésus à notre époque, nous avons besoin de voix modelées dans le passé. Et pour garder un cœur tendre dans un monde blasé, nous avons besoin des questions, de l’énergie et de l’urgence de la jeunesse.
Je ne dis pas qu’il faut supprimer nos divers programmes d’église. Mais peut-être faut-il repenser leur utilité. Les programmes sont efficaces lorsqu’ils soutiennent la vie communautaire, et non lorsqu’ils la remplacent.
Il est magnifique, pour moi, de voir les générations s’entremêler : une veuve à la retraite qui chante à côté d’un lycéen un dimanche matin, un aîné qui berce un nouveau-né afin qu’une maman épuisée puisse participer activement au culte, des jeunes qui aident un vieux couple à déménager et restent ensuite pour échanger des histoires sur la foi, le doute et la fidélité, des adultes célibataires et des familles qui échangent des encouragements, des conseils professionnels et des sujets de prière…
Ces moments ne sont pas le fruit d’une stratégie. Ils naissent d’un changement d’imaginaire, d’une volonté de ralentir, d’aller vers des personnes qui sont dans une autre saison de vie et de considérer l’Église non pas comme un ensemble de groupes de pairs, mais comme une famille déjà unie dans le Christ.
L’Église n’a jamais été conçue pour rassembler sous un même toit des générations menant des vies séparées. Elle est censée être une famille spirituelle. Certaines choses s’apprennent mieux en marchant aux côtés de quelqu’un qui a déjà parcouru un peu plus de chemin que nous. Certains fardeaux sont plus faciles à porter avec quelqu’un dont les épaules ne sont pas déjà courbées par le même poids.
Pour moi, tout a commencé quand quelqu’un m’a fait de la place. Bill m’a invité à me promener avec lui dans son jardin, à m’asseoir pour prendre un café, à partager sa table. Il n’a pas organisé de programme. Il s’est simplement manifesté, et a continué à m’offrir sa présence. Ce simple geste d’hospitalité est devenu pour moi un lieu sacré. Tout commence par une place à table.
Chris Poblete est directeur éditorial de CT Pastors chez Christianity Today.
Traduit par Anne Haumont