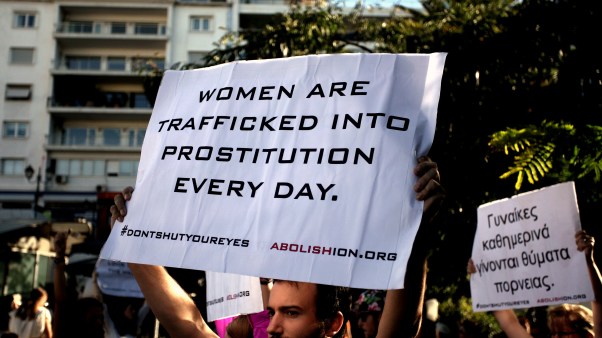Un de mes étudiants m’a récemment demandé depuis combien de temps j’enseignais la théologie. « Dix ans », ai-je répondu. Alors que je retournais m’asseoir à mon bureau, une question me trottait dans la tête : Qu’ai-je laissé à mes étudiants après une décennie ?
Dans mon égocentrisme de l’instant, je m’imaginais comme celui qui leur avait transmis le don de la connaissance. Mais en réalité, l’une des meilleures choses que j’ai pu faire est simplement de les équiper de la sagesse éprouvée de leurs prédécesseurs pour affronter les mers houleuses du ministère contemporain.
Plus j’enseigne, plus j’adhère à cette observation de C. S. Lewis : « La tâche de l’éducateur moderne n’est pas de défricher des jungles, mais d’irriguer des déserts ». Dans cette entreprise d’irrigation, il me semble cependant que de larges pans de la grande tradition chrétienne sont encore aujourd’hui délaissés par nos institutions théologiques.
Lorsque j’ai commencé mon doctorat en théologie dans un séminaire protestant, j’ai reçu une liste de lectures obligatoires. À l’époque, sur 128 livres, seuls trois (!) avaient été écrits par des auteurs prémodernes (du premier au quinzième siècle).
Même lorsque mon cursus s’est orienté vers l’histoire, les séminaires sautaient des Pères de l’Église aux Réformateurs avant d’avancer jusqu’à l’histoire moderne. La moitié — oui, la moitié — de l’histoire de l’Église a pourtant eu lieu au Moyen-Âge. Cette lacune dans ma formation apparaissait comme un gouffre béant. J’ai donc demandé à mon école de pouvoir élaborer ma propre étude indépendante de la théologie et de l’histoire médiévales.
Les choses ont-elles changé aujourd’hui ?
Christopher Cleveland raconte comment les séminaires évangéliques se sont attachés à remplacer les théologiens libéraux par des théologiens conservateurs. Dans le processus — par négligence ou évitement — « est née une génération de savants évangéliques qui n’avait aucune connaissance sérieuse des catégories classiques de la théologie développées dans la pensée orthodoxe patristique, médiévale et réformée ».
En tant que protestants, beaucoup d’entre nous ont appris que tout avait bien commencé dans l’Église primitive, mais qu’ensuite l’Église était entrée dans un âge de ténèbres. Heureusement, les Réformateurs ont rallumé la lumière et rétabli la véritable Église, perdue depuis l’époque des apôtres.
Nous imaginons à tort que les Réformateurs voulaient rompre totalement et radicalement avec le passé, fonder une nouvelle Église, plutôt que de chercher à renouveler l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Les conséquences pratiques de cette pensée sont très sérieuses : la plupart des protestants d’aujourd’hui n’ont aucune idée de ce qui s’est passé dans l’Église pendant près de mille ans. Pourtant, ils sont sûrs d’une chose : quoi qu’il se soit passé pendant l’ère prémoderne, cela ne vaut pas le temps que l’on pourrait y consacrer et ne peut que corrompre le christianisme.
Tel est l’état d’esprit de nombreux croyants, que l’on peut faire remonter aux prédications qui leur sont adressées depuis la chaire. Et puisque la plupart des pasteurs sont formés dans des institutions théologiques, la source du problème se trouve souvent dans la vision qui sous-tend celles-ci.
De l’extérieur du monde évangélique, on pourrait se demander comment une telle chose a pu se produire. Bon nombre de ceux qui ont fréquenté des institutions laïques peineraient à imaginer qu’on laisse subsister un tel gouffre. J’aimerais pouvoir dire que l’oubli est purement administratif, mais tel n’est pas le cas. Nous payons là les conséquences de notre mauvaise conception de l’histoire.
Alors, comment changer de cap ? La réponse passe par l’humilité.
Parmi les pasteurs et théologiens, C. S. Lewis est bien connu pour son célèbre livre Les fondements du christianisme, qui soulignait son attachement indéfectible à l’orthodoxie, terme par lequel il désignait le christianisme classique.
Pourtant, nombreux sont ceux qui oublient qu’au milieu de ce classique de l’apologétique, Lewis consacre deux chapitres entiers à retrouver les subtilités du Credo de Nicée et de sa doctrine de la génération éternelle. Lewis rédigea aussi une préface à l’une des plus grandes œuvres de l’histoire chrétienne, Sur l’Incarnation, du père de l’Église orientale Athanase.
Lewis recommandait — ou plutôt enjoignait vivement — aux modernes de sa génération de lire davantage de livres anciens. Il ne le faisait pas parce que ces auteurs prémodernes étaient exempts de défauts. Chaque génération a ses angles morts. Mais les angles morts de nos prédécesseurs ne sont pas toujours les nôtres.
« Aucun d’entre nous ne peut complètement échapper à cet aveuglement, mais nous l’accroîtrons assurément et affaiblirons notre protection contre lui si nous ne lisons que des livres modernes », écrivait Lewis. « Le seul remède est de laisser souffler dans nos esprits la brise rafraîchissante des siècles, et cela ne peut se faire qu’en lisant de vieux livres. »
Ainsi, Lewis revenait par exemple souvent à la vision du monde centrée sur Dieu de la théologie médiévale, qu’il considérait comme un antidote au cosmos désenchanté du modernisme sceptique de son époque. Comme le souligne Jason Baxter dans un récent livre, Lewis pensait qu’il était « de son devoir de sauver non pas tel ou tel auteur ancien, mais la sagesse générale du long Moyen-Âge, et de la vulgariser pour son monde ».
Lewis n’avait aucune patience pour le « snobisme chronologique » de son époque. Il craignait que ce mépris à l’égard du passé ne détruise l’orthodoxie chrétienne elle-même. Il y voyait non seulement le fruit de l’ignorance, mais aussi celui de l’irréligion.
Et nous devrions faire de même.
L’appel à la tradition n’est pas l’apanage de ceux qui pensent tout savoir. C’est tout le contraire : il faut pour cela avoir l’humilité d’arrêter de parler — obsédés que nous sommes par notre propre voix — et de commencer à écouter.
« La tradition refuse de se soumettre à la petite oligarchie arrogante de ceux qui ne font que se trouver sur terre », écrivait G. K. Chesterton dans Orthodoxie. Chesterton et Lewis appelaient tous deux leur génération à s’humilier et à prêter attention à la « démocratie des morts ». Sans cela, l’Église ne pourrait que glisser vers des hérésies, nouvelles et anciennes.
Beaucoup de nos prédécesseurs dans la foi voyaient les choses de la même manière, y compris à la tête de la Réforme protestante.
À l’époque, Rome accusait les Réformateurs d’être novateurs et donc hérétiques. On les mettait dans le même sac que certains sectaires radicaux de leur temps. Ces radicaux considéraient que l’Église s’était perdue dans les ténèbres depuis l’époque des apôtres jusqu’à leur propre arrivée. Ils prétendaient ne croire qu’en la Bible et méprisaient les penseurs anciens. Ces radicaux se considéraient comme la seule véritable Église.
Les Réformateurs rejetaient l’arrogance de tels radicaux et refusaient de leur être associés. Contrairement à ceux-ci, les Réformateurs n’étaient pas des rebelles et des révolutionnaires désireux de diviser l’Église — des schismatiques dans l’âme. Leur intention fondamentale était de renouveler l’Église, arguant que Rome n’avait pas le monopole de la catholicité.
Comme je l’explique dans The Reformation as Renewal, les Réformateurs faisaient constamment appel à l’Écriture, mais justifiaient leur interprétation de celle-ci en invoquant les théologiens du passé. L’Écriture était leur ultime cour d’appel, mais elle n’était pas leur seule autorité ; ils estimaient que l’Église était redevable à l’égard des credo, qui la gardaient fidèle au témoignage biblique lui-même.
Et s’ils émettaient de sérieuses critiques à l’égard de Rome sur des doctrines telles que le salut et les sacrements, ils exprimaient également leur accord sur de nombreuses autres doctrines. Le contraire aurait remis en question leur orthodoxie, confirmant ainsi les accusations de Rome.
Le spécialiste de la Réforme Richard Muller fait une observation qui donne à réfléchir : « La Réforme a modifié relativement peu » de doctrines majeures de la foi chrétienne.
Des doctrines telles que le salut et l’Église avaient besoin de sérieux correctifs. Cependant, des doctrines aussi centrales pour le christianisme que « Dieu, la Trinité, la création, la providence, la prédestination et les choses dernières ont été reprises par la Réforme magistérielle pratiquement sans modification », explique Muller. Pratiquement sans modification ! Les protestants sont-ils prêts à entendre cela ?
Non seulement nos pères protestants ont continué à s’appuyer sur la théologie des Pères de l’Église, mais ils étaient plus redevables envers les scolastiques médiévaux — notamment Thomas d’Aquin — qu’on ne le pense souvent.
Peu de théologiens dans l’histoire de l’Église ont perpétué les doctrines bibliques et orthodoxes de Dieu et du Christ avec une précision aussi habile que Thomas d’Aquin.
Je l’aborde donc fréquemment dans mon cours sur la Trinité dans le séminaire évangélique où j’enseigne. Chaque année, des étudiants me rapportent avec enthousiasme qu’ils ont fait une découverte surprenante : Thomas d’Aquin s’avère beaucoup plus orthodoxe sur la Trinité que certains évangéliques contemporains.
Mais un après-midi, en entrant dans ma classe, j’ai trouvé sur mon podium un chapelet géant, avec un crucifix et une note qui disait : « Pour le Dr Barrett ». Le message était clair : un professeur qui enseigne Thomas d’Aquin doit être un catholique romain convaincu.
J’aurais ri si je ne m’étais pas senti si désolé pour cet étudiant anonyme. Sommes-nous si peu sûrs de nous, en tant que protestants, que nous ne puissions bénéficier de l’un des plus grands esprits de l’histoire de l’Église — en particulier sur une doctrine aussi essentielle que la Trinité — simplement parce que nous ne sommes pas d’accord avec lui sur la sotériologie et l’ecclésiologie ?
Même nos ancêtres dans la Réforme étaient suffisamment sûrs de leurs convictions protestantes pour reprendre sa pensée de manière critique dans d’innombrables domaines — de l’interprétation biblique aux attributs de Dieu, en passant par la Trinité, l’éthique et l’eschatologie. Les théologiens réformés n’ont pas seulement utilisé Thomas d’Aquin contre les catholiques romains, mais Michael Horton a montré que beaucoup d’entre eux étaient encore plus thomistes que leurs adversaires.
Les théologiens évangéliques modernes qui évitent Thomas d’Aquin s’inspirent souvent de la scolastique protestante, comme le penseur puritain John Owen. Pourtant, la méthode et la théologie des scolastiques protestants étaient fidèles à l’orthodoxie biblique précisément parce qu’ils dépendaient de Thomas d’Aquin.
Ces liens sont si indéniables que Crossway, un éditeur évangélique, prévoit de publier un ensemble de plusieurs volumes sur Thomas d’Aquin pour les protestants — écrit par une équipe d’auteurs protestants.
Dans tout cela, il ne s’agit pas de sacraliser Thomas d’Aquin ou quelque autre penseur. Il s’agit de pouvoir entendre, de manière à la fois critique et humble, comment un tel penseur peut exprimer des idées intemporelles et transcendantes qui permettent de retrouver la bonté, la vérité et la beauté éternelles de Dieu dans notre monde désenchanté.
Nous évangéliques, avec nos penchants modernes, aimons souvent jouer aux juges, séparant les « bons » des « méchants » de l’histoire chrétienne. Ce faisant nous en aboutissons à vénérer les premiers et à éliminer les seconds. Cette approche de l’histoire est implacable pour créer des idoles et perpétuer la culture de l’annulation.
Un tel état d’esprit n’encourage pas seulement un sectarisme diviseur — où, en fin de compte, personne à part nous ne représente la véritable Église — mais il manque également d’empathie. Ses tenants se montrent incapables de comprendre la complexité des personnes, des mouvements, des institutions et d’époques entières du passé, et ne pourront guère en tirer des enseignements. Derrière ce type de jugement se cachent nos propres insécurités, nos agendas et notre volonté de préserver notre communauté.
Comme le dit l’adage, les gens ont toujours peur de ce qu’ils ne connaissent pas. Et cette peur de l’inconnu, masquée par une rhétorique de l’hostilité, se traduit dans la formation des responsables chrétiens de demain, ce qui a pour effet d’influencer l’ensemble des croyants.
J’ai récemment discuté avec un jeune profondément découragé par les évangéliques d’aujourd’hui — c’est-à-dire des évangéliques devenus fondamentalistes et indifférents ou méfiants à l’égard de tout ce qui est prémoderne — qui se demandait si le mouvement évangélique avait encore de véritables racines historiques à offrir.
Si les responsables évangéliques ne peuvent pas suivre l’exemple de leurs ancêtres protestants et affirmer que l’Église est catholique — « universelle » — la prochaine génération trouvera une autre confession qui le fera.
Le changement de cap est toujours un défi. Mais je crois que nous devrions commencer par le remède prescrit par Lewis pour laisser encore la rafraîchissante brise de l’orthodoxie souffler dans nos esprits.
Matthew Barrett est l’auteur de Simply Trinity: The Unmanipulated Father, Son, and Spirit (Baker Books), professeur associé de théologie chrétienne au Midwestern Baptist Theological Seminary, et animateur du podcast Credo.