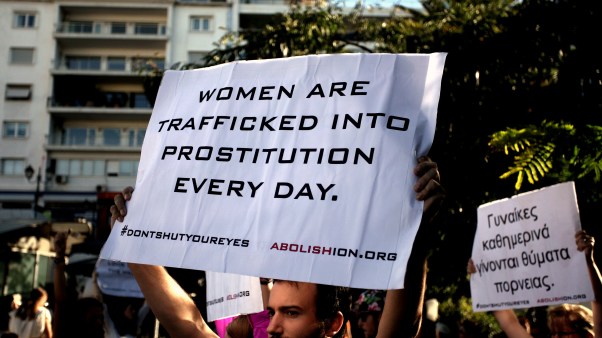« Qu’est-ce qui doit mourir dans notre vie ? » Pour le chrétien, la réponse paraît évidente : « le moi ». Jésus parle en effet ainsi à ses disciples, « Si quelqu’un veut me suivre, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive » (Luc 9.23 — BDS).
Nous avons tendance à entendre ces paroles comme un appel à renoncer aux appétits et aux désirs désordonnés du moi, et il y a certainement une part de vérité dans cette affirmation. Mais peut-être devrions-nous entendre les paroles de Jésus d’une manière plus radicale : comme une exhortation à abandonner les critères standards au moyen desquels nous évaluons et mesurons notre moi.
Nous vivons une ère technologique obsédée par la mesure de notre activité physique, de notre productivité intellectuelle, de notre santé émotionnelle et de notre utilité globale. Dans ce contexte, renoncer au moi en tant qu’entité mesurable — une entité dont la valeur peut être quantifiée, qui peut être jugée inefficace ou efficace, insignifiante ou influente, sans importance ou indispensable — a réellement quelque chose de radical.
Pourtant, l’Évangile de Luc nous oriente vers cette façon de lire les paroles de Jésus. À peine quelques versets après ces instructions, les disciples se disputent pour savoir « lequel d’entre eux était le plus grand ». Jésus répond en prenant un enfant sur ses genoux. Il met alors en avant une autre vision de soi : « celui qui est le plus petit parmi vous tous, c’est celui-là qui est grand » (Luc 9.48). Ce paradoxe este central dans l’économie du royaume de Dieu. Le renoncement à me pourvoir d’un moi considéré comme grand ou essentiel me donne la liberté de vivre fidèlement dans l’émerveillement et la gratitude de l’enfant.
Dans une sorte de parodie de livre de développement personnel intitulé Lost in the Cosmos, l’auteur américain Walker Percy propose une expérience de pensée liée à la question du suicide qui, malgré le caractère sensible du sujet, me semble pouvoir nous aider à ressentir le poids radical de l’appel de Jésus à renoncer à soi-même. Percy ne prend pas la réalité du suicide à la légère : son grand-père et son père s’étaient suicidés, et Percy pensait que la mort de sa mère dans un accident de voiture était également un suicide.
Alors que s’ôter la vie pourrait passer pour l’ultime renonciation à toute estime de soi, Percy envisage la chose différemment. En réponse à l’augmentation du nombre de dépressions et de suicides dans les années 1980 — problèmes qui n’ont fait que s’aggraver depuis — Percy invitait dans son texte un patient imaginaire tenté par le suicide à considérer cette éventualité : « vous êtes déprimé parce que vous avez toutes les raisons d’être déprimé. […] Vous vivez à une époque insensée — plus insensée que la normale, car malgré les grandes avancées scientifiques et technologiques, l’homme n’a pas la moindre idée de qui il est ou de ce qu’il fait. »
Ce que préconise Percy face à un désespoir si profond n’est pas de nier les nombreuses raisons valables de ce désespoir. Il appellerait plutôt à renoncer au mythe de notre indispensabilité. Dans son ouvrage, celui qui contemplerait le suicide est encouragé à confesser ceci : « Je ne suis pas indispensable ». Percy invite son interlocuteur à imaginer les suites de son suicide. Il énumère les conséquences probables de cet acte sur les membres de sa famille, ses voisins et ses collègues de travail. Malgré les perturbations que ce décès provoquerait, il en vient à cette conclusion : « en un temps étonnamment court, chacun retourne aux routines de son propre moi comme si vous n’aviez jamais existé. » D’où le résultat auquel il aboutit : « Après tout, vous n’êtes pas indispensable. »
Loin d’inciter à passer à l’acte, pour Percy, cette prise de conscience devrait enlever un immense fardeau des épaules de la personne souffrante : « Pourquoi ne pas vivre, au lieu de mourir ? Vous êtes libre pour cela. Vous êtes comme un prisonnier libéré de la cellule de sa vie. » Tous les autres peuvent encore être « malades d’inquiétude […] à propos de leur statut, de la nécessité de sauver la face, de leur estime de soi, des rivalités entre nations, de l’ennui, de l’anxiété, de la dépression dont ils cherchent notamment à se soulager dans les guerres et les catastrophes naturelles qui frappent régulièrement leurs voisins. » Mais celui qui a perçu sa non-indispensabilité est libéré des fardeaux d’un soi constamment incité à se mesurer. Ce que souligne Percy, c’est que la valeur intrinsèque de nos vies ne découle pas de notre productivité, de notre efficacité ou de l’importance que nous nous percevons ; lorsque nous mourons à ces façons de mesurer notre moi, s’ouvre la possibilité de vivre la vie comme un don incommensurable.
Percy conclut avec deux images mettant en contraste celui qui lutte encore contre la tentation de mettre fin à sa vie par désespoir et celui qui a envisagé la possibilité de se suicider puis a accueilli le caractère non indispensable de son existence :
Celui que tente le suicide est comme un petit aspirateur à soucis ambulant, aspirant les soucis du passé et aspiré par les soucis du futur. Il a le souffle court dans la poitrine.
L’ancien suicidaire ouvre sa porte d’entrée, s’assoit sur les marches et rit. Puisqu’il a la possibilité d’être mort, il n’a rien à perdre à être en vie. Il fait bon être en vie. Il se rend au travail parce qu’il n’est pas obligé de le faire.
Percy minimise peut-être ici les conséquences réelles de la mort d’une personne. La perte d’une personne humaine est une douleur profonde pour les membres de la famille et les proches. Bien que la vie puisse continuer, elle est irrévocablement altérée. Néanmoins, le fond de son propos subsiste : si nous abandonnons le moi devant sans cesse se mesurer, nous sommes libres de recevoir le moi donné, et ce changement a des implications profondes sur notre façon de vivre. L’abandon du moi mesurable détrône notamment l’idole de la grandeur — et la futilité paralysante qui l’accompagne — et nous permet de vivre fidèlement sans nous soucier de notre impact ou de notre importance potentiels.
 Henry Farrer/Wikimedia Commons
Henry Farrer/Wikimedia CommonsSi nous nous accrochons au mythe selon lequel nous sommes indispensables, que nous soyons individu ou institution, nous serons tentés par toute technologie ou tout mouvement politique qui promet d’étendre notre portée et de nous rendre plus efficaces. Si nous pensons que le succès dépend de nos efforts, nous nous tournerons vers les influenceurs de ce monde et les célébrités qui ont atteint une apparente grandeur. Quels outils utilisent-ils pour augmenter leur productivité ? Quelle application leur permet de maximiser leur impact ? Quelle stratégie politique ont-ils suivie ? Les aspirations à la grandeur peuvent justifier toutes sortes de moyens.
C’est précisément la tentation à laquelle Jésus a été confronté au début de son ministère, lorsque le Diable est venu à lui dans le désert. Jésus se voit offrir l’autorité sur tous les royaumes du monde s’il accepte simplement d’honorer le Diable (Luc 4.6-7). N’aurait-il pas pu atteindre le but de sa mission terrestre sans avoir à subir les souffrances et l’indignité de la passion ? Ce chemin aurait pu sembler beaucoup plus efficace ! Mais sa mission impliquait aussi la fidélité et l’obéissance au Père, qui l’ont conduit à Gethsémané et à Golgotha.
Le carême peut être l’occasion de prendre du recul — de faire un jeûne de nourriture, de médias sociaux ou d’autres moyens sur lesquels nous comptons pour mener un style de vie qui satisfait nos critères de réussite — et de reconsidérer si les outils que nous utilisons pour être efficaces sont en cohérence avec le chemin de la croix, le chemin du renoncement à soi, le chemin de Jésus.
Le revers de notre obsession de l’efficacité est un sentiment omniprésent de futilité et de désespoir : une autre personne ou institution semblera toujours réussir mieux que nous. Et même si nous résistons à la tentation de nous comparer aux autres, les problèmes de notre époque insensée planent au-dessus de nos têtes, nous intimidant par leur taille et écrasant tous nos maigres efforts. Pour utiliser le jargon d’une culture qui affirme et célèbre le moi mesurable, aucune « astuce de vie » ne vous permettra de « tirer parti » de vos atouts pour « faire la différence » ou « avoir un impact » sur des problèmes tels que le changement climatique, le racisme ou les apparents déclins de la foi. Ce sentiment de futilité peut induire un désespoir paralysant.
Mais en suivant Jésus et en renonçant au moi, nous retrouvons l’émerveillement et la vitalité enfantine que Percy espérait pour son ancien suicidaire. Pour transposer cette attitude dans les termes de mes exemples précédents, le fait de réaliser que vous n’avez pas à régler le problème du changement climatique vous permet de vous occuper joyeusement de votre jardin. Le fait de réaliser que vous n’avez pas à éradiquer le racisme vous libère pour écouter le vécu d’un ami d’une autre origine ethnique. Le fait de réaliser que vous n’êtes pas obligé d’inverser le déclin moral de la culture vous permet d’inviter des enfants du voisinage pour un après-midi de jeux. Réaliser que vous n’avez pas à sauver le monde vous libère pour aimer votre prochain.
Ce profond renoncement à l’importance de soi nous donne la confiance dont nous avons besoin pour rechercher la fidélité plutôt que l’influence, l’obéissance plutôt que l’efficacité. Ces normes à rebours de nos instincts influenceront profondément la façon dont nous décidons de la carrière à choisir, de la stratégie politique à suivre, de la technologie à adopter dans nos Églises et des modes de vie que nous embrassons.
Il n’y a rien de mal en soi à être efficace ou influent. Mais ces choses ne sont pas non plus bonnes en elles-mêmes. Et si nous considérons notre travail ou nos institutions comme irremplaçables, nous nous efforcerons sans cesse d’étendre leur portée. En revanche, si nous œuvrons comme ceux qui ont reconnu le caractère non indispensable de leur existence, nous travaillerons dans un esprit de gratitude. Comme nous le rappellent les rythmes sabbatiques, nous n’avons pas créé le monde, et ce n’est pas nous qui l’avons racheté de la servitude ; notre travail ne fait que participer à l’œuvre que Dieu a déjà accomplie.
Si Jésus n’a pas considéré « son égalité avec Dieu comme un butin à préserver », si Jésus « s’est dépouillé lui-même », ne devrions-nous pas d’autant plus renoncer à l’idée de notre propre importance (Ph 2.6-7) ? Dieu n’a pas besoin de moi pour accomplir ses desseins. Je ne suis aucunement indispensable. Jésus présente les enfants comme des exemples de cette attitude : les enfants sont bien souvent terriblement — ou délicieusement — inefficaces (Lc 9.47-48 ; 18.15-17). Ils ne paraissent faire aucun travail « essentiel » et entravent souvent la « productivité » des autres. En cela, ils nous rappellent que nous sommes appelés à mourir à nos visions de grandeur et à recevoir le royaume de Dieu avec la gratitude, l’émerveillement et la joie d’un petit enfant — ou d’un ex-suicidaire.
Vivons, parce que nous sommes morts. Entretenons nos jardins, prenons soin de nos familles, aimons nos voisins et mettons-nous au travail parce que nous sommes morts au moi mesurable et avons accueilli le moi donné.
« Si vous pensez au suicide, parlez-en à quelqu’un. Des lignes téléphoniques nationales dédiées sont à votre disposition. »
Jeff Bilbro est professeur associé d’anglais au Grove City College. Ses derniers ouvrages comprennent Reading the Times: A Literary and Theological Inquiry into the News et Loving God’s Wildness: the Christian Roots of Ecological Ethics in American Literature.
Cet article fait partie de notre série « À l’aube d’une vie nouvelle » qui vous propose des articles et des réflexions bibliques sur la signification de la mort et de la résurrection de Jésus pour aujourd’hui.
–