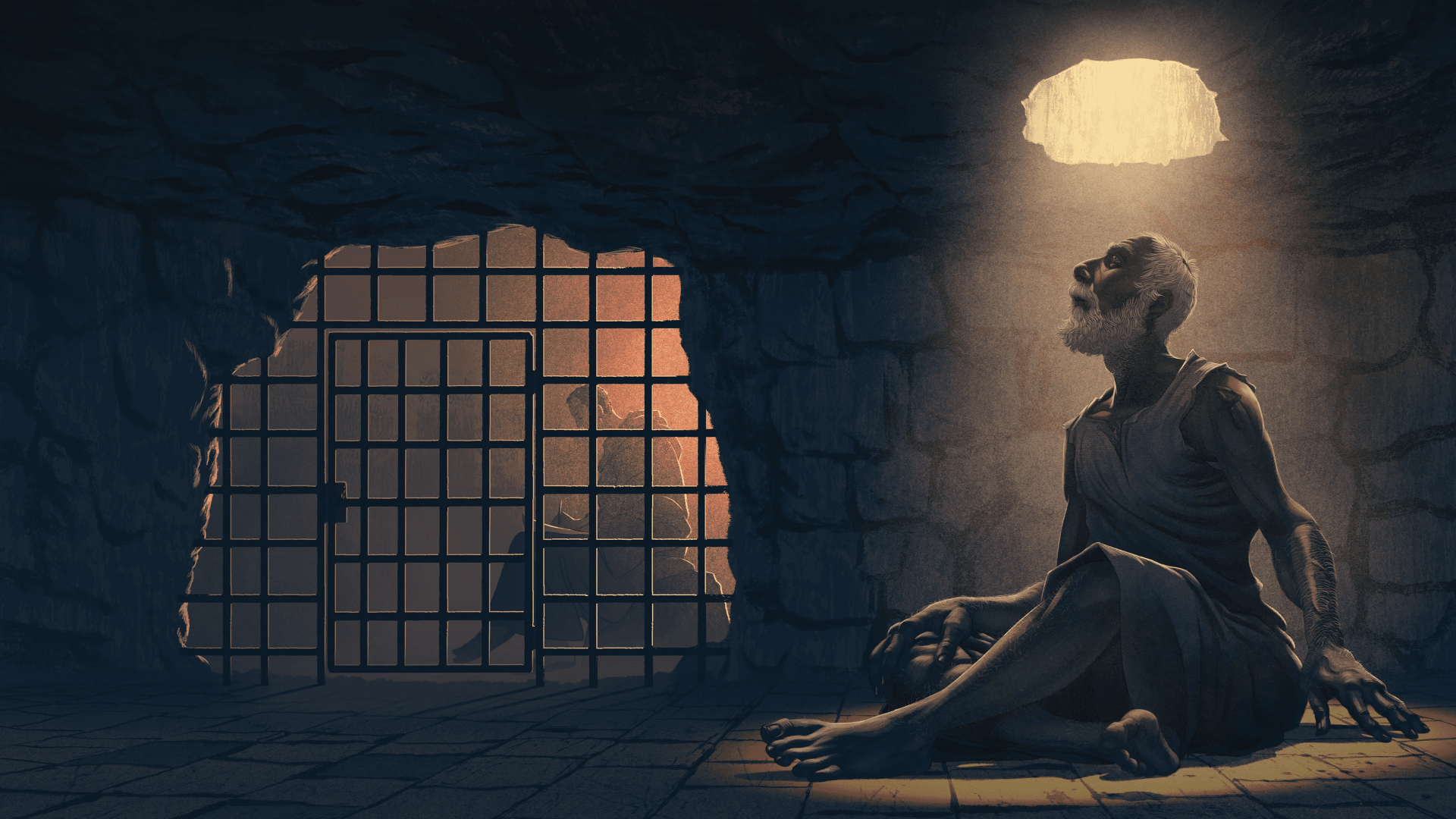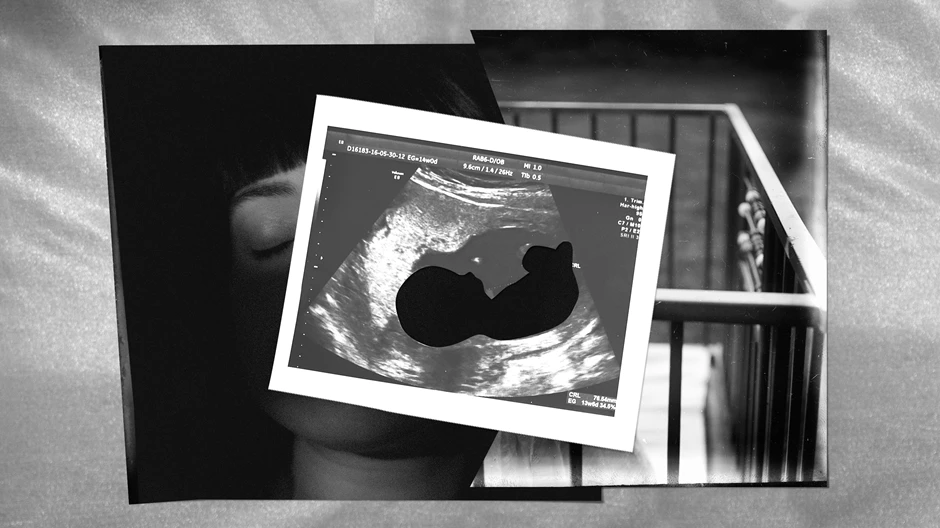Peu des nombreuses lettres écrites par l’apôtre Paul nous sont parvenues. Ce dont nous disposons est principalement composé de communications aux églises dans leur ensemble et de lettres adressées à des groupes de croyants dans des villes spécifiques. C’est logique. Ces lettres étaient lues publiquement et à plusieurs reprises ; elles étaient copiées, diffusées et beaucoup pourraient avoir été considérées comme partie de l’Écriture peu après que l’encre de leurs pages ait séché.
Paul a également envoyé de nombreuses lettres à des particuliers. En lisant ses écrits, on sent bien que l’on n’entrevoit qu’une fraction de son réseau relationnel et de son influence. Presque toutes ses lettres à des individus ont été perdues.
Mais il y a des exceptions.
Il ne paraît peut-être pas évident que des lettres personnelles trouvent leur place dans le canon. Le fait d’être associées à une figure importante, au responsable d’une grande communauté, a probablement aidé. Timothée, par exemple, semble avoir été un responsable de premier plan pour la deuxième génération de l’Église. Il a été évêque d’Éphèse, une grande ville de l’Empire romain et un centre important pour le christianisme. Tite était un pilier de la mission auprès des non-Juifs et a servi comme évêque de Crète. L’inclusion dans le canon des lettres qui ont gardé leurs noms pouvait être soutenue par d’importantes communautés.
Par contre, la préservation de la lettre de Paul à Philémon, responsable d’une église de maison dans la petite ville de Colosses, a quelque chose d’un mystère. C’est la lettre la plus personnelle que nous ayons de Paul. Elle ne comporte que 25 versets.
Cette lettre nous révèle une histoire. Un homme nommé Onésime s’est enfui de chez son maître Philémon. Onésime était probablement un esclave domestique, un serviteur haut placé dans la hiérarchie. Parler d’esclave en fuite correspond donc bien à une réalité, mais pourrait induire en erreur les lecteurs modernes qui imagineraient un Onésime dans une fuite désespérée vers la liberté.
Divers spécialistes estiment plutôt qu’Onésime s’est rendu auprès de Paul avec le projet de retourner plus tard auprès de son maître. Steven M. Baugh, professeur émérite de Nouveau Testament au Westminster Seminary, en Californie, écrit : « Il semble très probable qu’Onésime se soit enfui de chez Philémon avec l’intention de retrouver Paul pour demander son intercession en sa faveur […] dans le contexte d’une querelle entre maître et esclave. Cette lettre est l’intercession de Paul. »
Il peut être difficile aujourd’hui de comprendre pourquoi Onésime aurait pu vouloir retourner à l’esclavage. Mais l’explication est simple : si Onésime occupait un poste important auprès de son riche propriétaire, il y avait peu de chance qu’il ait le désir de troquer celui-ci pour une vie de pauvre paysan. « Les esclaves appartenant aux foyers de personnes riches ou moyennement riches menaient d’une certaine manière une vie meilleure que les pauvres libres de la ville », écritl’historien James S. Jeffers dans The Greco-Roman World of the New Testament Era. « Contrairement aux pauvres libres, ces esclaves bénéficiaient normalement de trois repas par jour, d’un logement, de vêtements et de soins de santé. » De nombreux esclaves, ajoute Jeffers, « étaient mieux formés que les pauvres nés libres ».
Ceci dit, l’interprétation traditionnelle et la plus courante de l’histoire est qu’Onésime s’était emparé de l’argent de Philémon et n’avait pas l’intention de repartir.
Et il y aurait pu avoir beaucoup d’argent. De nombreux esclaves ayant le sens de l’organisation et des affaires étaient chargés de superviser les entreprises de leurs maîtres. Ils étaient connus sous le nom d’oikonomos (à l’origine de notre mot « économie »), ou intendants.
Philémon, un riche homme d’affaires converti au christianisme suite au témoignage de Paul, vivait à Colosses. Il avait probablement un certain nombre d’esclaves pour l’aider dans ses entreprises. En raison du risque de vol sur la route entre les grandes villes commerciales, les hommes comme Philémon ne voyageaient pas eux-mêmes avec leurs marchandises. Au lieu de cela, ils confiaient cette tâche à des esclaves de confiance comme Onésime.
Dans un tel cas, on pourrait imaginer que, au lieu de retourner chez Philémon avec son argent, Onésime aurait empoché le gain et sauté dans un bateau pour Rome. C’est ainsi qu’on le retrouverait finalement auprès de Paul, le servant en prison et devenant un disciple du Christ sous sa conduite.
Il est impossible de dire si Onésime a fui pour chercher Paul ou s’il en est venu à entendre parler de lui par l’intermédiaire des chrétiens de Rome. Mais il paraît étrange qu’un esclave en fuite passe autant de temps auprès d’un personnage religieux sous bonne garde, assigné à résidence et entouré d’agents de l’État.
Pourquoi Onésime a-t-il pris le risque d’aller voir Paul ? C’est un peu comme s’il avait su quelque chose sur Paul que nous avons oublié.
Dans les décennies précédant la naissance de Jésus, une agitation certaine régnait dans le nord d’Israël. Le pays était un foyer de résistance et de soulèvements contre Rome, entre révoltes armées et vols dans les dépôts où étaient stockés les fruits des odieuses taxes de l’occupant.
Mais Rome n’en était pas à ses débuts. Garder les peuples soumis est tout un art, et l’Empire avait des siècles d’expérience en la matière. Les commandants insurgés étaient exécutés par des moyens horribles tels que la crucifixion ou l’empalement. Rome savait qu’il ne suffisait pas de couper la tête. Pour étouffer la rébellion, ce sont des communautés entières qu’il fallait reprendre en main.
Ainsi, comme le raconte l’historien Josèphe, Rome commença à mettre à sac des villages rebelles entiers et à vendre leurs habitants comme esclaves sur ses nombreux marchés. À cette époque, des marchands d’esclaves suivaient souvent les légions romaines lors des campagnes militaires, recueillant le butin humain et remplissant les coffres de l’Empire.
Un village de Galilée allait particulièrement gêner Rome au cours de la centaine d’années entourant la résurrection du Christ : Gischala, situé à l’extrême nord du pays.
Après quelque infraction commise aux abords du tournant de l’ère chrétienne et dont les détails ont été oubliés par l’histoire, les Romains rassemblèrent les habitants de Gischala, les embarquèrent et les réduisirent en esclavage.
Si la mémoire de l’Église primitive est correcte, les parents de Paul étaient parmi eux.
En l’an 382, le pape charge un jeune érudit étonnamment brillant, Jérôme, de mettre à jour l’ancienne Bible latine. Les érudits connaissant le grec étaient rares, et Jérôme était l’un des rares à maîtriser également l’hébreu.
Deux décennies plus tard, dans un monastère de Bethléem, il achevait la tâche monumentale de la traduction de la Vulgate, la version de la Bible la plus influente de l’histoire. Il écrivit également, entre autres, quatre commentaires sur les lettres de Paul.
Dans son commentaire sur Philémon, Jérôme évoque ce souvenir que l’Église primitive avait de Paul :
On dit que les parents de l’apôtre Paul étaient originaires de Gischala, une région de Judée, et que, lorsque toute la province fut dévastée par la main de Rome et que les Juifs furent dispersés dans le monde entier, ils furent transférés à Tarse, une ville de Cilicie.
Le latin fuisse translatos du commentaire de Jérôme à propos des parents de Paul transférés à Tarse pourrait aussi être traduit par « furent emmenés », ou pris contre leur gré.
On a parfois fait l’hypothèse que les ancêtres de Paul étaient simplement des entrepreneurs opportunistes. Ils auraient quitté Israël parce que le travail du cuir et la fabrication de tentes étaient plus rentables dans un grand centre romain comme Tarse.
Mais ce n’est pas ce que disait l’Église primitive.
L’euphémisme « emmené » signifie que Rome a traité les parents de Paul comme elle le faisait presque toujours avec les rebelles. Selon le chercheur allemand Theodor Zahn, ils avaient été « faits prisonniers de guerre » et vendus comme esclaves à Tarse. Paul était peut-être un enfant à l’époque, dit Zahn, ou peut-être est-il né au milieu des obligations de l’esclavage de ses parents.
L’esclavage romain n’était cependant pas le même que celui de la traite des Noirs. « Les citoyens romains libéraient souvent leurs esclaves », écrit Jeffers. « Dans les foyers urbains, cela se produisait souvent lorsque l’esclave atteignait l’âge de 30 ans. On connaît peu d’esclaves urbains qui ont atteint un âge avancé avant de gagner leur liberté. »
Selon la spécialiste Mary Beard, beaucoup à l’époque considéraient ce passage de l’esclavage à la citoyenneté comme un trait distinctif de la réussite de Rome. Elle écrit : « Certains historiens estiment qu’au deuxième siècle de notre ère, la majorité des citoyens libres de la ville de Rome avaient des esclaves parmi leurs ancêtres. »
C’est pour cette raison que de nombreuses traductions de la Bible ont choisi d’utiliser le terme de serviteur plutôt que celui d’esclave pour parler de cette réalité. L’asservissement est assurément un affront flagrant aux droits de l’homme. Mais l’esclavage du Nouveau Testament n’était pas le type d’esclavage auquel nos contemporains pensent souvent. L’esclavage romain avait généralement une fin. Dans de nombreux cas, il créait même des opportunités de promotion sociale, en particulier pour les enfants d’esclaves.
Quelques siècles après Jérôme, Photius 1er, évêque de Constantinople, fit le tour de sa célèbre bibliothèque et en retira des volumes et des documents qui ont depuis lors été engloutis dans les sables du temps. Seule sa lettre évoquant ces documents a été conservée. S’inspirant non pas de Jérôme, mais d’une autre source de l’Église primitive que les historiens n’ont pas encore identifiée, il écrit :
Paul, le divin apôtre […] qui avait pris pour patrie la Jérusalem d’en haut, avait aussi pour part la patrie de ses ancêtres et de sa race physique, à savoir Gischala (qui est aujourd’hui un village de la région de Judée, autrefois considéré comme une petite ville). Mais comme ses parents, ainsi que beaucoup d’autres de sa race, furent faits prisonniers par la lance romaine et que Tarse lui fut échue et qu’il y naquit, il la nomme comme patrie.
Photius fait naître Paul à Tarse, de parents esclaves. Ce n’est pas parce qu’une tradition dit quelque chose que celle-ci est vraie. De nombreuses traditions ne correspondent pas à l’Écriture et doivent être laissées de côté.
Mais pas celle-ci.
Jerome Murphy-O’Connor, spécialiste de Paul et professeur de Nouveau Testament à l’École biblique de Jérusalem, écritque « la probabilité que [Photius] ou tout autre chrétien antérieur ait inventé cette association de la famille de Paul avec Gischala est faible. La ville n’est pas mentionnée dans la Bible. Elle n’a aucun rapport avec Benjamin. Elle n’a aucun lien avec le ministère galiléen de Jésus. »
Pour le dire autrement : si vous vouliez inventer une légende sur les origines de Paul, vous devriez trouver quelque chose de plus intéressant. Vous le situeriez à un endroit important, avec une histoire qui cimenterait son ancrage dans le récit biblique. Pas dans une ville obscure qui n’apparaît même pas dans les Écritures.
En matière de traditions historiques de l’Église, celle-ci semble aussi fiable qu’on puisse l’espérer. Des spécialistes allemands comme Zahn et Adolf von Harnack qualifient ce type de détail d’unerfindbar, « ininventable ». En somme, la chose apparaît comme trop précise pour avoir été créée de toutes pièces.
L’une des grandes énigmes de la recherche paulinienne est de savoir pourquoi peu d’experts dans le monde anglophone en parlent. Douglas Moo, éminent spécialiste de Paul au Wheaton College, déclarait dans une interview : « Je n’ai trouvé que très peu d’ouvrages sur Paul qui en fassent même simplement mention ». Dans sa biographie de Paul, N. T. Wright estime assez légèrement qu’il s’agit d’une « légende tardive ».
Mais il n’y a pas là grand-chose d’une légende et l’on peut difficilement qualifier l’information de tardive.

Les spécialistes de Jérôme et d’Origène, un autre père de l’Église primitive, s’accordent à dire que la déclaration de Jérôme sur les parents de Paul, écrite en l’an 386, n’est pas de son propre fond. En fait, peu de choses dans le commentaire de Jérôme sont originales.
Ronald E. Heine, spécialiste d’Origène à l’université Bushnell, estime que « Jérôme fait surtout de la traduction d’Origène ». Caroline Bammel, historienne de l’Église ancienne à Cambridge, considère plus crûment que le travail de Jérôme dans ses commentaires est « largement plagié d’Origène ».
Le commentaire d’Origène sur Philémon, comme une grande partie de son œuvre, a été perdu. Mais en observant les traductions — ou appropriations — d’autres commentaires d’Origène par Jérôme, les chercheurs sont certains qu’il provient d’Origène. « Dans ce commentaire, nous avons l’exposé d’Origène revêtu de l’habit du latin de Jérôme », écrit Heine.
Cela situe cette tradition sur l’origine de Paul non pas à l’époque de Jérôme, mais à celle d’Origène, au début des années 200. Origène écrivait à Césarée, à proximité de la Galilée et dans une ville où Paul a passé deux ans (Ac 23.23-24 ; 24.27). Les plus âgés des conteurs qui l’entouraient et préservaient la tradition orale avaient grandi sous la conduite des deuxième et troisième générations de l’Église.
Loin d’une légende tardive, il s’agit de la « première explication connue de l’Épître à Philémon », écrit Heine. « Selon toute vraisemblance, il s’agit du premier commentaire jamais écrit sur l’épître. »
Dans le monde académique allemand, l’idée que Paul était un esclave affranchi fait l’objet de discussions animées depuis déjà 150 ans. Au 20e siècle, d’éminents spécialistes tels que Von Harnack et Zahn, ainsi que Martin Dibelius, ont apporté leur crédit à l’histoire de Jérôme.
De nombreux autres chercheurs allemands « prennent au sérieux l’affirmation selon laquelle les parents de Paul venaient de Galilée », écrit le théologien Rainer Riesner, qui enseigne aujourd’hui à l’université de Dortmund. Certains vont même jusqu’à penser pouvoir identifier la rébellion galiléenne qui aurait conduit à l’asservissement de ses parents : le soulèvement de l’an 4 avant Jésus-Christ, lorsque Varus, gouverneur romain de la Syrie, brûla des villes entières et crucifia 2 000 personnes. Dans des villes galiléennes comme Sepphoris, écrit Josèphe dans ses Antiquités juives, les Romains « réduisirent les habitants en esclavage ».
Si tel est bien le cas, le fait que Saul de Tarse apparaisse adolescent à Jérusalem deux décennies plus tard est tout à fait cohérent. Lorsque Paul affirme, en Ac 22.28, qu’il est « né » citoyen romain, le verbe gennao qu’il emploie pourrait se référer à la naissance ou à l’adoption. Les esclaves romains affranchis étaient souvent adoptés par la famille de leur maître et recevaient un nom et une citoyenneté romains.
Cela explique également pourquoi il portait le nom de Paul, un nom très romain qu’aucun pharisien ne donnerait à son enfant bien hébreu.
Contrairement à ce que l’on pense souvent et à ce que l’on entend en chaire, Saul ne prend pas le nom de Paul après être devenu disciple du Christ. Le nom de Saul par lequel il est d’abord désigné est encore employé après sa conversion (Ac 11, 13). Dans les contextes juifs, il utilise son nom hébreu, Saul. Dans les contextes gréco-romains, il utilise ce qui pourrait être son cognomen (troisième partie d’un nom romain), Paullus, hérité de la famille à laquelle il appartenait.
Bien qu’il ait pu hériter ce nom de Paullus de n’importe quelle famille romaine, celui-ci était porté par une branche d’une famille particulièrement célèbre, celle des Aemiliens, relève le spécialiste des lettres classiques du 20e siècle, G. A. Harrer. Ici aussi, les certitudes sont impossibles, mais Harrer suppose que si le propriétaire de Paul était issu de cette famille, le nom romain de l’apôtre aurait pu être « L. Aemilius Paullus, également connu sous le nom de Saul ».
Quelle que soit l’origine du nom de famille, dit Riesner dans une interview, le père de Paul « a été affranchi par son maître romain et a automatiquement obtenu la citoyenneté [romaine] ».
On peut aisément oublier à quel point Paul est un personnage étrange. Luc et lui semblent faire des récits si différents de sa vie que certains chercheurs s’en sont trouvés déconcertés.
Dans les Actes, Luc dépeint Paul comme un citoyen romain de Tarse, à l’aise dans un monde juif hellénistique plus détendu à l’égard des anciennes coutumes. Cependant, Paul se décrit ailleurs en des termes très juifs : « hébreu né d’Hébreux », parlant l’araméen, « de la tribu de Benjamin », pharisien zélé (Ph 3.5-6).
Si nous n’avions pas le livre des Actes des Apôtres, ces propos nous feraient probablement supposer que Paul était originaire de Galilée ou de Jérusalem. Après tout, « on ne devenait pas pharisien en dehors de la Palestine », écrit Riesner dans Paul’s Early Period.
Il était vraisemblablement très rare que quelqu’un soit à la fois un pharisien galiléen zélé et un citoyen romain de Tarse. Il pourrait avoir été difficile de croire que l’on puisse combiner « hébreu né d’Hébreux » et Juif hellénistique. Mais c’est précisément ce qu’était Paul.
Paul n’était pas un Juif de langue grecque qui avait perdu sa langue et sa culture et qui vivait dans le luxe romain. Hier comme aujourd’hui, il existait une forte différence entre les Juifs vivant dans leur patrie et la défendant et ceux menant une vie plus confortable ailleurs. Paul souligne intentionnellement son enracinement dans son héritage et son attachement résolu à celui-ci.
En même temps, Paul était une bizarrerie parmi les Romains, car les Juifs hellénisés parlaient rarement l’araméen. La maîtrise de cette langue par Paul est si importante qu’elle constitue le point culminant de la scène relatée en Actes 21 et 22.
Dans la seconde moitié d’Actes 21, la présence de Paul dans le temple de Jérusalem provoque une vive agitation. On le prend pour un faux prophète égyptien qui avait trompé de nombreuses personnes quelques années auparavant et la foule devient si violente que les soldats romains doivent emmener l’apôtre.
Mais Paul, dans son grec maternel bien maîtrisé, s’adresse au commandant romain. En entendant Paul s’exprimer, l’officier se rend compte qu’il ne s’agit pas de la bonne personne : il n’est clairement pas égyptien.
L’apôtre demande alors s’il peut s’adresser à la foule.
Il monte les marches et commence à parler au peuple : en araméen, la langue qui les avait bercés depuis le sein de leur mère. « Lorsqu’ils entendirent qu’il leur parlait en araméen, ils se tinrent encore plus tranquilles », dit Luc (22.2, NFC).
Tout comme bien des émigrés perdent l’usage de la langue de leurs ancêtres au bout de quelques générations, il était rare que les Juifs de la diaspora parlent l’araméen. C’était la langue d’Israël. À moins que la famille de Paul n’ait quitté très récemment le pays, l’apôtre n’aurait pas été un locuteur natif.
Il y a une autre incohérence dans le CV de Paul : adolescent, il se rend à Jérusalem pour étudier avec Gamaliel, un enseignant juif renommé (5.34). Ce n’était pas un honneur habituel pour des enfants ordinaires de la diaspora ou des Juifs hellénistiques. Mais si les parents de Paul avaient été des zélotes, transplantés de force à Tarse, cette origine aurait pu le distinguer.
« De nombreux chercheurs modernes doutent fortement qu’un juif pieux comme Paul ait pu être citoyen romain », me dit Rainer Riesner. Il semble impossible de réconcilier le pharisien, l’hébreu né d’Hébreux, le zélote parlant l’araméen et le citoyen romain cosmopolite et parlant le grec. À moins, bien sûr, que l’on ne prenne en compte la tradition de l’Église primitive voyant en Paul l’enfant d’une famille réduite en esclavage.
« L’affranchissement du père de Paul résout ces problèmes », m’explique le théologien allemand.
Riesner s’inscrit dans la suite d’une longue lignée d’universitaires allemands qui ont pensé la même chose. « Le grand libéral Adolf von Harnack et le grand conservateur Theodor Zahn » étaient tous deux de « fervents défenseurs » de cette tradition, me raconte-t-il. Ils n’étaient pas même d’accord sur la résurrection, mais ils se rejoignaient sur ce point.
Alors pourquoi les chrétiens du monde anglophone n’en parlent-ils pas davantage ?

Une théorie veut simplement que les universitaires allemands du 20e siècle lisaient beaucoup mieux le grec et le latin que les universitaires américains ou britanniques contemporains. Lorsque ces Allemands ont commencé à occuper des postes dans des universités de premier plan, ils ont pu étudier Homère ou Origène en grec, ou Jérôme en latin. Ils pouvaient lire non seulement pour leurs recherches, mais aussi pour le plaisir.
Les études du Nouveau Testament dans le monde anglophone, en revanche, ont tendance à ne mettre l’accent que sur le corpus du grec du Nouveau Testament. De nombreux chercheurs du Nouveau Testament ne savent tout simplement pas lire Homère ni Origène. Ainsi, après la Seconde Guerre mondiale, lorsque beaucoup de recherches se sont déplacées des universités germanophones vers les universités anglophones, cette partie des débats sur Paul s’est peut-être perdue dans les affres de la traduction et du feuilletage des pages du dictionnaire.
« Les pères de l’Église se sont développés rapidement ici en Amérique », m’explique Ronald E. Heine, le spécialiste d’Origène. Pour lui, ce n’est que très récemment que les études patristiques ont reçu l’attention qu’elles méritaient.
Quelles qu’en soient les raisons exactes, certains de nos travaux académiques souffrent manifestement d’un manque de familiarité et de confiance à l’égard du travail de l’Église primitive.
Pour se décrire tel qu’il était en tant que jeune homme, Paul utilise parfois le terme « zélote » (généralement traduit dans des passages comme Galates 1.14 par « zélé »). On a généralement interprété ce terme comme signifiant qu’il était plein de zèle ou « brûlant pour Dieu ». Mais il y a de bonnes raisons de penser que Paul s’identifiait par là à la secte juive qui s’opposait par la violence à toute personne contrevenant à l’observance de la Torah, y compris les Romains.
Si tel est le cas, quel genre de zélote était Paul avant de rencontrer le Christ ?
Au bout de son expérience de l’esclavage, il avait découvert que Rome n’avait pas que de mauvais côté. L’empire lui avait tout de même conféré sa citoyenneté. Paul avait conservé les perspectives zélotes de son éducation, mais non sans les altérer. Ce n’est plus contre Rome qu’il se battait, mais pour ses traditions ancestrales. La persécution des chrétiens était l’expression de ce zèle.
Même après sa conversion, Paul semble réticent à révéler sa citoyenneté romaine devant ses compatriotes hébreux, qui pourraient encore l’avoir associé aux zélotes. Il supporte des coups qu’il aurait pu éviter en invoquant cette citoyenneté (Ac 16.16-40). Le philosophe romain Cicéron écrivait : « lier un citoyen romain est un crime, le fouetter est une abomination, le tuer est presque un acte de parricide ».
Ce n’est que lorsqu’il n’y a que peu ou pas de spectateurs juifs que Paul semble prêt à jouer sa carte de citoyen romain. Dans la scène d’Actes 22, Paul est séquestré dans la caserne lorsqu’il surprend les soldats par cette annonce.
Il est possible que de nombreux apôtres de Jérusalem n’aient eu connaissance de sa citoyenneté qu’à la fin de la vie de Paul. Il est difficile d’être à la fois un important responsable juif et un citoyen de l’empire qui opprime son peuple.
S’il avait été élevé en tant qu’esclave dans une ville romaine avant d’être affranchi, on comprend bien comment Paul pouvait être citoyen de l’empire tout en gardant un certain recul à son égard.
Les zélotes mettaient en œuvre leur zèle de différentes manières. Certains extrémistes assassinaient des personnalités politiques, des Romains ou des Juifs sympathisants de Rome. D’autres se livraient à des violences religieuses plus spécifiques, comme l’enlèvement de Juifs hellénistiques incirconcis et leur circoncision forcée.
Le héros de ces activistes était Phinéas, le petit-fils d’Aaron. Alors que les Israélites étaient sur le point d’entrer dans la Terre promise, celui-ci s’était mis en colère contre les hommes qui prenaient des femmes moabites et s’adonnaient à leur culte de la fertilité. En Nombres 25, il va chercher une lance et suit un homme et son amante madianite dans une tente. Il les transperce tous les deux d’un seul coup et détourne la colère de Dieu.
Dans sa biographie de l’apôtre, N. T. Wright explique : « Lorsque l’apôtre Paul se décrit dans sa vie antérieure comme étant consumé par le zèle pour ses traditions ancestrales, il se remémore une jeunesse façonnée par la figure de Phinéas. »
Phinéas était le héros du jeune Paul. Il cherchait ardemment à délivrer le peuple juif par le même type de zèle violent.
La manière dont nous faisons sa connaissance dans l’Écriture ne doit rien au hasard.
Dans le mouvement messianique naissant qui deviendra le christianisme, Étienne se distinguait comme un prédicateur remarquable. Non seulement il pouvait prêcher, mais il aidait aussi au service des veuves juives hellénistiques dont les besoins n’étaient pas satisfaits parce qu’elles étaient moins considérées que les autres (Ac 6). Dans l’esprit du jeune Paul, Étienne profanait la compréhension juive du monothéisme et violait les traditions rabbiniques, tout comme Jésus.
Si les zélotes cherchaient une cible, Étienne était tout indiqué.
Paul pourrait alors avoir contribué à son lynchage. Celui-ci n’est pas orchestré par des Juifs locaux, mais par des « membres de la synagogue appelée “synagogue des affranchis”, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d’Asie » (Ac 6.9). Comme l’écrit Eckhard J. Schnabel, spécialiste du Gordon-Conwell Theological Seminary, dans son commentaire sur les Actes des Apôtres, « les “affranchis” […] étaient des Juifs qui avaient été libérés de l’esclavage par leurs propriétaires ou qui descendaient d’esclaves juifs émancipés ».
Si l’Église primitive dit vrai au sujet des parents de Paul, alors, que celui-ci soit né d’un père affranchi ou né dans l’esclavage et affranchi par la suite, il aurait été considéré comme un affranchi.
Les membres de cette synagogue d’affranchis produisent de faux témoins contre Étienne afin de monter un dossier contre lui (v. 13).
Il serait étrange qu’un « Hébreu né d’Hébreux », chez lui à Jérusalem, travaille spécifiquement avec d’anciens esclaves pour mettre au point cette ruse. Si Paul avait été un membre important de la haute société, son association avec d’anciens esclaves n’aurait guère de sens. Promouvoir de faux témoignages nécessite un très haut niveau de complicité au sein d’un groupe. En cas de fuite, les intrigants s’exposaient au châtiment qu’ils cherchaient à infliger à leur victime (Dt 19.16-21).
Mais cette synagogue d’affranchis — dont beaucoup étaient originaires de Cilicie, qui avait pour capitale Tarse, la ville natale de Paul — pourrait avoir compté bien des amis proches et des compatriotes qui voyaient le monde comme Paul.
« Luc pourrait supposer ici que Paul appartenait à cette synagogue particulière », écrit Riesner.
Il est donc fort possible que Paul, l’esclave affranchi, ait été entouré d’esclaves affranchis issus de la même région que lui. Il fait partie d’un cercle de familiers, d’où il aurait pu inspirer les conspirateurs à l’origine de la mort du premier martyr chrétien. Par la suite, il prévoit de poursuivre et de détruire les communautés messianiques naissantes dans tout l’Empire romain.
Au sommet de la liste ? Damas.
Mais comme vous le savez, en chemin, Paul est confronté à un visiteur céleste, renversé et aveuglé pendant trois jours (Ac 9). Une rencontre qui a changé le monde.
Non seulement l’histoire de Paul telle que la raconte l’Église primitive explique mieux son personnage, mais elle explique aussi mieux la façon dont il s’exprime.
Nous ne nous interrogeons pas nécessairement sur la manière dont Paul écrit. Nous l’imaginons simplement normale. Mais si le reste du Nouveau Testament peut servir de guide, tel n’est pas le cas.
Chacun est formé par son milieu. Nos vocabulaires et nos boîtes à outils mentales trahissent le milieu dans lequel nous avons évolué. Et Paul est obsédé par le vocabulaire de l’esclavage. Dans ses écrits, il en parle constamment : de la servitude ; de la liberté ; de l’adoption ; des entraves ; de l’exode ; de la citoyenneté. Les deux ouvertures les plus courantes des lettres de Paul sont « Paul, apôtre de Christ » et « Paul, esclave de Christ ».
Le reste du Nouveau Testament utilise rarement le vocabulaire de l’esclavage. Si l’on se limite au compte des mots, Paul n’a écrit qu’un quart du Nouveau Testament, mais de simples recherches sur le vocabulaire montrent que les thèmes liés à l’esclavage sont présents de manière disproportionnée dans ses écrits.
Et à côté des références les plus évidentes, d’autres sont plus subtiles. À la fin de l’épître aux Galates, par exemple, Paul déclare : « Que personne désormais ne me fasse de peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » (Ga 6.17)
On pourrait aisément imaginer que Paul fait référence aux cicatrices accumulées à la suite des nombreux coups reçus dans son ministère. Le problème, c’est que, selon Wright, Galates est probablement la première lettre de Paul. Le spécialiste de Paul Richard N. Longenecker soutient également que la lettre aux Galates a été écrite très tôt dans le ministère de Paul, « avant le “concile” de Jérusalem ».
Les coups de fouet, les bastonnades et les lapidations, avec les cicatrices qui en résultent, viendront plus tard. De quelles marques Paul parle-t-il ?
Il y a aussi quelque chose d’amusant dans le choix des mots.
Il existe de nombreux mots en grec pour désigner une cicatrice ; plusieurs pourraient venir à l’esprit avant celui que Paul utilise ici, stigmata.
Selon le lexique de Johannes Louw et Eugène Nida, si l’on veut bien oublier le sens latin médiéval ultérieur du mot, stigmata désignait à l’époque de Paul « une marque ou une cicatrice permanente sur le corps, en particulier le type de “marque” utilisée pour indiquer la propriété des esclaves ».
Si Paul était né dans une famille d’esclaves, il avait été marqué au fer rouge pour indiquer son propriétaire. Paul a été affranchi au moment où nous le rencontrons, mais la marque est toujours là. Et Paul, passé maître dans l’art d’interpréter l’ancien à travers le prisme de la nouveauté en Christ, est capable de réinterpréter même cela.
L’identité de Paul est toujours celle d’un esclave. Mais il sait à présent qui est véritablement son maître. Paul, esclave du Christ.
Ces exemples ne sont pas le fruit du hasard. Les analogies avec l’esclavage sont la toile de fond de la pensée de Paul.
Dans son livre Reading While Black, Esau McCaulley, professeur au Wheaton College, rapporte cette histoire d’Howard Thurman :
On raconte souvent l’expérience d’Howard Thurman qui lisait la Bible pour sa grand-mère, une ancienne esclave. Plutôt que de lui faire lire toute la Bible, elle omettait des passages des lettres de Paul. Dans un premier temps, il ne remit pas en cause cette pratique. Finalement, il trouva le courage de lui demander pourquoi elle évitait Paul :
« À l’époque de l’esclavage, dit-elle, le pasteur du maître organisait de temps en temps des offices pour les esclaves. Le vieux McGhee était si méchant qu’il ne laissait pas un pasteur noir prêcher à ses esclaves. Le pasteur blanc utilisait toujours un texte de Paul. Au moins trois ou quatre fois par an, il revenait à ce texte : “Esclaves, obéissez à vos maîtres… comme à Christ.” Il poursuivait en montrant que c’était la volonté de Dieu que nous soyons esclaves et que si nous étions de bons et heureux esclaves, Dieu nous bénirait. J’ai promis à mon créateur que si j’apprenais à lire et si la liberté me revenait, je ne lirais pas cette partie de la Bible. »
De nombreux croyants ont encore du mal à lire Paul à cause de ce trouble héritage interprétatif. Tout au long de l’histoire, nombreux sont ceux qui ont mal compris Paul et l’ont utilisé comme arme contre les opprimés. Certains le font encore.
Bien que les chrétiens aient fini par mettre fin à l’esclavage dans l’Empire romain et par mener la charge pour son abolition en Occident, les propriétaires d’esclaves du monde entier ont également étayé leur idéologie par la Bible, en s’appuyant en particulier sur les paroles de l’apôtre.
Mais Paul n’était ni un partisan de l’esclavage ni un abolitionniste, malgré les efforts déployés pour utiliser sa lettre à Philémon dans un sens ou dans l’autre. En réalité, il n’avait le choix entre aucune de ces deux options.
Il est difficile pour les lecteurs modernes de comprendre que dans l’Empire romain de l’époque de Paul, la pensée abolitionniste était pratiquement inexistante. Selon Jeffers, « aucun auteur grec ou romain n’a jamais attaqué l’esclavage en tant qu’institution ». Il était acquis que l’esclavage existerait toujours. Au 19e siècle, le français Alexis de Tocqueville écrivait : « Tout porte à croire que même les hommes de l’Antiquité nés esclaves puis affranchis, dont plusieurs nous ont laissé de très beaux textes, envisageaient la servitude sous le même jour. »
Les premiers chrétiens, eux, avaient l’esprit presque exclusivement fixé sur la seconde venue de Christ, qu’ils croyaient imminente. Le temps n’était pas à la réforme des profondes injustices de l’Empire romain. Et même si les premiers chrétiens avaient nourri des ambitions abolitionnistes, ils représentaient moins d’un habitant sur mille dans l’Empire romain à l’époque du ministère de Paul. Ils étaient regardés avec suspicion et persécutés. Leurs responsables y laissaient fréquemment leur vie, comme ce fut le cas pour Paul. Les chrétiens n’avaient pas voix au chapitre. Pas encore.
Mais ne vous y trompez pas. Si Paul ne pouvait pas accomplir de grandes choses, il pouvait accomplir de petites choses avec beaucoup d’amour. Et ces petites choses allaient bouleverser le monde. « La révolution de Paul », écrit Scot McKnight dans son commentaire sur Philémon, « ne se situe pas au niveau de l’Empire romain, mais au niveau du foyer, pas au niveau de la polis [ville], mais au niveau de l’ekklēsia [église] ».
Comme le dit le chercheur britannique F. F. Bruce dans sa biographie de Paul, la lettre à Philémon « nous plonge dans une atmosphère où l’institution [de l’esclavage] ne pouvait que flétrir et mourir ».

Il paraît difficile d’imaginer une époque où l’esclavage était une telle évidence qu’aucun écrivain de l’époque ne le remettait directement en question. Mais Paul pourrait avoir fait plus que tout autre auteur ancien pour saper cette pratique.
La mémoire de l’Église primitive révèle en effet que Paul était probablement la personne la moins susceptible de tolérer l’esclavage. Ses parents avaient été esclaves. Et peut-être l’avait-il lui aussi été.
Et si Onésime l’avait su ? Le serviteur fugitif aurait alors parcouru plus de 1 000 kilomètres pour demander l’aide d’un homme dont il pensait qu’il comprendrait réellement sa situation.
L’apôtre affirme qu’il renvoie Onésime comme s’il s’agissait de ses propres splanchna, un terme qui désigne les sentiments les plus profonds d’une personne. Joseph Fitzmyer commente : « Paul considère le chrétien Onésime comme une partie de lui-même ». L’utilisation de splanchna dans cette lettre « montre à quel point Paul était personnellement impliqué dans l’affaire ». Pourquoi Paul était-il si intimement impliqué ? Il connaissait les réalités de la vie d’Onésime.
Lorsque Paul confie sa lettre à Onésime et le renvoie à son maître Philémon, l’apôtre plaide avec douceur et force pour que celui-ci reprenne Onésime « non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé » (v. 16).
Paul lui dit ensuite d’accueillir Onésime comme s’il l’accueillait lui-même. « Et s’il t’a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte », dit l’apôtre. « Moi Paul, je l’écris de ma propre main, je te rembourserai, sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi : c’est toi-même. » (v. 18-19) Deux versets plus loin, il laisse entendre clairement qu’une fois sorti de prison, il passera chez Philémon. Il saura si Philémon a bien agi.
Il y a là un fait inédit dans le monde antique : accueillir un esclave en fuite comme on accueillerait l’un des principaux responsables d’un mouvement.
C’est cette égalité radicale qui a fait du christianisme une telle menace pour les puissants. Aucun contrat, aucune classe, aucune caste ne peut altérer la réalité de l’image de Dieu présente en chaque être humain. Paul le rappelle aux esclaves et aux propriétaires : ils sont égaux devant Dieu. « Vous le savez : vous et eux, vous avez le même Maître dans les cieux, et lui, il ne fait pas de différence entre les gens. » (Ep 6.9, PDV)
Malheureusement, Paul a probablement été exécuté par l’empereur romain Néron avant de pouvoir retourner à Colosses. Nous ne saurons peut-être jamais ce qu’il est advenu d’Onésime ou comment Philémon a réagi à cette lettre.
Mais sa conservation par l’Église pourrait être un indice majeur quant à l’effet qu’elle a produit.
Au cours du siècle dernier, les spécialistes ont conclu que les personnages et les récits de la Bible n’ont pas été choisis au hasard ou simplement parce qu’ils étaient fascinants. Comme le dit Jean : « Jésus a fait encore beaucoup d’autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu’on écrirait. » (Jn 21.25)
Pour Richard Bauckham, bibliste à Cambridge, les personnages retenus l’ont été parce qu’ils étaient reconnus par l’Église primitive.
Les Évangiles offrent bien plus de place aux personnalités qui conduisaient encore l’Église une trentaine d’années après sa création. C’est l’une des raisons pour lesquelles Marie, la mère de Jésus, qui, selon la tradition, a encore vécu pendant des décennies à Éphèse, bénéficie d’une place considérable dans les Écritures, alors que son mari Joseph, mort prématurément, ne dit pas un mot. Il existerait une sorte de préjugé favorable aux survivants dans les Écritures.
Aussi influent qu’Étienne ait pu être, son histoire sert surtout à introduire l’histoire plus vaste de Paul, qui façonnera l’Église grandissante pendant de nombreuses années. La trahison de Pierre et sa réconciliation avec Jésus est l’un des rares récits repris dans les quatre évangiles, très probablement parce que Pierre était bien connu de la jeune communauté chrétienne et qu’il y est resté pendant des décennies, racontant probablement souvent cette histoire.
Parmi les nombreuses communications personnelles de Paul qui ont probablement été perdues, pourquoi la lettre à Philémon a-t-elle été préservée ? Pourquoi cette lettre en particulier a-t-elle été conservée, lue publiquement, copiée à la main et diffusée dans tout le monde connu ?
Tout comme les Évangiles semblent privilégier les récits de personnes encore connues dans les communautés chrétiennes, et tout comme les lettres personnelles de Paul qui ont survécu sont liées à des responsables de communautés plus importantes, nous avons de bonnes raisons de penser qu’il en va de même ici. Philémon, Onésime ou les deux pourraient également avoir été bien connus et influents dans l’Église primitive.
La lettre nous apprend que Philémon faisait partie d’une église de maison à Colosses, une petite ville située dans l’actuelle Turquie. Il est peu probable que les églises du monde entier se soient intéressées à l’histoire de l’hôte d’une petite communauté que Paul aurait dû exhorter par cette lettre.
Mais dans la ville voisine d’Éphèse, capitale de la région et forte d’une importante communauté chrétienne, il y a une histoire qui pourrait avoir rendu la lettre digne d’être préservée, voire célébrée.
Timothée est le premier évêque des églises d’Éphèse. Les premiers historiens de l’Église rapportent qu’il fut martyrisé par l’empereur romain, comme l’avait été son mentor Paul.
Mais avant cela, il eut le temps de former toute une liste de pasteurs. L’un des pasteurs de Timothée était connu comme un véritable berger de bergers. Un pasteur de pasteurs. Un homme qui visitait les prisonniers et prenait soin des orphelins et des veuves dans leur détresse (Jc 1.27). Quelqu’un qui semblait comprendre le sort des marginaux comme s’il avait lui-même été de leur nombre.
Lorsque le moment vint de choisir un nouvel évêque après le martyre de Timothée, la tradition de l’Église et de nombreux spécialistes modernes s’accordent à dire que le choix à faire fut évident. L’Église éphésienne choisit le berger des bergers.
Cet homme servit à merveille pendant des décennies. Et dans sa vieillesse, il fut lui aussi tué par Rome.
Son nom était Onésime.
Mark R. Fairchild est professeur retraité de Bible et de religion à l’université de Huntington et titulaire d’une bourse Fulbright. Son prochain livre sur Paul sortira en 2025 chez Hendrickson Publishers.
Jordan K. Monson est auteur et professeur de missions et d’Ancien Testament à l’université de Huntington.