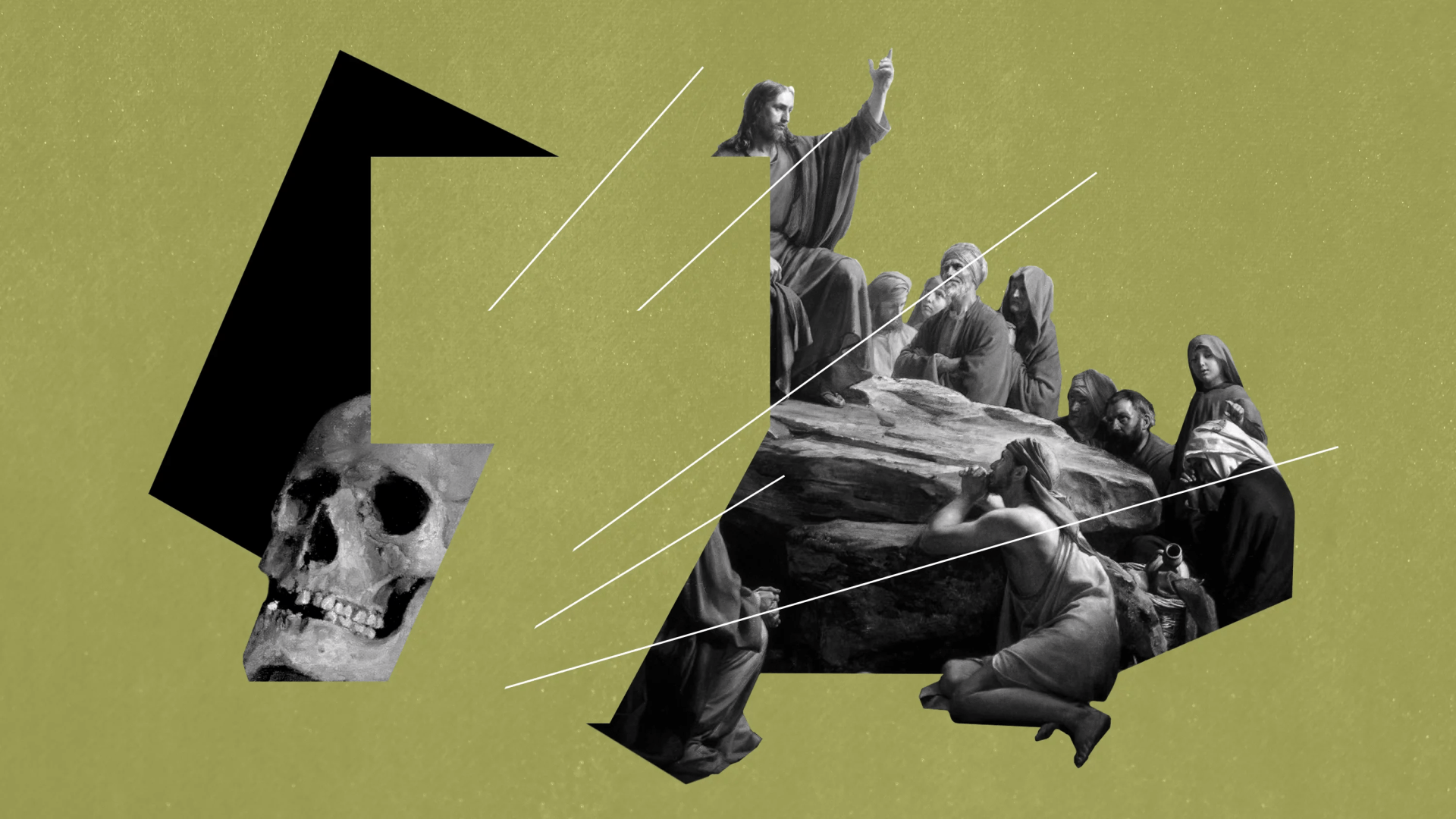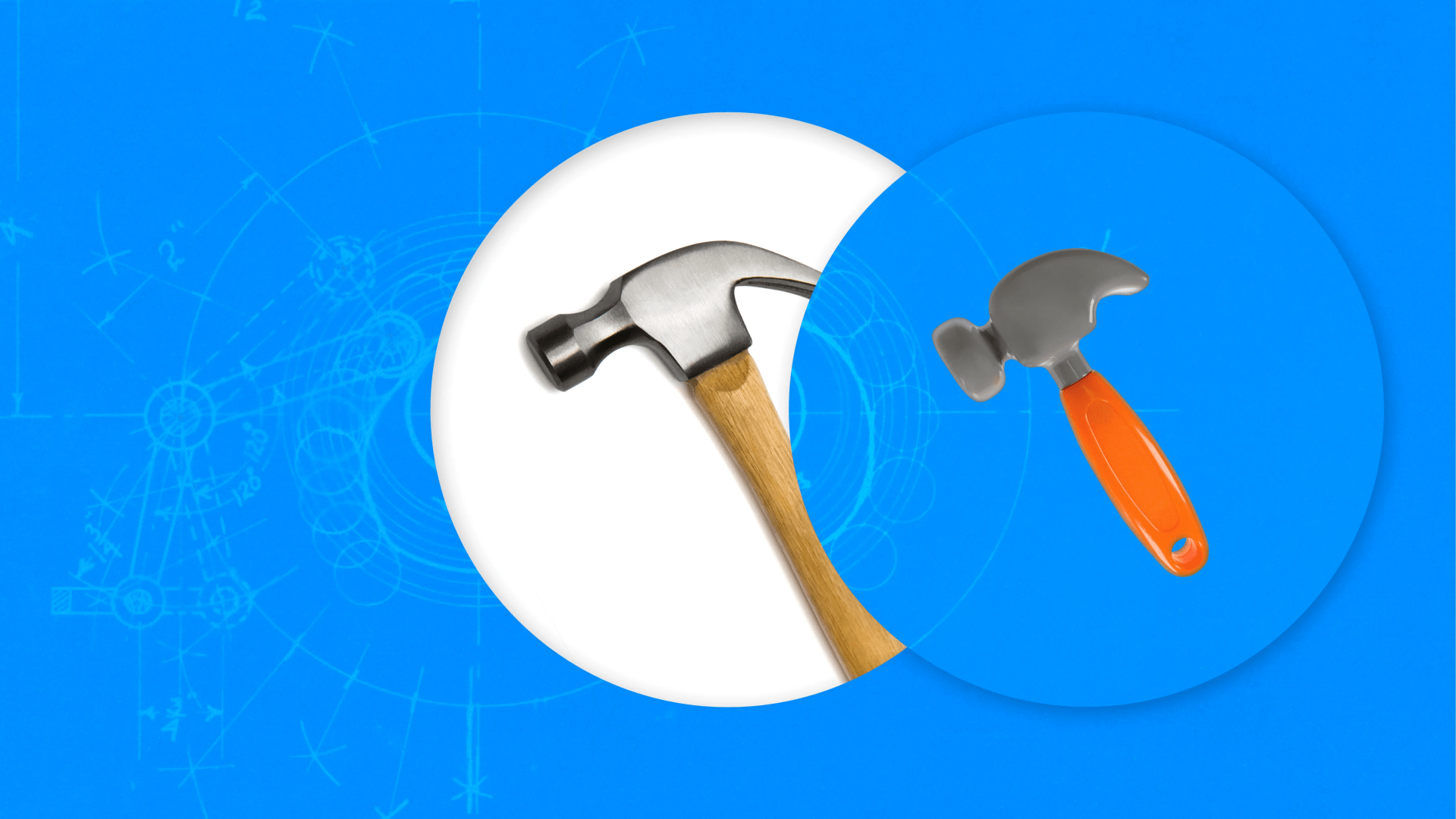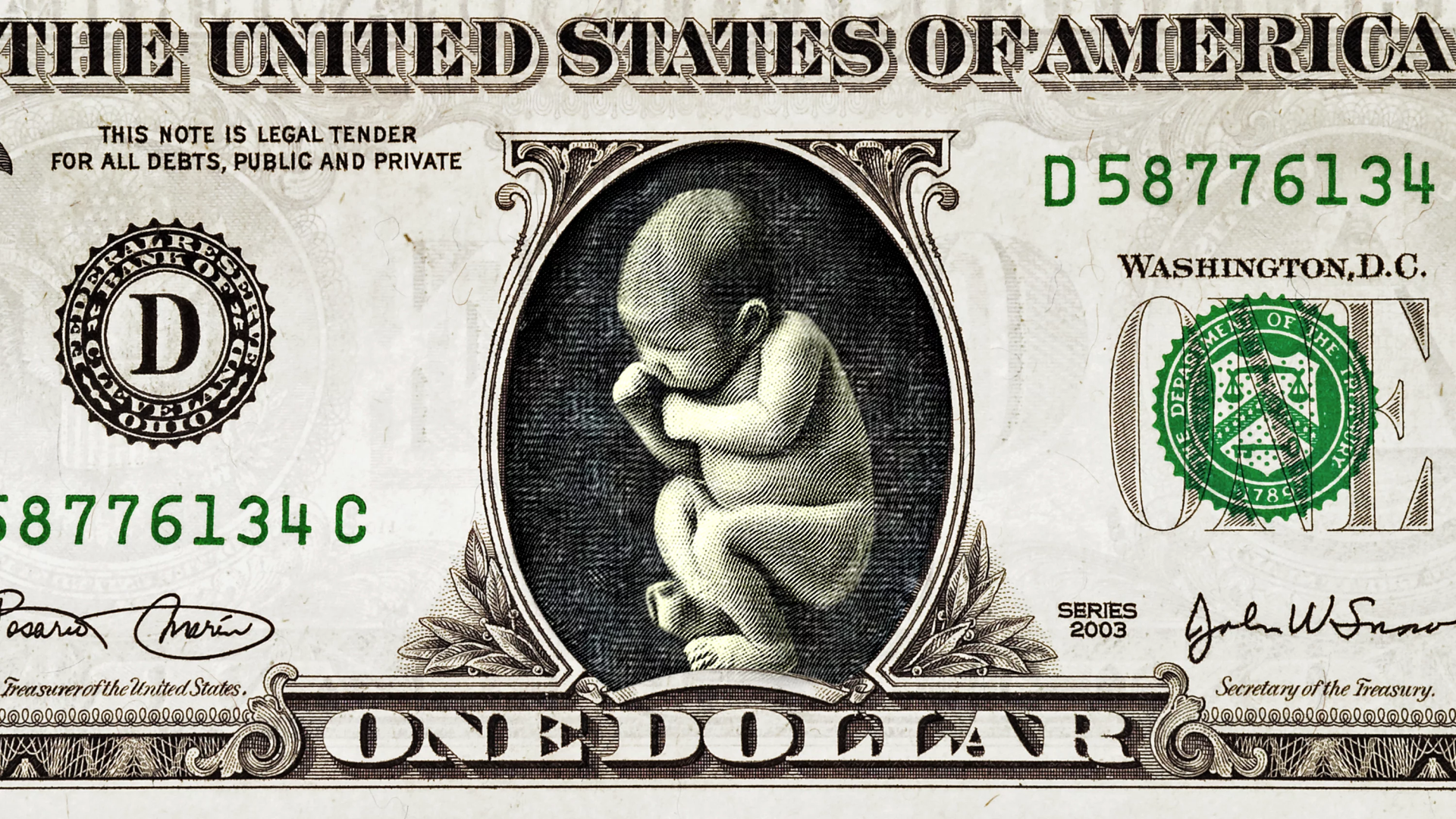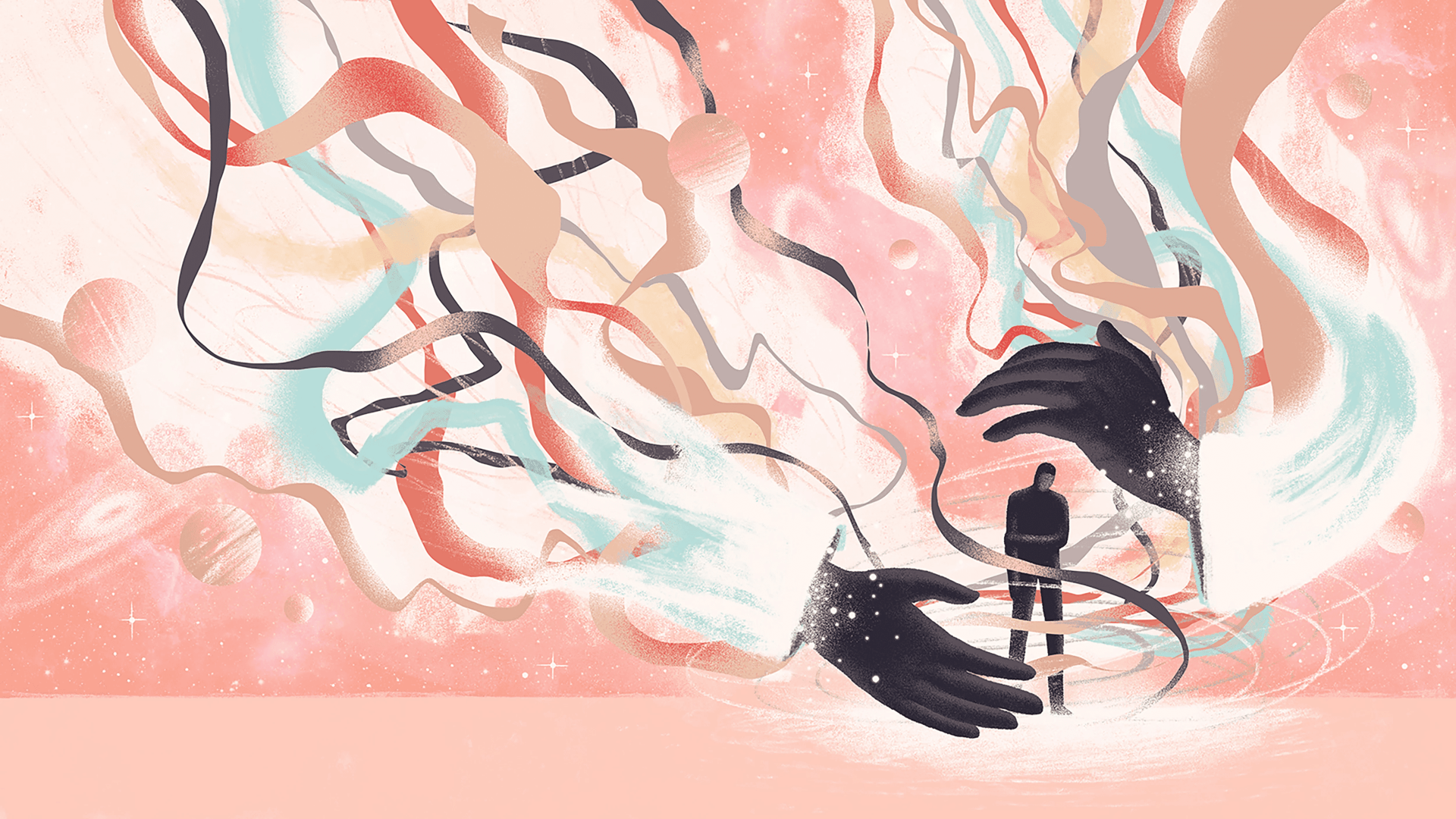À Christianity Today, nous croyons que la Parole de Dieu contient des vérités et des enseignements spécifiquement pertinents pour les défis auxquels nous sommes confrontés à notre époque. Par ailleurs, chaque culture aborde la Bible de son propre point de vue et apporte depuis celui-ci des perspectives uniques. Nous avons beaucoup à apprendre en étudiant les manières dont ceux qui viennent d'horizons différents du nôtre analysent et appliquent les Écritures.
C'est dans cet esprit que nous annonçons notre deuxième concours annuel international d'écriture. Nous proposons aux auteurs écrivant en chinois, espagnol, français, indonésien ou portugais de nous envoyer leurs réflexions dans leur propre langue. Leurs textes seront jugés par trois à cinq responsables chrétiens et théologiens vivants dans des régions où cette langue est parlée. Le texte gagnant de chaque langue sera ensuite traduit en anglais et publié sur le site web de Christianity Today dans les deux langues.
Cette année, nous demandons aux auteurs de choisir un verset, un chapitre ou un récit de la Genèse, du livre de Job, de 1 ou 2 Corinthiens ou de Colossiens et de le mettre en relation avec un problème auquel eux-mêmes ou leur société sont confrontés dans leur contexte spécifique. Nous sommes particulièrement à la recherche de textes combinant un grand respect pour les Écritures et une application originale et rafraîchissante de leur contenu. L'article devrait encourager vos propres concitoyens, tout en gardant à l’esprit qu’il devrait pouvoir être lu n’importe où dans le monde.
Nous sommes intéressés par la lecture de réflexions originales transmettant la perspective de l'Évangile sur une question particulière, dans une tonalité généreuse et pondérée, qui donneront aux lecteurs l'envie d'ouvrir leur Bible et d'en lire davantage. Les éventuels articles rédigés à la première personne devraient appliquer votre expérience personnelle à une notion plus large de la foi et de la vérité biblique.
Si vous n’en êtes pas familiers, nous vous recommandons de lire quelques articles publiés par CT pour vous faire une meilleure idée de la tonalité, du style et du type des articles que nous publions. Nous ne recherchons pas des articles universitaires et CT n'emploie pas les notes de bas de page, mais nous pouvons utiliser les liens hypertextes lorsque cela est pertinent.
Critères d'évaluation
- Clarté de la présentation des idées.
- Originalité de la réflexion
- Structure argumentative
- Profondeur théologique
- Recherches apparentes sur le sujet
- Maîtrise de la nuance
- Pertinence pour la communauté linguistique concernée
Prix
Nous aurons un gagnant dans chaque langue : chinois, espagnol, français, indonésien et portugais.
Chaque gagnant remportera 250$ et un abonnement numérique de trois ans à Christianity Today, en plus de la publication de son article sur notre site.
Même si votre texte ne remporte pas le concours, il pourrait être publié ultérieurement. En soumettant votre texte, vous acceptez que les rédacteurs de Christianity Today envisagent sa publication future.
Informations pour la participation
Pour le français, votre participation est à communiquer par courriel à l'adresse ChristianityTodayFR@christianitytoday.com d'ici au 30 septembre 2022.
Définissez l'objet du courriel comme suit : Concours d'écriture Christianity Today — [Prénom et nom]
Nommez votre document de la manière suivante : Nom Prénom – Titre du texte
Envoyez votre texte sous forme de lien ou de pièce jointe, au format dactylographié, avec interligne simple. Si vous envoyez plusieurs textes, préparez chaque texte séparément.
Indiquez votre nom complet et quelques mots à propos de vous dans le courriel (50 mots maximum).
Indiquez le nombre total de mots de votre texte.
Détails
Toutes les contributions doivent compter entre 1200 et 1500 mots.
Vous pouvez soumettre plus d'un texte. Nous pourrions publier plus d’une soumission par personne, mais un seul texte par personne sera retenu parmi les finalistes soumis à notre jury.
Nous ne pourrons pas accepter les contributions tardives pour le concours, mais nous les prendrons tout de même en considération pour une éventuelle publication.
Tout le contenu doit être original.
Vérifiez l'orthographe et la grammaire. Indiquez les liens vers toute source extérieure.
Votre essai sera édité par les rédacteurs de Christianity Today avant d'être publié et les titres pourront être modifiés.