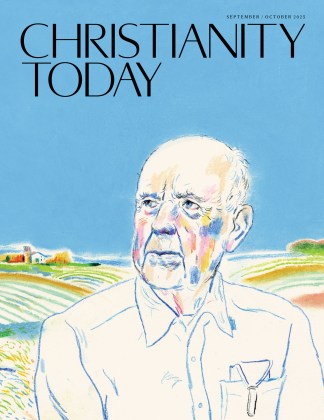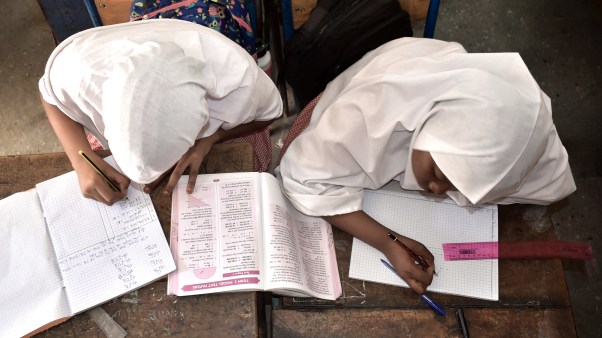Le transhumanisme ne date pas d’hier. Déjà à l’époque de la Renaissance, l’humaniste Jean Pic de la Mirandole, dans son De la dignité de l’homme de 1486, fait prononcer par le Créateur ces paroles adressées à Adam, le premier être humain :
Si nous ne t’avons fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, c’est afin que, doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. Tu pourras dégénérer en formes inférieures, qui sont bestiales ; tu pourras, par décision de ton esprit, te régénérer en formes supérieures, qui sont divines.
Pic de la Mirandole est le saint officieux des transhumanistes. Dès son époque, il portait la plasticité humaine au-delà de ses limites. Il croyait que les formes les plus élevées des humains en faisaient plus que des humains. Pour lui, elles touchaient au divin.
Aujourd’hui, en notre 21e siècle, le philosophe Nick Bostrom définit le posthumain comme un être dont au moins une caractéristique centrale, telle que la durée de vie, la cognition ou la sensibilité, « dépasse largement le maximum atteignable par tout être humain actuel sans recourir à de nouveaux moyens technologiques ».
L’entreprise de neurotechnologie Neuralink a mis au point des interfaces cerveau-ordinateur pour les personnes paralysées, afin de les aider à communiquer et à commander des appareils à distance. Neil Harbisson, daltonien de naissance, a reçu en 2004 un implant crânien sous la forme d’une antenne qui lui permet de « voir » les couleurs sous forme de vibrations sonores. Le cinéaste Rob Spence, lui, a carrément remplacé son œil droit par une caméra vidéo sans fil et se désigne lui-même comme un « eyeborg ». Elizabeth Parrish, PDG d’une entreprise de biotechnologie, affirme elle avoir réussi à ralentir son processus de vieillissement après avoir subi une thérapie génique expérimentale en 2015.
D’autres développements potentiels sont purement esthétiques. « Si vous pouviez remodeler votre pied et le transformer en talon compensé, le feriez-vous ? », interroge un article de mode à propos des modifications du corps. Ou encore : « Que diriez-vous d’un ornement de fines cornes turquoise émanant de chacune de vos épaules ? »
Pour qui entend certaines paroles d’un grand philosophe pessimiste comme Arthur Schopenhauer, qui écrivait de la vie qu’elle « oscille comme un pendule d’avant en arrière entre la douleur et l’ennui », le projet transhumaniste peut être tentant. Mais pour décider si l’objectif de transcender notre humanité mérite réellement d’être poursuivi, il faut savoir si le fait d’être un simple humain est réellement quelque chose qui doit être dépassé.
Pour ma part, je crois que, tout comme il y a de la beauté et de la bonté à être un aigle ou un dauphin, il y a de la beauté et de la bonté à être simplement un humain. L’article central de la foi chrétienne, après tout, est que le Verbe divin s’est fait chair humaine. En demeurant parmi nous, le Verbe a sanctifié l’humanité dans sa finitude et sa fragilité. Cela n’exclut cependant pas des améliorations, ce par quoi j’entends le développement et l’utilisation d’outils, même ceux qui s’intégreraient à notre corps.
Il y a quelques années, j’ai donné un cours à l’université de Yale sur la foi et la mondialisation avec le Premier ministre britannique Tony Blair et un collègue non-croyant. À un moment de son exposé, ce dernier a brandi une pilule et l’a montrée aux étudiants. Lorsque des croyants sont malades, déclara-t-il, ils prient, persuadés que Dieu accomplira un miracle. Les non-croyants, eux, s’en remettent aux merveilles de la médecine moderne, comme cette minuscule pilule qui soigne presque instantanément l’hypertension artérielle. La conclusion de cet intervenant était que la médecine moderne fonctionne manifestement mieux que Dieu.
Lorsqu’il eut terminé, je me suis tourné vers lui et lui ai dit : « Vous et moi sommes d’accord sur un point important : nous nions tous les deux le même dieu ! » Il m’a regardé d’un air perplexe.
« Le dieu dont vous niez l’existence est incompatible avec l’inventivité et le travail de l’être humain, et donc avec toutes les techniques du monde », ai-je poursuivi. « Je nie également l’existence de ce dieu. En revanche, le Dieu auquel je crois rend possible la totalité de la réalité du monde dans toute sa complexité dynamique, y compris l’inventivité et le travail de l’être humain. »
Les premières pages de la Bible racontent que Dieu œuvre avec les réalités de la terre. Dans le jardin d’Eden, Dieu n’a pas fait tomber de la nourriture du ciel dans la bouche d’Adam et d’Ève, exerçant une pression sur leurs mâchoires pour les obliger à mâcher. Au contraire, ils ont travaillé pour se nourrir. Ils ont cultivé et gardé le jardin. Dieu était à l’œuvre avec eux, derrière et dans leur propre travail.
Nous devrions être très attentifs aux dilemmes éthiques que soulève le transhumanisme. Cependant, ce serait une erreur de penser que l’œuvre divine et l’œuvre humaine, y compris les progrès technologiques, s’excluent mutuellement.
Les humains en sont venus à croire en Dieu alors qu’ils n’avaient encore aucune connaissance scientifique de la structure fondamentale de la réalité. C’était le temps où la lavande était leur meilleur antiseptique et leurs pieds nus et calleux leur principal moyen de transport.
Bien que notre compréhension du monde — et donc de la relation de Dieu au monde — ait changé, les modernes que nous sommes pouvons toujours croire en ce même Dieu à l’heure où nous explorons les propriétés astrophysiques et quantiques des trous noirs, modifions le génome pour prévenir les maladies et améliorer les capacités humaines ou encore voyageons dans des voitures sans conducteur. Nous pouvons garder la foi, sans abandonner la raison.
Mais plus nous avons de pouvoir, plus il est important de choisir judicieusement l’orientation fondamentale de notre vie. Plus nous créons d’outils intelligents et puissants, plus nous devons être au clair quant aux objectifs humains qu’ils serviront. Et la seule façon de discerner quels objectifs sont dignes de notre humanité est de savoir ce en quoi mettre notre confiance, ce que nous devons aimer par-dessus tout et quel genre d’humains nous espérons être.
Être humain — créé en imago Dei — c’est vivre d’une certaine vision de ce qu’est une bonne vie. Cette vision trace le portrait de l’humain que nous devrions être et fournit les critères de ce que nous devrions désirer et de la manière dont nous devrions vivre. Nous vivons tous d’une vision de ce type, que nous l’ayons consciemment adoptée ou qu’elle reste embryonnaire et cachée à nos yeux, entremêlée à nos croyances et nos pratiques.
Ce type de vision étant par définition normatif, sa formulation n’appartient pas au domaine de la science. La connaissance de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera probablement, aussi précise et détaillée soit-elle, ne peut jamais prescrire ce qui devrait être.
Imaginons que nous décidions de renoncer à notre vie privée et que nous autorisions la collecte de toutes les données disponibles sur nous — nos conversations et notre correspondance, notre santé, nos habitudes et nos achats. Un algorithme très intelligent pourrait obtenir un compte rendu exceptionnellement précis de notre comportement et serait donc probablement en mesure de prédire ce que nous ferions dans de nombreuses situations. Il pourrait nous dire ce que nous désirons et ce que nous trouvons désirable, et même ce que nous pensons de ce que nous devrions être et de ce que nous devrions faire. Il pourrait même en venir à nous connaître mieux que nous-mêmes, scénario sur lequel se termine le livre de Yuval Noah Harari Homo Deus, Une brève histoire du futur.
Mais la seule chose qu’un algorithme aussi intelligent ne pourrait pas nous dire, c’est qui nous devrions réellement être, ce que nous devrions faire, vers quoi nous devrions nous orienter et ce que nous devrions désirer. La science et les progrès technologiques ne peuvent pas nous donner une vision de ce qu’est la vie vraie et bonne. La raison seule ne peut pas définir ce qui devrait être le plus important pour nous — elle ne peut pas répondre à la question de savoir comment nous devrions vivre en tant qu’individus et en tant que communauté humaine. Pour cela, nous, croyants nous tournons vers Jésus-Christ.
Jésus est la mesure de notre humanité. Nous cherchons à nous élever, à atteindre, avec l’aide de la technologie, un état de connaissance, de pouvoir et de félicité comparable à celui de Dieu. Nous cherchons à devenir des dieux. Mais nous avons une image unilatérale et faussée de Dieu. En Jésus, le vrai Dieu a assumé nos limites et s’est mis au service des plus humbles :
lui qui est de condition divine, il n’a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s’est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s’est humilié lui-même en faisant preuve d’obéissance jusqu’à la mort, même la mort sur la croix. (Ph 2.6-8)
La venue du Christ a radicalement changé la façon dont nous devrions penser non seulement à Dieu, mais aussi à nous-mêmes. Si « l’essence même de Dieu est d’aimer et de servir », comme l’a écrit le philosophe allemand Max Scheler, alors ce qui ressemble le plus à Dieu, c’est l’amour qui se décentre de lui-même. C’est d’humblement considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes. C’est de nous préoccuper des intérêts des autres, et pas simplement des nôtres (voir Ph 2 v. 3-4).
Cela ne veut pas dire que les développements technologiques ne sont pas importants ou que nous devrions les craindre. Mais la question cruciale pour nous est de savoir si ceux-ci nous aident à aligner nos vies sur ce que révèle Jésus-Christ, ou s’ils y font obstacle. Ce que nous devrions craindre le plus, c’est un avenir dépourvu de foi en Christ et de bonté à son image.
Vers la fin du 21e siècle, entourés de technologies spectaculaires, il se pourrait, comme l’a imaginé Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, que la plupart des humains soient « conditionnés de telle sorte que, pratiquement, ils ne [pourraient] s’empêcher de se conduire comme ils le doivent. » Et si quoi que ce soit devait néanmoins aller de travers, un médicament miracle nous offrirait un « congé » pour nous « évader de la réalité ».
Pour Huxley, il y avait là une vision dystopique. Mais la persistance avec laquelle nous cherchons à éliminer la souffrance et à multiplier les plaisirs individualisés suggère que c’est bien là le genre d’avenir que nous voulons. Avec l’aide de la science et de la technologie, nous pourrions bien nous retrouver dans un tel monde.
Comme les porcs qui piétinent les perles dans l’enseignement de Jésus (Mt 7.6), nous nous serions alors détournés de ce qui compte le plus et nous aurions gaspillé ce qu’il y a de meilleur dans notre humanité. La question cruciale pour notre avenir reste donc toujours celle que posait Jésus à ses disciples, il y a deux millénaires : « Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Lc 18.8)
Miroslav Volf est professeur de théologie à l’université de Yale, directeur fondateur du Yale Center for Faith and Culture, et auteur de The Cost of Ambition: How Striving to Be Better Than Others Makes Us Worse (Brazos Press, 2025).
Traduit par Anne Haumont