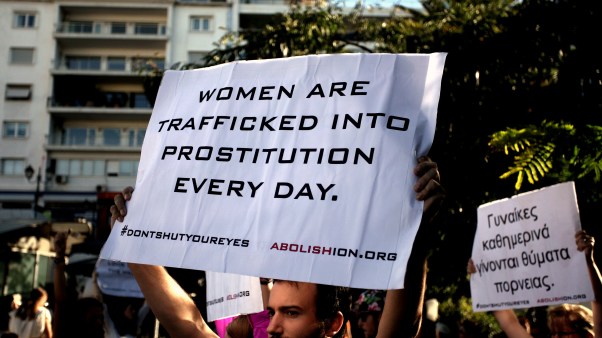« Un chrétien doit-il avoir l’esprit ouvert ? » Cette question posée par un de mes élèves m’a pris au dépourvu. Je me sentais coincé entre deux convictions opposées.
D’un côté, l’« ouverture d’esprit » semble aller à l’encontre de l’idée d’une marche sur le « chemin étroit ». Les chrétiens ne devraient-ils pas être caractérisés par une foi immuable et inébranlable ? Les lettres de Paul nous rappellent sans cesse qu’il faut « tenir ferme », s’accrocher résolument à la vérité au milieu du doute et de la confusion. L’ouverture d’esprit ne serait-elle pas une forme de faiblesse dans la foi ?
D’un autre côté, la Bible a beaucoup à nous dire sur l’humilité. Notre connaissance est tellement limitée et les voies de Dieu et de sa création sont si vastes. Cela ne devrait-il pas nous obliger à tempérer nos opinions ? La fermeture d’esprit ne serait-elle pas une forme d’orgueil intellectuel ?
Pour compliquer les choses, j’observe que des chrétiens réfléchis et bien intentionnés pourraient donner à mon élève des réponses très contrastées.
James Spiegel, professeur de philosophie et de religion, décrit l’ouverture d’esprit comme « un point d’équilibre entre deux vices intellectuels, une sorte de sommet qui surplombe les vallées du dogme et du doute » et y voit une « vertu particulièrement importante pour notre époque ».
À l’inverse, Burk Parsons, de Ligonier Ministries, écrit avec conviction : « En tant que fidèles déterminés et attachés au Christ, nous devons unir nos forces contre le pluralisme satanique de notre époque. » Cette approche de la question n’est pas rare parmi les chrétiens soucieux de fidélité biblique.
Qu’en penser ? Les chrétiens devraient-ils être connus pour leur ouverture d’esprit ou plutôt pour leur détermination résolue ?
Et s’il n’y avait pas de contradiction entre foi inébranlable et humilité intellectuelle ? La Bible nous offre en réalité la perspective combinée d’une vie de foi en la personne de Dieu et d’ouverture à la correction de notre compréhension limitée du monde.
Trop souvent, les chrétiens se sont fait connaître pour leur entêtement et leur orgueil intellectuel. Dans notre quête bien intentionnée de fidélité, nous avons laissé de côté quelque chose d’essentiel à la vie chrétienne : une profonde humilité qui exige une certaine forme d’ouverture d’esprit. Dans notre aspiration à la foi ferme que valorise l’Écriture, nous ne pouvons pas négliger la vertu biblique de l’humilité par rapport à ce que nous savons, ou « humilité épistémique ».
Pour ce faire, il faut d’abord distinguer clairement deux types de curiosité.
Pendant une grande partie de l’histoire de l’Église, la curiosité a été considérée comme un vice dangereux. Souvent associée à l’orgueil et à la vanité, on a tenu la curiosité pour responsable de certains des plus grands péchés de l’humanité. Dans un certain sens, même le premier péché d’Adam et Ève pourrait être imputé à la curiosité. Après tout, le Serpent a tenté Ève en lui promettant que ses yeux « s’ouvriraient » et qu’elle et Adam seraient « comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. » (Gn 3.5) N’est-ce pas le désir illicite d’une connaissance interdite qui a condamné l’humanité ?
Ce thème est repris ailleurs dans les Écritures. Paul met en garde Timothée contre la tentation inévitable pour les gens de « détourner leurs oreilles de la vérité et de dévier vers les fables. » (2 Tm 4.4) Il encourage aussi les Éphésiens à ne pas se laisser « ballotter par les flots et entraîner à tout vent d’enseignement » (Ep 4.14).
À la lumière de ces avertissements bibliques, bon nombre de chrétiens influents ont dénoncé les dangers de la curiosité. Augustin écrit dans ses Confessions que « la curiosité donne l’apparence d’un désir de connaissance ». Et il analyse sa propre lutte contre la luxure comme la manifestation d’une curiosité pécheresse.
Dans L’Imitation de Jésus-Christ, Thomas a Kempis mentionne ceux qui sont « menés par la curiosité et l’orgueil… tout en se négligeant eux-mêmes et en négligeant leur salut ». Ces personnes, prévient-il, risquent de « tomber dans de grandes tentations ».
Ces avertissements sont empreints d’une grande sagesse. Étant donné la corruption du cœur humain, la curiosité peut nous conduire là où nous ne devrions pas aller. Comme le disent Joseph Samuel Exell et Thomas Henry Leale dans leur commentaire de la Genèse : « Il est dangereux pour les intérêts de l’âme de se livrer à la vaine curiosité de connaître les mauvaises voies du monde ».
Dans la mesure où la curiosité peut donc être une expression d’orgueil et un vecteur de tentation, il est certainement juste que les chrétiens mettent en garde contre ce type d’ouverture d’esprit. Il y a bien des maux contre lesquels nous devons résolument protéger nos cœurs et nos esprits.
Il existe cependant une autre forme de curiosité : un ouverture d’esprit qui est l’expression de l’humilité et de la reconnaissance de nos propres limites. Les Écritures font l’éloge d’une telle attitude et mettent en garde contre l’arrogance de l’entêtement et l’orgueil intellectuel.
L’Écriture montre bien que le peuple de Dieu n’est généralement pas très réactif aux incitations, réceptif au changement ou prompt à écouter. Au contraire, si l’on devait désigner notre trait de caractère le plus constant à travers les millénaires, la dureté de nos cœurs et l’entêtement de nos esprits seraient probablement de très bons candidats.
« J’ai vu ce peuple, et voici, c’est un peuple à la nuque raide » (Ex 32.9). Voilà ce que dit le Seigneur à Moïse lorsque le peuple d’Israël se fabrique un veau d’or pour l’adorer au lieu de lui-même qui l’avait fait sortir d’Égypte.
« Toute la maison d’Israël a le front dur ; ce sont des obstinés. » (Ez 3.7) Le Seigneur avertit ainsi Ézéchiel que le peuple n’écoutera pas et ne changera pas d’attitude.
« Je sais que tu es rétif, que ta nuque est une barre de fer et que tu as un front de bronze. » (Es 48.4) Par la bouche d’Ésaïe, le Seigneur dénonce encore la dureté de cœur de son peuple.
Dans la pensée hébraïque ancienne, le cœur et l’esprit ne sont pas distingués l’un de l’autre comme centres des facultés émotionnelles et intellectuelles. Le cœur est considéré comme le centre de toute la personne, y compris l’intellect. Le théologien John Owen le formule ainsi : « En général [le cœur] désigne l’âme entière de l’homme et toutes ses facultés […] car toutes concourent à l’accomplissement du bien et du mal ».
Lorsque les Écritures hébraïques décrivent la perpétuelle dureté de cœur de l’humanité, elles ne décrivent pas seulement une réalité émotionnelle ou spirituelle. Elles parlent aussi de la profonde obstination intellectuelle qui caractérise la condition humaine dans son ensemble. Nous persistons à croire que nous savons ce qui est vrai, réel et bon, et nous résistons constamment à toutes les tentatives visant à changer nos cœurs et nos esprits.
En d’autres termes, nous tendons à avoir l’esprit fermé.
Cette obstination est précisément ce dont Dieu veut nous libérer dans la nouvelle alliance promise en Ézéchiel 36 : « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau ; j’ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » (v 26)
Telle est l’espérance portée par la nouvelle alliance : à la place de nos cœurs durs, nous recevrons des cœurs doux et réceptifs. La bonne nouvelle de l’Évangile est que nous pouvons renaître et être renouvelés. Nous pouvons devenir un peuple humble, obéissant, à l’écoute et désireux d’être transformé.
Pourtant, nous avons trouvé de nombreux moyens de perpétuer la tradition d’obstination et de dureté de cœur qui caractérisait le peuple d’Israël. Pour ne rien arranger, nous sommes parvenus à nous convaincre que cet entêtement est un fruit de l’Esprit plutôt qu’une faiblesse de la chair. Nous avons confondu entêtement intellectuel et fermeté dans la foi.
Dans un essai traduit en français sous le titre de « Foi et obstination », C. S. Lewis décrit la différence entre ces deux concepts. La foi chrétienne est une question de fidélité relationnelle : une confiance profonde dans la bonté de Dieu qui s’enracine dans une familiarité intime avec celui qu’il est à travers tous les âges. Lorsque nous apprenons à nous appuyer sur cette confiance, nous ne faisons pas preuve d’une obstination fermée. Nous faisons simplement confiance, de la même manière qu’un enfant fait confiance à un parent malgré sa perception limitée.
Ce type de confiance vertueuse n’est pas la même chose que l’entêtement intellectuel. Le refus d’envisager la possibilité d’une erreur dans notre propre jugement n’est pas une admirable expression de foi, mais une dangereuse forme d’arrogance. En d’autres termes, il existe une différence claire entre l’arrogance épistémique et la confiance relationnelle.
Qu’est-ce que cela veut dire pour notre questionnement sur l’ouverture d’esprit ? Cela signifie que l’appel chrétien à une foi inébranlable n’est en aucun cas contraire à un esprit d’humilité intellectuelle. Comme nous l’enseigne l’auteur de l’épître aux Hébreux, nous pouvons « continuer à reconnaître publiquement notre espérance, sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. » (Hé 10.23, italiques ajoutés)
La fermeté de ma foi ne doit pas être enracinée dans mon immobilisme ou dans mon entêtement quant à ma vision du monde, mais dans la fidélité indéfectible de celui qui m’a aimé et qui s’est donné pour moi. En regardant à Christ avec une confiance totale, nous pouvons être tout à fait cohérents avec la foi ferme décrite dans la Bible, tout en adoptant le type de douce humilité qu’elle recommande.
Dans son livre The Intolerance of Tolerance, D. A. Carson souligne que, en tant que chrétiens, nous avons plus de raisons que quiconque de considérer notre intelligence avec méfiance et de reconnaître le risque de nous tromper. « Nous, les chrétiens, avons les raisons les plus fortes de mener notre vie dans l’examen de nous-mêmes. Nous sommes peu crédibles si nous demandons aux non-croyants de faire preuve d’humilité épistémique tout en n’en étant pas nous-mêmes empreints. »
Et si nous voulons faire preuve d’humilité épistémique, nous devons commencer par reconsidérer notre propre théologie.
Il y a plus de 20 ans, le théologien américain Al Mohler mettait les chrétiens au défi de pratiquer le « tri théologique » comme expression de leur maturité spirituelle et intellectuelle. Il encourageait par là à classer judicieusement les diverses doctrines et idées chrétiennes en fonction de leur importance relative et du degré de certitude de chacune d’elles. Toutes les doctrines n’ont pas une importance de premier ordre et toutes les interprétations ne doivent pas être défendues bec et ongles. L’idée a aussi été reprise récemment par le théologien Gavin Ortlund.
Disons les choses clairement : la foi chrétienne repose sur certaines affirmations historiques et théologiques très précises. Sans croire et confesser les articles de foi relatifs à la venue réelle, la mort et la résurrection de Jésus, il n’y a pas de christianisme. L’appel à l’humilité n’est pas un appel à abandonner les fondements de notre foi et à embrasser le scepticisme postmoderne.
Une compréhension tout à fait biblique de l’humilité épistémique signifie au contraire se réjouir d’une relation avec le Dieu éternel dont le savoir vaste et intemporel dépasse de loin notre connaissance. Je ne suis peut-être pas certain de beaucoup de choses, mais j’ai décidé de suivre Jésus, le Fils unique de Dieu, parce qu’il m’a donné de bonnes raisons de lui faire confiance. À tel point qu’il vaut mieux que je lui fasse davantage confiance qu’à moi-même.
Jésus lui-même témoigne admirablement de cette humilité. Lui seul aurait pu aborder la vie avec une certitude absolue dans la plénitude de sa connaissance. Et pourtant, désireux de faire la volonté de son Père, il s’est soumis pleinement aux incertitudes de la vie humaine. Luc nous dit qu’il « grandissait en sagesse », se mettant à l’écoute des prêtres et leur posant des questions alors qu’il n’était encore qu’un enfant (2.52). Il enseignait avec l’autorité divine, mais avouait ouvertement qu’il y avait des choses qu’il ne connaissait pas et qu’il laissait entre les mains de son Père (Mt 24.36).
Si notre Seigneur Jésus avait cette humilité et l’exprimait, quelle excuse avons-nous pour agir autrement ?
À la lumière de tout cela, je me sens un peu plus confiant pour répondre à la question de mon élève. Oui, si nous comprenons bien ce que cela veut dire, les chrétiens devraient avoir l’esprit ouvert.
Être « ouvert d’esprit », pour nous, c’est permettre à Dieu de faire ce qu’il a promis : remplacer notre cœur de pierre par un cœur de chair — vivant, réceptif et en pleine croissance. C’est nous engager à rechercher la vérité, même si cela doit nous conduire à changer de position lorsqu’il s’avère que nous avions tort.
Par la grâce de Dieu, nos cœurs durs et entêtés peuvent être ramenés à la vie. Ne résistons pas à ce que fait l’Esprit pour nous rendre humbles et approchons-nous du trône de Dieu, le cœur adouci et la tête baissée. À l’image de Christ dans son humilité.
Benjamin Vincent est pasteur adjoint de l’Église Journey of Faith de Bellflower et directeur du département d’histoire et de théologie à la Pacifica Christian High School de Newport Beach, en Californie.
Traduit par Anne Haumont