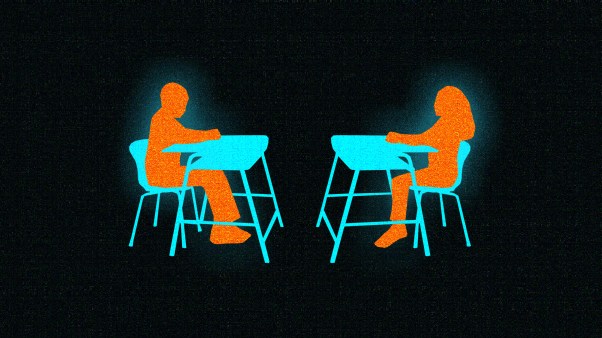L’enseignement biblique pousse généralement les chrétiens à encourager la soumission aux autorités, que ce soit en politique ou dans l’Église. On connaît bien les fameuses paroles de l’apôtre Paul : « Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. » (Rm 13.1)
Cependant, d’autres textes bibliques rappellent que notre loyauté envers ceux qui détiennent le pouvoir doit être inscrite dans le contexte de notre allégeance première à Dieu.
Parmi les exemples bien connus dans l’Ancien Testament, citons Shadrak, Méshak et Abednego, condamnés à mort pour avoir refusé de se prosterner devant la statue d’or du roi Nabuchodonosor (Dn 3.16-18), et Daniel, jeté aux lions pour avoir défié le décret du roi interdisant de prier un autre que lui. Dans le Nouveau Testament, on se souvient notamment de Pierre et Jean, jetés en prison pour avoir refusé de se conformer à l’ordre de cesser de prêcher au nom de Jésus, qui défendent ainsi leur position : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. » (Ac 5.29)
Mais j’aimerais attirer notre attention sur le premier chapitre de l’Exode, où deux personnages secondaires ont été jugés si importants pour l’histoire d’Israël que leurs noms, contrairement à ceux des puissants rois d’Égypte du livre, ont été conservés pour la postérité : Shiphra et Pua.
Face à la menace d’un pouvoir destructeur, ces deux femmes ont fait preuve d’un courage et d’une liberté intérieure qui peuvent encore inspirer la manière dont nous, chrétiens, travaillons et servons dans notre monde déchu. Leur audace à défier le Pharaon témoigne de ce que peut signifier servir et craindre le Seigneur face au mal.
Le livre de l’Exode poursuit l’histoire commencée dans la Genèse. D’un petit clan familial, Israël devient un peuple à part entière : « Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent ; ils devinrent très nombreux et puissants, au point de remplir le pays. » (Ex 1.7) Cette population étrangère croissante inquiète la puissance égyptienne.
Un nouveau pharaon surgit et suscite la peur chez ses compatriotes égyptiens, les convainquant que le peuple hébreu constitue une menace imminente pour la sécurité et le bien-être de leur nation. Dans son esprit, la présence d’un groupe de population non assimilé à la culture dominante de la société crée une dynamique d’opposition entre « eux » et « nous » : « Il dit à son peuple : “Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons ! Montrons-nous habiles vis-à-vis de lui.” » (Ex 1.9-10)
Pharaon commence par mettre les Israélites au travail, les opprimant par des corvées imposées. Mais les travaux de construction ne suffisent pas à empêcher les Hébreux de se multiplier. La volonté de contrôle contrariée se transforme alors en haine qui justifiera la plus terrible cruauté.
Le roi d’Égypte veut mettre un terme à l’épanouissement des Israélites, mais n’ose pas risquer la révolte de sa main-d’œuvre en s’attaquant aux adultes. Au lieu de cela, il opte pour une méthode lâche mais infaillible de déstabilisation et de démoralisation de la population. Il convoque deux sages-femmes des Hébreux, Shiphra et Pua, et leur demande de tuer tous les garçons nés des femmes de ce peuple.
Imaginez un instant l’horreur de ce que Pharaon veut imposer à ces femmes : étouffer un nouveau-né, ou peut-être lui briser la nuque, discrètement, juste à côté de sa mère qui vient d’accoucher. Dans la monstruosité de ses pensées, Pharaon veut faire d’elles des monstres et les rendre directement complices de son crime contre ceux qui sont en réalité ses semblables.
L’histoire prend cependant une autre direction : « Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d’Égypte : elles laissèrent vivre les enfants. » (Ex 1.17)
Leur action commune ne dépend pas avant tout de l’obéissance à une série de règles ou de prescriptions (nous sommes d’ailleurs avant Moïse et les Dix commandements), mais d’une vision de ce qui est juste et bon, ordonnée à leur crainte de Dieu que le texte mentionne explicitement. Elles ne se réfugient pas derrière un ordre qui viendrait d’en haut pour ne pas considérer les conséquences de leurs actes devant Dieu.
Lorsque Pharaon convoque les sages-femmes pour leur demander des comptes face à l’échec de son plan, leur réponse est simple : « C’est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l’arrivée de la sage-femme. » (Ex 1.19)
Que penser de ce mensonge dont l’Écriture — au contraire de certains commentateurs — ne semble guère leur tenir rigueur ? C’est une réelle question que soulève leur histoire.
Notons tout d’abord que l’exception ne fait pas la règle. La préoccupation claire et constante de la Bible pour la vérité interdit d’utiliser ce cas comme un chèque en blanc accordé à la tromperie. Mais il faut noter que l’on est là dans un cas de grande nécessité. Shiphra et Pua n’essayaient pas seulement de sauver leur tête, leur carrière ou leur réputation, mais aussi de protéger toute une communauté d’un danger très réel et immédiat.
D’un point de vue éthique, leur choix de recourir au mal du mensonge verbal semble de loin préférable au « mensonge » abominable consistant à traiter la vie humaine comme négligeable.
C’est ce vers quoi paraît cheminer le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer dans son essai inachevé intitulé « Que signifie dire la vérité ? ». Connu pour son opposition au régime nazi, le pasteur met en garde contre une « une notion de la vérité formelle et cynique » de type philosophique (kantien), qui ne tient pas compte de la réalité d’une situation ou d’une relation.
Tout en reconnaissant les risques de la formule, Bonhoeffer appelle à une « vérité vivante ».
« Le mensonge est donc la négation, la destruction consciente et intentionnelle de la réalité telle qu’elle a été créée par Dieu et qu’elle subsiste en lui, pour autant que cette négation et cette destruction s’accomplissent par la parole et par le silence », affirme-t-il. Selon cette définition, il y a bien plus de mensonge en Pharaon qu’en Shiphra et Pua. En réalité, leur audace dit bien la vérité sur l’échec absolu auquel sont voués les plans du roi d’Égypte visant à défier la volonté du Dieu d’Israël pour son peuple.
Ensemble, Shiphra et Pua refusent d’être les petits rouages d’une violente machine politique. Et c’est à la suite de leur action qu’entre en scène le Dieu de l’Exode — non seulement pour leur épargner mystérieusement la colère du roi égyptien, mais aussi pour leur témoigner de la bonté et bénir leurs familles pour leur action (v. 20).
Mais l’antique roi d’Égypte n’était certainement pas le premier ni le dernier à envisager de telles horreurs. Dans un parallèle biblique significatif, le récit de l’Avent est marqué par le massacre des garçons de toute une ville, ordonné par le roi Hérode, un autre puissant saisi de paranoïa face à la rumeur d’un « roi des Juifs » qui viendrait de naître (Mt 2.16-18).
Dans les deux cas, des despotes tyranniques déshumanisent directement ou indirectement une population vulnérable, n’y voyant rien de plus qu’un simple problème politique ou démographique à résoudre afin de protéger leur propre pouvoir et leur contrôle.
Dans un acte de désobéissance analogue à celui des sages-femmes de l’Exode, les mages défieront l’ordre d’Hérode de revenir et de faire un rapport sur le lieu où se trouvait l’enfant, afin de protéger la vie de Jésus. Et, tout comme le Pharaon finit par trouver d’autres volontaires pour exécuter ses ordres malfaisants, Hérode fera de même.
Tout système oppressif repose sur des individus qui acceptent d’obéir sans réfléchir, sans considérer les conséquences morales de leurs actes sur eux-mêmes et d’autres individus. Tout au long de l’histoire, les gros poissons ont souvent laissé aux plus petits le soin de faire le sale boulot. Mais les hiérarchies de notre monde ne permettent à personne de se décharger de ses responsabilités devant Dieu et le reste de l’humanité.
Pour suivre de tels ordres d’un Pharaon ou d’un Hérode, il faut accepter de se transformer en robot : quelqu’un qui exécute simplement les ordres sans état d’âme, sans réflexion indépendante. Quelqu’un qui ne se laisse plus toucher par la brutalité de ses propres agissements, et se dit simplement qu’il fait son devoir. Il faut pour cela donner la priorité à la faveur des hommes plutôt qu’à ce qui est bon aux yeux de Dieu.
Mais lorsque nous remettons en cause l’humanité de l’autre, lorsque nous le traitons comme moins qu’humain, c’est aussi notre propre humanité que nous abîmons. Si l’autre — quel qu’il soit — peut n’être qu’un numéro, une statistique, un problème à régler, qui m’assure que je ne serai pas traité ainsi à mon tour ?
De nombreux exemples historiques, dont le tragique destin de Bonhoeffer lui-même, montrent assurément que la résistance au mal n’est pas sans risque. Cependant, les sages-femmes et les mages nous rappellent que Dieu est le personnage principal de l’histoire et que c’est à lui que nous devons rendre des comptes et prêter allégeance.
À quelque échelle que ce soit, chaque génération de croyants sera confrontée à des dirigeants abusifs qui méprisent ce que Dieu chérit et saccagent ce qu’il a créé. Mais à chaque époque, nous sommes appelés à nous aligner sur la vérité vivante de Dieu plutôt que sur les mensonges destructeurs des puissances terrestres.
Je crois que c’est la raison pour laquelle les auteurs bibliques ont conservé les noms de personnages secondaires comme Shiphra et Pua : pour nous aider, en tant que peuple de Dieu, à persévérer dans la crainte de Dieu lorsque le monde nous appelle à nous joindre à ses méfaits.
Léo Lehmann est coordinateur du travail en français de CT et directeur des publications du Réseau de missiologie évangélique pour l’Europe francophone (REMEEF). Il vit en Belgique.
Une première version de cet article est parue sur le blog Servir Ensemble.