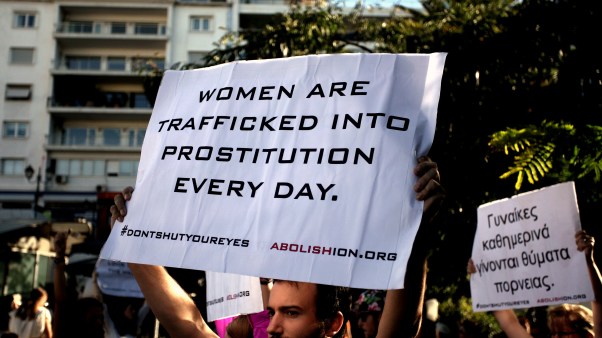Je me revois encore assise à mon bureau, cochant les petites cases blanches au fur et à mesure que je parcourais la page, un crayon à la main. J’avais environ 13 ans et je n’avais jamais passé un test à choix multiples comme celui-ci. Que me diraient les résultats à mon sujet ? Qu’est-ce que cela signifierait pour mon avenir ?
Les réponses ne devaient pas souligner mes compétences en mathématiques ou en sciences sociales, mais mes dons spirituels. Le test était l’aboutissement d’un cours que j’avais suivi dans mon église. Plusieurs semaines de suite, nous nous étions retrouvés dans une salle de classe austère et dépouillée pour apprendre comment le Saint-Esprit donnait à chacun d’entre nous des capacités spéciales à utiliser dans le ministère. J’étais impatiente de savoir comment Dieu se servirait de moi pour édifier son royaume.
Après le décompte des petites cases, je me suis tournée avec un mélange de fierté et de tremblement vers les résultats. Le don d’enseignement se manifestait avec force. La générosité obtenait également un score élevé. À mon embarras, le don de miséricorde apparaissait par contre à peine. J’avais du mal à définir certains autres dons. Que signifiait le don de prophétie ? Serais-je en mesure de jeter un coup d’œil dans le futur ?
Trente ans plus tard, je peux dire que le test avait vu juste à certains égards, en particulier en ce qui concerne l’enseignement. Mais j’ai aussi pris conscience d’une de ses importantes limites. Son approche individualiste des dons spirituels passe à côté de l’essentiel.
L’apôtre Paul consacre plus d’attention aux dons spirituels que tout autre auteur biblique. Pourtant, je ne l’imagine pas en train de se pencher sur une grille d’autoévaluation des dons spirituels ou de se présenter fièrement comme un type 1 de l’ennéagramme. En parlant de dons, Paul ne se préoccupait pas de développement personnel ou de découverte de soi.
La notion de don prête aujourd’hui à confusion. En français, un don peut être quelque chose que l’on offre à quelqu’un, mais aussi une capacité que possède un individu. On peut ainsi dire d’une personne qu’elle a, par exemple, un véritable don pour l’écriture. Ce n’est pas ce que Paul avait à l’esprit.
Pour désigner les différents services auxquels Dieu appelle les croyants, l’apôtre emploie le mot charisma. Charisma, ou « don », trouve sa source dans le mot grec exprimant la « grâce » (charis). Ce que nous désignons comme « dons spirituels » sont en quelque sorte censés être une incarnation de la grâce. C’est nous qui sommes des dons les uns pour les autres.
Pour comprendre ce que veut dire Paul lorsqu’il traite des dons spirituels, il faut comprendre comment il concevait la grâce. Nous associons généralement la grâce à la faveur imméritée de Dieu par laquelle nous sommes sauvés, une notion tout à fait légitime. Mais pour les croyants du premier siècle, le mot grâce n’était pas un mot religieux. Il se rapportait au lien social qui unissait les uns aux autres dans une relation de dépendance mutuelle.
Un peu d’histoire de l’art pourrait nous aider à comprendre cette notion. Les trois Grâces de la mythologie grecque illustrent bien l’idée que l’on se faisait de la grâce dans le monde de Paul. Une peinture du 15e siècle représente ces Grâces sous la forme d’un trio de jeunes femmes dansant, chacune joignant les mains aux autres pour former un cercle. Dans ce détail du Printemps de Sandro Botticelli, les vêtements des femmes sont presque transparents ; comme la générosité d’un cadeau, rien n’est retenu. Ensemble, elles sont supposées évoquer les trois dimensions de la grâce : la générosité du donateur, le don lui-même et la gratitude qu’il suscite.

Chaque grâce a toujours besoin de l’autre. Une grâce laissée seule est incomplète, comme le serait un cadeau reçu sans gratitude. Les femmes du tableau se tiennent sur la pointe des pieds, suggérant le mouvement. Leur gracieux tournoiement illustre l’échange permanent qui les unit. Voilà ce qu’est la grâce dans la pensée du premier siècle.
Dans l’Occident moderne, nous préférons les cadeaux dépourvus de conditions : ils préservent notre autonomie en nous évitant un sentiment de redevabilité. Dans le contexte collectiviste de Paul, le don n’était jamais un acte isolé, mais s’intégrait dans une danse perpétuelle entre le donateur et le bénéficiaire, qui créait interdépendance et joie partagée.
Le don d’une grâce était une invitation à entrer dans une communauté, avec les privilèges et les obligations qui en découlaient. Accepter un don signifiait accepter tout ce qu’il impliquait, y compris le devoir de rendre la grâce au donateur en utilisant le don d’une manière honorable. En d’autres termes, les cadeaux étaient assortis de conditions destinées à favoriser la construction de la communauté.
Chaque fois que Paul parle de « grâce » qui est « donnée » — et il le fait au moins 12 fois dans ses lettres — il se réfère à des responsabilités confiées pour le service. La version Semeur traduit ainsi l’un de ces passages : « chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. » (Ep 4.7) Il ne s’agit pas ici de la grâce salvatrice. Paul ne parle pas non plus de superpouvoirs individuels. Il est sur le point de dresser une liste de responsabilités dans le service. Ses termes correspondent d’ailleurs ici à ce qu’il dit plus tôt de son propre ministère, au chapitre 3, lorsqu’il affirme : « j’ai reçu la grâce d’annoncer parmi les non-Juifs les richesses infinies de Christ » (3.8).
L’idée que la grâce est appelée à circuler est très claire dans les écrits de Paul. Pour lui, la grâce que Dieu donne relève davantage d’une responsabilité dans le service que d’une capacité particulière. Et l’apôtre est explicite quant à l’objectif de ce genre de vocation :
C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l’a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l’adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. (4.11–13)
Paul ne parle pas ici des dons spirituels comme de cadeaux divins arrivant sur le pas de la porte de chacun. Il y voit des personnes envoyées pour édifier l’Église. En offrant nos services à nos communautés ecclésiales, nous laissons circuler ces dons vers d’autres personnes. Nous devenons dons pour eux.
Les dons, ou grâces, que Dieu a accordés à son Église sont des personnes qui cultivent la maturité collective en faisant ce que Dieu les a appelées à faire. Ces dons ne fonctionnent pas de manière isolée et nous ne devons pas les garder pour nous. Comme certains l’ont appris à l’école du dimanche, nos petites lumières ne sont pas destinées à être cachées sous un panier. Elles sont faites pour briller.
Paul nous appelle tous à utiliser les dons que Dieu nous a accordés en faveur des autres. Nous ne mettons pas en œuvre nos dons en nous concentrant sur nous-mêmes, mais en administrant collectivement les grâces de Dieu. Les pressions de la vie ou la dynamique de nos communautés peuvent nous pousser à faire tapisserie, mais nous sommes faits pour la piste de danse.
Retenir nos dons spirituels — nos possibilités de service et notre propre personne — revient à appauvrir nos communautés. Paul écrit : « à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour le bien de tous » (1 Co 12.7). Nous ne recevons pas seulement les dons de l’Esprit : nous sommes les dons de l’Esprit les uns pour les autres.
Et ces dons sont censés nous lier les uns aux autres. Si l’Église refuse d’accueillir quelqu’un qui œuvre pour remplir la mission que Dieu lui a confiée, le tournoiement de la grâce est interrompu.
La grâce de Paul — son appel de Dieu — était d’apporter l’Évangile aux païens. Cette grâce le poussait à mettre en œuvre ses dons au service de l’Église, même si elle ne sut pas toujours que faire de lui.
L’apôtre se présente aux Galates comme « Paul, apôtre établi non par des hommes ni par l’intermédiaire d’un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l’a ressuscité. » (Ga 1.1) Il savait que son appel provenait Dieu. Il avait été envoyé. C’était un don. Il savait qu’il n’avait pas d’autre choix que de répondre à cette grâce de Dieu en servant les autres, même si ce service s’accompagnait de grandes souffrances et de sacrifices personnels.
Je me demande si nos évaluations des dons spirituels et nos tests de personnalité ne nous limitent pas à nos zones de confort alors que nous pourrions être destinés à plus. Les grâces ne correspondent pas toujours à nos dons et capacités naturels ; parfois, Dieu nous appelle à servir l’Église d’une manière inconfortable. Il ne s’agit pas de se réaliser, mais de servir.
La miséricorde était mon score le plus bas lors de mon test sur les dons spirituels dans les années 90. Sur la base de ce test, il était logique que je devienne enseignante biblique plutôt qu’infirmière en soins palliatifs. Le rôle d’aidant n’est pas naturel pour moi. Cependant, Dieu m’a récemment confié une nouvelle mission, celle de soutenir un membre de ma famille atteint de démence. À ma grande surprise, le voyage se passe plutôt bien jusqu’à présent. Je peux sentir la puissance de l’Esprit lorsque je collabore avec d’autres croyants qui sont également là pour aider. J’aurais manqué bien des choses en refusant cette mission.
Mon test des dons spirituels n’aurait pas permis de le prévoir. Il supposait que je devais regarder en moi-même pour découvrir un superpouvoir spirituel caché qui m’aiderait à décider de la manière dont je devais mener ma vie. Il me semblerait aujourd’hui plus juste de demander à Dieu dans la prière, en collaboration avec notre communauté, où il veut que chacun d’entre nous serve, puis de chercher à servir fidèlement en ce sens. Les appels sont souvent discernés en commun.
Nous avons besoin les uns des autres pour devenir le type de communauté chrétienne par lequel la présence de Dieu se manifeste au monde. C’est ainsi que nous pourrons expérimenter la plénitude de la grâce de Dieu dans tous les sens du terme.
Carmen Joy Imes est professeure associée d’Ancien Testament à l’Université Biola et autrice de Bearing God’s Name et Being God’s Image. Elle écrit actuellement son prochain livre, Becoming God’s Family: Why the Church Still Matters.