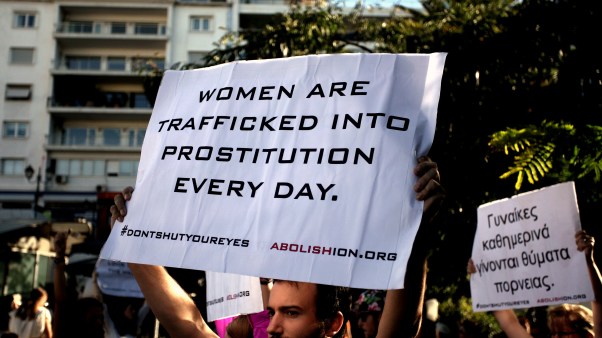Le pasteur Frederic Nozil a appris à faire profil bas.
L’année dernière, année de ses 53 ans, des gangs ont attaqué son quartier de Pétion-Ville, une banlieue surplombant la capitale d’Haïti, Port-au-Prince. Ils ont saccagé la maison qu’il louait et y ont mis le feu. Le pasteur est parti s’installer avec sa femme et ses deux filles dans un endroit plus sûr, à quelques kilomètres de là.
Pourtant, il reste très prudent. Cette année, il a fêté ses 54 ans chez lui, discrètement. Quelques personnes de son église ont apporté un gâteau. Ils ne sont pas restés plus d’une heure. « Les fêtes attirent l’attention », dit-il. « On ne peut pas trop ouvertement célébrer. »
Il planifie les activités de l’église pour qu’elles se terminent avant le couvre-feu obligatoire. Il interrompt la réunion de prière s’il a un mauvais pressentiment au sujet d’un véhicule de police remarqué dans la rue. Certains de ses fidèles risquent leur vie en franchissant les barrages des gangs pour se rendre à l’église, le Centre Chrétien International Maison d’Adoration, et il sait donc qu’il faut s’attendre à une plus faible affluence.
La fin du monde, conclut-il, transforme le ministère. « Nous vivons des temps eschatologiques. »
C’est ce qu’il a ressenti aux premières heures du 18 mars. C’était un lundi, et le pasteur aurait dû être en train de se remettre de l’habituelle série d’obligations pastorales du dimanche. Au lieu de cela, il s’est retrouvé à s’enfermer dans sa maison pendant deux jours d’affilée, tandis que des tirs nourris résonnaient dans les collines.
Des membres de gangs cagoulés traversaient son quartier en voiture et à moto, remontant la route principale vers les montagnes. Ils ont tiré à l’arme automatique et ont laissé au moins une douzaine de passants morts dans leur sillage. Ils se sont arrêtés dans une enclave protégée appelée Laboule et ont assiégé ses résidences fortifiées. Dans une maison, les caméras de sécurité ont filmé de jeunes hommes armés portant des sacs à dos qui pénétraient de force dans une cour pavée et inspectaient des véhicules tout-terrain stationnés là.
Dans une maison voisine, un homme a échappé aux assaillants, puis a passé un coup de téléphone désespéré à un pasteur alors situé à 1 600 kilomètres de là. Tout peut arriver lorsqu’approche la fin du monde.
Roselin « RoRo » Eustache rentrait en voiture de ses courses lorsque le nom de Miradin Morlan est apparu sur son téléphone. Le pasteur Eustache est coincé à Houston depuis des mois, chez des membres de sa famille, dans l’impossibilité de retourner en Haïti puisque des gangs ont fermé le principal aéroport international du pays et bloqué toutes les voies d’accès à son domicile et à la mission qu’il dirige là-bas.
En décrochant cet appel d’une vieille connaissance — l’ancien chef de la Direction générale des Impôts — c’est une supplique paniquée qu’il a entendu : Pasteur, sauvez ma vie !
Miradin Morlan lui a décrit comment lui et sa femme fuyaient Laboule à pied. Des gangs s’étaient introduits dans leur maison, l’avaient menacé d’une arme, avaient tenté de le kidnapper et avaient dévalisé toutes les pièces. Ils avaient volé ses voitures. Ses agents de sécurité privés avaient pris leurs jambes à leur cou.
Tandis qu’il essayait de mettre de la distance entre lui et ses agresseurs, le fonctionnaire s’est souvenu de l’hôpital de la mission de Roselin Eustache, un endroit situé dans le sud d’Haïti où il avait déjà subi une opération du genou. Le pasteur l’avait déjà aidé auparavant ; le ferait-il à nouveau ? Celui-ci a contacté un chauffeur pour lui demander de venir à leur rencontre.
Le couple a trouvé une moto de location pour franchir un col de montagne et emprunter une route qui, par endroits, n’est guère plus qu’un sentier de randonnée. En chemin, sa femme est tombée et s’est cassé le bras. Après des heures de voyage, pour environ une trentaine de kilomètres, ils ont finalement retrouvé le chauffeur dans une ville appelée Seguin, à la lisière des pins de l’un des rares parcs nationaux d’Haïti.
« Je suis encore sous le choc », dit l’ancien responsable des impôts, quelques jours plus tard, dans un refuge à la campagne où il a du mal à trouver ne serait-ce que du papier toilette. « C’est vraiment incompréhensible. »
Malheureusement, sa situation est loin d’être exceptionnelle.
Les déplacements forcés sont monnaie courante pour les quelque 4 millions d’habitants de Port-au-Prince et de ses environs. Les gangs contrôlent plus de 80 % de la ville, où vit environ un tiers des Haïtiens. Les bandits, comme de nombreux Haïtiens les appellent, ont tué plus de 1 500 personnes au cours des seuls trois premiers mois de 2024.
Selon les Nations unies, près de 400 000 Haïtiens ont fui la violence des gangs. Des hommes armés ont chassé les habitants de bidonvilles, de villages, de résidences protégées, de fermes…
Les déplacements massifs de population transforment la vie quotidienne bien au-delà de la capitale ravagée par la violence. Les gangs ont pris le dessus sur la police nationale et ont poussé vers le nord, en direction de la mosaïque des rizières d’Haïti, et vers l’ouest et ses horizons dessinés par les bananiers et les champs de canne à sucre.
La violence actuelle aggrave une crise alimentaire qui laisse plus d’un million d’Haïtiens en danger de famine. Elle réduit à néant ce qu’ont pu mettre de côté les familles et met à rude épreuve les ressources de communautés déjà très éprouvées.
Le mois de mars dernier a été le pire : plus de 53 000 Haïtiens ont été contraints de quitter leur foyer. Pour des pasteurs comme Frederic Nozil et Roselin Eustache, comme pour les responsables chrétiens de tout Haïti, cette précarité — voire en fait l’effondrement de tout leur univers — est venue redéfinir le ministère.
« C’est toute ma vie », nous dit Roselin Eustache. Certains membres du personnel de sa mission, Haitian Christian Outreach, ont été déplacés jusqu’à quatre fois, trouvant abri dans diverses écoles et autres infrastructures publiques au fur et à mesure qu’évoluaient les frontières des gangs.
La police locale s’est même tournée vers la mission, rapporte un membre du personnel. Certains agents n’ont pas été payés depuis des mois et se battent pour trouver de la nourriture et des lits pour ceux qui dorment à même le sol du commissariat. La mission avait déjà apporté son aide par le passé, allant jusqu’à prêter aux policiers des Land Cruiser lorsque leurs véhicules étaient en panne.
« Je dois faire quelque chose », dit le pasteur. « Parce que chaque fois que nous avons besoin d’eux, ils sont là pour nous. »
Les Haïtiens expriment couramment leur mécontentement à l’égard des hommes politiques par l’appel au rache manyòk. Cette expression qu’on pourrait traduire littéralement par « arracher le manioc » désigne ce que fait un agriculteur lorsqu’il saisit la longue tige de cette plante pour en racler la terre qui la salit, du tubercule à la feuille.
Depuis des décennies, les rache manyòk ponctuent les manifestations de rue et ciblent les responsables élus sur les réseaux sociaux. D’autres, plus virulents encore, prônent le dechoukaj, ou « déracinement ».
Mais Haïti n’a maintenant plus de dirigeants élus. Les dernières élections remontent à il y a huit ans. En l’absence de pouvoir stable, les experts estiment que pas moins de 200 gangs ont vu le jour.
En février, plusieurs de ces gangs ont conclu une alliance qui leur a permis de s’attaquer aux bureaux gouvernementaux et d’ouvrir les deux plus grandes prisons du pays. Ils ont menacé d’achever leur conquête en occupant l’aéroport principal et le Palais national, siège emblématique du gouvernement haïtien.
Cette semaine, un nouveau conseil de gouvernement transitoire composé de neuf membres doit entamer la tâche qui lui a été confiée par les États-Unis et la Communauté des Caraïbes, composée de 15 pays : mettre fin à la violence et, par quelque miracle, préparer le pays à la tenue de nouvelles élections.
Ils héritent d’une nation dévastée.
Si vous deviez marquer les dégâts infligés au pays au moyen d’épingles plantées sur une carte géante, vous commenceriez probablement par Port-au-Prince. Vous pourriez tout d’abord planter une douzaine d’épingles représentant les pharmacies que les gangs ont brûlées près de l’hôpital général du centre-ville et de la plupart de ses installations médicales, en grande partie hors service.
Vous planteriez aussi une épingle à l’emplacement de l’ancien campus du Séminaire théologique évangélique de Port-au-Prince, une rare oasis de verdure avec un bâtiment universitaire flambant neuf finalement reconstruit après le tremblement de terre de 2010. Trois ans à peine après la reconstruction, en 2020, les gangs s’en sont emparés.
S’y ajouteraient des églises incendiées ou dont les vitres ont été brisées, des usines et des concessionnaires automobiles. Deux épingles marqueraient aussi l’École nationale des arts vandalisée et la Bibliothèque nationale, dépositaire des documents historiques de la première république noire du monde, qui a été pillée.
Après avoir planté bien plus de mille épingles sur la capitale, n’importe quelle route qui en sort vous permettrait de continuer votre recensement. En empruntant la route nationale 1 sur quelques kilomètres, vous marqueriez le pillage de plusieurs infrastructures missionnaires américaines.
Près de la ville de Titanyen, une épingle signalerait le campus de Christian Aid Ministries, où un groupe de missionnaires anabaptistes enlevés ont retrouvé leurs proches après s’être échappés fin 2021 et dont des gangs ont depuis pris le contrôle. À côté, sur le terrain d’un ministère originaire du Mississippi, des gangs ont percé un trou dans le mur d’enceinte en béton, vidé des conteneurs d’expédition et arraché des panneaux solaires des toits.
Avec toutes ces épingles, vous n’auriez fait qu’effleurer la surface. Vous seriez encore à huit kilomètres de la ville de Cabaret, où le poste de police, comme bien d’autres avant lui, a brûlé au début du mois de mars.
Cabaret est un petit centre régional, une ville à la forme d’amphithéâtre au détour d’une autoroute. Ce dont les gens se souviennent, c’est que le 3 mars, aucun téléphone ne fonctionnait — les pénuries de carburant et les barrages routiers empêchent souvent les fournisseurs de services téléphoniques d’alimenter leurs antennes.
Vers l’heure du repas de midi, un père de famille qui se trouvait sur le marché a entendu quelqu’un crier : « Les hommes arrivent ! » Il s’est précipité chez lui, a attrapé ses quatre enfants et s’est enfui. Alors qu’ils couraient au milieu des tirs, son fils de sept ans a reçu une balle dans la jambe.
Oltina, l’une des rares habitantes interrogées à avoir accepté de nous donner son nom, avait fui une autre ville moins d’un mois auparavant. Elle était dehors lorsque la fusillade a éclaté autour d’elle. En se précipitant pour retrouver ses enfants, elle a trébuché sur une casserole de haricots qui cuisait sur le feu et s’est brûlé le pied dans l’eau bouillante. Pendant plusieurs heures, elle s’est cachée avec ses deux enfants dans un jardin.
Une autre femme a déclaré avoir vu des bandits enlever son mari alors qu’elle s’échappait avec leur fils de deux mois.
Des maisons ont été brûlées. Les magasins et les étals de marché, fruits d’années de travail, ont été abandonnés. Les économies, les passeports et les photos de famille ont été perdus alors que toute une communauté s’est réfugiée dans les montagnes.
Sans téléphone et sans moyen de coordination, les personnes déplacées se sont dispersées depuis Cabaret, là où l’instinct les guidait ou là où elles pensaient connaître quelqu’un.
Dans un village situé à environ huit kilomètres de là, une jeune mère a ouvert sa porte à une femme plus âgée qu’elle n’avait jamais vue auparavant. L’étrangère était accompagnée de quatre enfants et son mari avait été tué d’une balle dans l’estomac en tentant de défendre leur maison à Cabaret. Leurs parents au village n’avaient pas de place pour eux.
« Faites comme si c’était votre maison », leur a dit la jeune mère, qui a demandé à ce que ni elle ni sa ville ne soient identifiées, de peur que les gangs ne s’en prennent à son quartier.
Dans la même communauté, une autre femme, âgée d’une vingtaine d’années et travaillant pour le ministère américain Real Hope for Haiti, a trouvé plus d’une douzaine de personnes de Cabaret en arrivant chez elle. Une amie avait laissé entendre qu’ils seraient les bienvenus chez elle.
Elle a finalement accueilli 17 réfugiés dans sa maison de deux chambres. Elle a renoncé à son propre lit. Pour l’instant, elle dort ailleurs et passe chaque jour pour mettre les vêtements dont elle a besoin dans un sac en plastique. Le soir, elle prie avec ses hôtes ; l’une d’elles, une jeune fille, souffre de crises d’angoisse.
« Ce n’est pas facile d’accueillir des étrangers », dit la femme. « Mais si Dieu accueille tout le monde, nous pouvons accueillir quelques personnes qui tentent d’échapper aux gangs. »
Un fonctionnaire estime que plusieurs milliers de personnes ont été déplacées vers le village au cours de l’année écoulée. Les habitants se sont habitués, autant que l’on peut, à ce que des étrangers errent dans leurs rues, sollicitant de la nourriture ou un endroit où dormir.
Dans les dix églises des environs, les pasteurs affirment que la fréquentation est en hausse. Certains cultes font plus que salle comble, les fidèles apportant leurs propres chaises. Des églises tentent d’adopter des familles déplacées dont elles s’occupent. Les gens ont coupé des bananes et des fruits d’arbre à pain dans leur jardin et les ont apportés aux voyageurs. Ils ont fait don de tapis et de nattes pour dormir.
Les responsables d’église de tout le pays font état de situations similaires, en particulier dans le sud, où se sont réfugiées la plupart des personnes déplacées cette année, selon les Nations unies.
Mais Lori Moise, qui dirige la clinique Real Hope for Haiti, met en garde les gens contre l’impression d’un réveil spirituel comme elle se souvient en avoir vu après le tremblement de terre de 2010.
« Il y a beaucoup de gens qui s’attachent à Dieu de tout leur cœur. D’autres ont quitté l’église parce qu’ils ne voient pas de réponse à leurs prières et que la souffrance est permanente », dit-elle. Sa clinique a soigné les blessures par balle de survivants qui se sont réfugiés dans leur quartier.
« Lorsque la violence des gangs a commencé, les gens ont davantage prié et parlé de Dieu. À présent je vois le désespoir s’abattre sur la plupart. L’une des qualités que les étrangers remarquent chez les Haïtiens est leur résilience et leur espérance. J’ai l’impression que les deux sont en train de faiblir. »
Le nombre d’Haïtiens déplacés à l’intérieur du pays a aussi augmenté parce qu’il est devenu extrêmement difficile de quitter le pays. Le principal aéroport international et domestique de Port-au-Prince est fermé depuis le début du mois de mars, après que des avions stationnés ont été touchés par des balles. La République dominicaine voisine a fermé sa frontière aux ressortissants haïtiens.
Mais ce n’est qu’une pause ; les départs vers l’étranger reprendront dès que les guichets des compagnies aériennes rouvriront.
Les Haïtiens qui ont déjà fui vers l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale ont déposé un nombre record de demandes d’asile au Mexique. Aux États-Unis, 168 000 Haïtiens ont obtenu un permis de séjour temporaire dans le cadre d’un programme d’accueil humanitaire d’urgence mis en place par l’administration Biden l’année dernière. Parmi eux, plusieurs milliers comptent parmi les personnes les mieux formées d’Haïti.
Presque tout le monde a une histoire à raconter à propos de ceux qui sont partis : une église dans le nord où tout le conseil des anciens a émigré ; un hôpital missionnaire dans une région centrale privé d’un tiers de son personnel. Haitian Christian Outreach, le ministère de Roselin Eustache, a perdu huit employés, dont des enseignants et trois médecins, qui ont profité du programme américain d’émigration. Toute l’équipe musicale du pasteur Nozil a disparu. Reginald Pyrhus, pasteur de l’Église Baptiste Bérée à Port-au-Prince, explique que la moitié des fidèles de la classe moyenne ont quitté le territoire. Beaucoup se rendent aux États-Unis.
Et là n’est pas la seule perte en matière de cerveaux pour le pays. Toute une génération d’Haïtiens en âge d’entrer à l’université ne peut pas entamer ses études de médecine, de droit ou dans bien d’autres programmes de formation. La plupart ont été forcés à mettre leurs études en suspens. Un grand nombre de ceux qui ont tout de même suivi des cours ne peuvent pas se présenter aux examens de certification, car ceux-ci ne sont pas organisés. Par conséquent, lorsque les établissements médicaux finiront par rouvrir leurs portes, il y aura une grave pénurie de personnes compétentes pour prendre la relève.
« C’est un grand problème », dit Roselin Eustache. « Il nous faudra du temps pour retrouver de bons médecins. »
Il faudra également attendre un certain temps avant que les missionnaires et autres travailleurs humanitaires ne reviennent. La plupart des étrangers se sont retirés d’Haïti il y a plusieurs années, suivant des avertissements de plus en plus nombreux adressés par leurs autorités nationales. Pour les quelques irréductibles qui sont restés, la fermeture de l’aéroport en mars a été un point de rupture. Des missionnaires racontent des histoires d’évacuation sur des pistes de campagne et de sauvetage par hélicoptère effectués par un groupe privé. Nom de code de l’opération : Rum Runner, ou « contrebandier ».
David Selvey, le directeur américain de la Haitian American Friendship Foundation, une mission qui opère dans le plateau central du pays, a quitté Haïti avec un groupe de missionnaires qui ont traversé une rivière les séparant de la République dominicaine à bord de pirogues. Quelqu’un l’a mis en contact avec un pasteur dominicain qui a mis quatre heures à traverser le pays pour les récupérer à la frontière.
« Il est étonnant de voir avec quelle rapidité le peuple de Dieu se mobilise pour aider les membres de la famille de Dieu qui sont en difficulté ou ont un problème », souligne David Selvey. « Et cela même sans que l’on se connaisse. »
Don Allensworth souhaiterait que beaucoup plus de personnes s’engagent.
Il est directeur du développement de Mission of Hope, un ministère qui a longtemps opéré à partir d’un complexe à Titanyen, entre Port-au-Prince et Cabaret. Les campus voisins ayant été envahis par des gangs, l’organisation a déménagé au Cap-Haïtien, dans le nord du pays.
Les partenaires de ce ministère à travers Haïti envoient des rapports par SMS presque quotidiennement. À Jérémie, une ville du sud-ouest, des gens ont découvert à leur réveil des personnes âgées et des enfants morts de faim pendant la nuit.
« Haïti est actuellement confronté à la plus grande crise humanitaire de son histoire, et il n’est pas acceptable que des gens meurent de faim », dit le missionnaire. « Je me moque de savoir si vous êtes chrétien ou non. Si vous êtes un être humain, il n’est pas acceptable que des gens meurent de faim. »
Autrefois l’un des principaux appuis pour les voyages missionnaires à court terme en Haïti, Mission of Hope concentre aujourd’hui une grande partie de son énergie sur l’aide alimentaire. Les gangs bloquant le principal port maritime du pays, l’association est allée jusqu’à contacter des compagnies de plaisance pour trouver de nouveaux moyens d’acheminer les centaines de milliers de repas qu’elle distribue chaque mois.
Mais son directeur ne veut pas que Mission of Hope se reconvertisse entièrement dans l’aide alimentaire. Il souhaite que la violence cesse, que les enfants retournent à l’école à plein temps et que le personnel haïtien de l’organisation puisse travailler sans craindre pour sa vie.
« Le peuple haïtien veut simplement avoir la possibilité de vivre et de prendre des décisions pour lui-même », dit Don Allensworth. « Ils ont besoin d’être libres. »
Pour aider la police haïtienne à libérer le pays des groupes armés qui le tiennent en otage, les Nations unies ont approuvé le déploiement d’une force de police multinationale qui pourrait compter jusqu’à 2 500 agents. Environ 1 000 d’entre eux viendraient du Kenya. La plupart des Haïtiens sont favorables à une intervention limitée visant à stabiliser le pays, et le nouveau conseil de transition haïtien est soumis à une forte pression internationale pour accueillir cette mission de sécurité.
L’opération connaît cependant divers retards. Le Kenya a déclaré qu’il n’enverrait aucune force tant que les pays partenaires, notamment les États-Unis, n’auraient pas tenu leur promesse de financement. Les républicains de la Chambre des représentants et du Sénat américains ont jusqu’à présent refusé d’approuver les 40 millions de dollars promis par le département d’État pour aider à lancer la mission dirigée par le Kenya.
« Nous devons trouver un moyen d’obtenir les fonds alloués à Haïti le plus rapidement possible », dit Don Allensworth. « Le moment est venu d’écrire » aux sénateurs et aux membres du Congrès.
Roselin Eustache ne sait pas comment la dévastation à l’œuvre en Haïti prendra fin, ni quand. Il a le mal du pays. Il aimerait être de retour chez lui, prier en personne avec les Haïtiens qui n’ont rien à manger, au lieu d’être bloqué au Texas à essayer de persuader les Américains qu’eux ont trop à manger.
Mais le meilleur plan qu’il puisse envisager à l’heure actuelle est de continuer à raconter aux gens à quel point cela lui fait mal de voir son monde s’effondrer.
Lorsqu’il en parle, il semble parfois au bord des larmes. « Nous devons continuer à faire ce que nous avons fait, sensibiliser les gens à la situation », dit-il. « Nous ne pouvons pas laisser notre flamme s’éteindre avec nous. »
Avec la contribution de Franco Lacomini au Brésil et d’Espeson Toussaint en Haïti.
Andy Olsen est rédacteur senior pour CT.