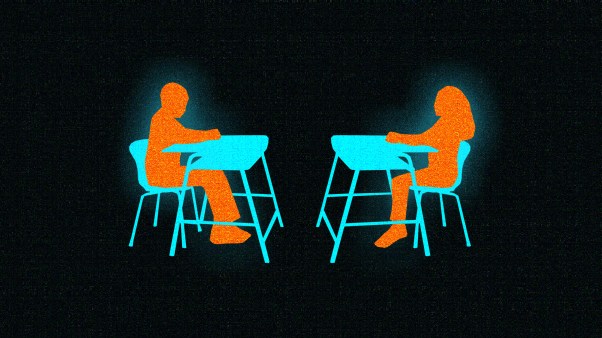I grew En grandissant, j’étais convaincue que les femmes pouvaient tout faire. Dans la campagne du Dakota du Sud, j’étais entourée de fermières, qui comptent parmi les personnes les plus fortes et les plus résistantes que j’ai jamais rencontrées. Ma mère savait cuisiner un poulet délicieux et l’abattre.
Le Dakota du Sud est également souvent en tête du classement national du pourcentage de femmes et de mères qui travaillent à l’extérieur. Ainsi, quand j’étais jeune fille, je n’ai jamais douté que les femmes pouvaient faire tout ce qu’elles voulaient, qu’elles étaient aussi capables que les hommes. Je pouvais devenir présidente. Je pouvais être astronaute. Je pouvais faire tout ce que je déciderais de faire.
Mais alors que j’avançais en ce sens, j’ai découvert un fossé entre ce qu’on m’avait toujours dit et ce que je découvrais, et ce fossé était clairement lié à la condition féminine. Malgré la présence de nombreuses femmes dans la population active du Dakota du Sud, celles-ci semblaient largement invisibles dans le domaine de la théologie. Dans mon église locale, il n’y avait jamais eu de femme en chaire. Au séminaire, j’avais une seule professeure. Dans mes études de doctorat, j’en avais deux, mais aucune dans mes cours liés à la religion.
J’étais convaincue que les Écritures soutenaient les femmes dans l’enseignement et la direction de l’Église : les femmes ont été les premières à proclamer l’Évangile (Lc 24.5-12), et Paul cite des femmes comme Junia et Phœbe, qui ont œuvré en tant qu’apôtres et diacres (Rm 16.1, 7). Mais comparées aux pages et aux pages consacrées à Pierre et Paul, Augustin et Thomas d’Aquin, Calvin et Luther, les femmes semblaient souvent n’être que des noms ajoutés en marge.
Je voulais plus que des noms. Je voulais voir des femmes diriger. Je voulais voir des femmes enseigner. Je voulais voir leurs visages et entendre leurs histoires. Je voulais des modèles que je pourrais imiter : des femmes qui, avec Paul, pourraient dire : « Imitez-moi, comme j’imite le Christ » (1 Co 11.1).
Je voulais des héroïnes.
Finalement, lors d’un voyage en Italie, je les ai trouvées. C’est là que j’ai réalisé que le témoignage des femmes ne se cache pas dans les marges. Il est écrit noir sur blanc. Il suffit de regarder les inscriptions sur les murs.
J’ai passé une bonne partie de mon temps en Italie à contempler des pierres. J’ai été fascinée par le Colisée, impressionnée par la grandeur de la Basilique Saint-Pierre et émerveillée par la perfection architecturale du Panthéon. Mais la découverte la plus étonnante a été de constater que ce que j’avais eu du mal à trouver dans l’encre et le papier, je pouvais le voir clairement dans la pierre et la peinture. C’est là, dans et sur les murs des églises anciennes, que j’ai trouvé mes héroïnes.
À Rome, j’ai découvert des églises qui portaient non seulement le nom de Marie, mais aussi ceux d’Anastasia, de Susanne, d’Agnès et de Sabine. En me promenant dans certaines de ces anciennes églises, j’ai découvert que ce lien était bien plus fort qu’un simple nom écrit sur un mur. Dans plusieurs de ces églises, les femmes étaient littéralement les fondations sur lesquelles l’église avait été construite : les murs avaient été érigés autour de leurs ossements.
Une citation célèbre de Tertullien dit que « le sang des martyrs est la semence de l’Église », et 1 Pierre 2.5 décrit l’Église comme des « pierres vivantes » qui « construisent un temple spirituel pour former une communautés de prêtres ». Ainsi, lorsque les premiers chrétiens ont construit leurs lieux de culte, ils l’ont souvent fait sur les corps de croyants et de croyantes qui avaient vécu si profondément pour le Christ qu’ils et elles avaient donné leur vie pour lui.
Les martyrs étaient à la fois le fondement métaphorique et littéral de l’Église. Au centre, au cœur des églises anciennes, se trouvait l’autel eucharistique qui contenait les ossements des martyrs et des saints chrétiens. Leurs corps et leur volonté de suivre le Christ jusqu’à la mort servaient d’exemple et de signe de ce que l’Eucharistie célèbre et appelle les fidèles à devenir. Prendre le pain et le vin sur une pierre tombale rappelait avec force que les croyants devaient mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui.
Par conséquent, alors que les spécialistes débattent encore pour savoir si les femmes présidaient l’eucharistie dans l’Église primitive, il n’y a aucun débat sur le fait que les femmes étaient fondamentales pour sa célébration. Leurs tombes, et donc leurs corps, servaient d’appui non seulement à l’eucharistie, mais aussi à toute l’église.
À Ravenne, j’ai vu leurs visages. Aux côtés de Pierre, Paul et des autres apôtres, Perpétue, Félicité, Daria, Euphémie, Cécile et Eugénie me regardaient depuis les mosaïques scintillantes et complexes de la chapelle de l’archevêque Saint-André. Ces héroïnes ont mené une vie si sainte que l’Église primitive voulait que les femmes et les hommes les admirent, au sens figuré et sur les murs, afin d’être inspirés par leur témoignage et de suivre leur exemple. Là, sous mes yeux, se trouvaient des femmes qui avaient conduit l’Église et avaient été des enseignantes et des modèles si influents que même l’archevêque, l’une des plus hautes autorités de l’Église, se tournait vers elles pour obtenir leur conseil.
Et il y en avait d’autres. Dans la basilique San Vitale, l’impératrice Théodora est représentée de la même taille et dans la même position que son mari, Justinien. Le long des murs de la nouvelle basilique Saint-Apollinaire, chaque côté présente une procession de saints marchant vers le Christ. À gauche, une rangée de femmes, et à droite, les hommes, de taille et de position égales. La conception et l’emplacement des mosaïques se répondent, de sorte que, debout dans l’église, je pouvais clairement voir ce que signifiait pour les hommes et les femmes d’être « un en Christ » (Ga 3.28). Ces femmes ne se cachaient pas dans les marges ou à l’arrière-plan, mais conduisaient visiblement l’Église vers le Christ.
Ces héroïnes de l’Église primitive étaient clairement habitées par leur expérience chrétienne en tant que femmes. Et elles n’avaient pas peur de parler de leur corps de femme.
Perpétue et Félicité, deux des femmes représentées dans la chapelle de l’archevêque, se sont préparées au martyre en parlant ouvertement de leurs seins, de l’allaitement et de l’accouchement. Emprisonnées en Afrique du Nord au 2e siècle, les deux femmes refusèrent de renoncer à leur foi, alors même que Perpétue venait d’accoucher et que Félicité était enceinte. Dans le récit de leur emprisonnement et de leur martyre, Perpétue décrit le chagrin et la douleur qu’elle ressent lorsque les gardes refusent sa demande d’allaiter son enfant en prison. Félicité, elle, accouche prématurément, de sorte que lorsqu’elle entre dans l’arène pour mourir, du lait coule encore de ses seins.
Les deux femmes associent leur corps au Christ et décrivent leur relation avec lui de manière maternelle. Perpétue a une vision dans laquelle elle reçoit du lait caillé d’un berger, qu’elle décrit avec un langage eucharistique. Mais le fait qu’il s’agisse de lait caillé plutôt que de pain et de vin établit également un lien entre le lait maternel qui nourrit son fils et le « lait pur et spirituel » (1 P 2.2-3) de la vie éternelle que le Christ nous offre. Jésus est vu comme une mère dont le corps offre nourriture et vie.
Félicité passe « du sang au sang », dit le narrateur de son martyre, de l’accouchement à la mort en martyre. Pendant son accouchement, Félicité compare ses douleurs à son martyre, en disant : « Je souffre moi-même maintenant ce que je souffre, mais là-bas, un autre sera en moi qui souffrira pour moi, car je dois souffrir pour lui. » Un martyr, en mourant, subit un baptême de sang et connaît une seconde naissance : la naissance au ciel.
Félicité, comme Perpétue, décrit Jésus avec un langage maternel. Elle relie l’imitatio Christi à ses entrailles en décrivant sa propre souffrance et son sang versé pour le Christ, qui est en elle, et la souffrance et le sang versé par le Christ pour elle, qui aboutiront à sa renaissance. Perpétue et Félicité décrivent toutes deux leur corps non pas comme un obstacle ou une source de tentation, mais comme un moyen de comprendre le Christ, de devenir plus semblables à lui.
Théodora, l’impératrice du 4e siècle qui orne les murs de San Vitale, était si puissante et influente que les spécialistes la considèrent souvent comme la co-dirigeante (voire la véritable dirigeante) de Byzance. Théodora avait probablement été actrice et prostituée (ces rôles étaient souvent liés) avant d’épouser Justinien.
Lorsqu’elle est devenue impératrice, Théodora n’a pas oublié ses origines et a mis son pouvoir et son influence au service des femmes opprimées. Elle a libéré les femmes de la prostitution forcée, interdit le trafic sexuel, fermé les maisons closes et acheté la liberté des femmes, leur offrant un refuge et des ressources pour un nouveau départ. Elle a également contribué à instaurer des sanctions plus sévères pour les viols, a interdit aux hommes de tuer leur femme pour adultère et a modifié les lois sur le divorce, la garde des enfants et la propriété afin de donner plus de droits aux femmes. Ces lois ont constitué la base des lois sur les droits des femmes dont nous bénéficions encore aujourd’hui.
Dans ces églises, les inscriptions et les œuvres d’art sur les murs m’ont montré que le corps féminin n’avait pas besoin d’être relégué à la marge ou rendu invisible, mais qu’il pouvait être mis en évidence dans les lieux de culte. Lorsque j’ai regardé le témoignage de ces femmes sur ces murs, leur corps féminin n’était pas un obstacle ou un frein, mais un signe de sainteté.
 WikiMedia Commons
WikiMedia CommonsNous avons tendance à considérer la théologie comme l’étude de paroles écrites. Mais la théologie n’est pas seulement basée sur des textes, elle est mise en pratique – vécue – dans le corps. La découverte des corps de femmes dans et sur les pierres des anciennes églises m’a aidée à comprendre que l’absence du féminin que j’avais découvert pendant mes études au séminaire n’était pas tant un manque qu’un trou de serrure, m’incitant à regarder au-delà de la page pour me tourner vers le corps. Les œuvres d’art, les récits et les espaces physiques agissent comme une clé qui peut déverrouiller ce qui est souvent l’histoire cachée des femmes.
Dans ma quête d’héroïnes, j’ai en effet découvert la « preuve » que des femmes avaient enseigné la théologie lorsque j’ai appris l’existence de femmes telles que Macrine et les mères du désert. Mais les femmes ont également effectué des pèlerinages et commandé des œuvres d’art sacrées. Elles ont consacré leur corps au Christ par un vœu de virginité, une manière physique d’illustrer leur engagement spirituel à être épouses du Christ (et un choix qui les obligeait souvent à défier leurs pères).
Les femmes possédaient plusieurs des premières églises domestiques où les chrétiens se réunissaient pour prier (Col 4.15 ; Ac 16.15 ; 1 Co 1.11). Elles ont fait don de terrains pour des catacombes, construit des églises et fondé des monastères – autant d’œuvres héroïques qui ont construit l’Église, et le genre de travail qui inspire et instruit à la fois.
Le témoignage de ces femmes sur ces murs m’a également aidée à mieux voir le témoignage des femmes dans ma propre histoire. En concentrant ma vision sur certains types de leaders et d’héroïnes féminines, j’avais négligé les nombreuses femmes qui avaient inscrit leur amour, leur connaissance et leur sainteté dans ma propre vie.
Telles étaient mes championnes de la prière. Mes enseignantes de catéchisme. Mes auditrices les plus attentives et mes conseillères. Mes modèles de patience et de persévérance. Mes sources de sagesse pratique et les plus ferventes disciples du Christ. En bref, telles étaient mes modèles et mes mentores, mes inspirations et mes instructrices, mes autorités et mes guides dans presque tout ce qui finissait par compter le plus.
Plus je regardais autour de moi pendant ce voyage en Italie, plus je réalisais à quel point ma vision avait été limitée. L’Église était pleine de femmes leaders et enseignantes. Elles n’étaient pas seulement des noms en marge, mais elles étaient fondamentales, dans tous les sens du terme, pour l’Église. Il suffisait de regarder autour de moi.
Lanta Davis est l’auteure du livre à paraître Becoming by Beholding (Baker Academic, 2024) et enseigne au John Wesley Honors College de l’Indiana Wesleyan University.
Traduit par Salomé Haldemann pour Servir Ensemble