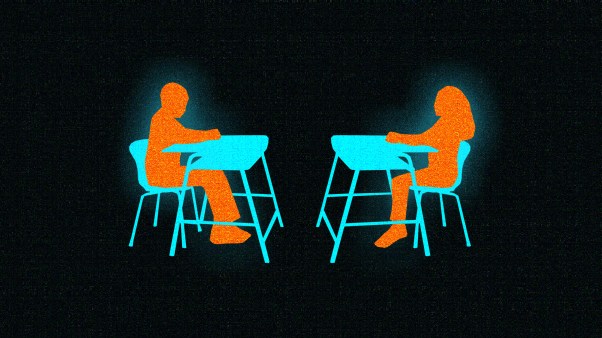Toutes les semaines, semble-t-il, une nouvelle réalisation de l’IA met le monde en émoi. Elle parle ! Elle peint ! Elle digère un livre entier et en recrache un podcast de 10 minutes !
Cette IA, c’est l’IA générative, produite par de grands modèles informatiques qui nous fascinent, mais, en même temps, nous inquiètent, tant leurs réalisations sont semblables à celles des êtres humains. De plus en plus présente dans nos vies, que nous offre-t-elle réellement ? J’y vois avant tout une promesse de facilité et de justice.
Si l’IA est utilisée correctement, nous disent ses adeptes, nous n’aurons plus à travailler aussi dur. Notre économie sera plus équitable, nos lois et leur application plus proches de l’impartialité. On pourra contourner l’intervention humaine, lente et sujette à l’erreur. On pourra atteindre l’équité mécaniquement, sans souffrance ni effort.
Plutôt que des détails plus technologiques, ce sont ces deux tentations que j’aimerais examiner. Car, bien avant que l’IA générative ne devienne une réalité, ces tentations se sont déjà manifestées par l’intermédiaire des méchants dans les récits de science-fiction et du Diable face à Jésus dans le désert. Ces fictions et la réponse de Jésus face à la tentation – ainsi que sa manière de vivre son ministère – pourraient nous aider à mieux faire face à l’IA d’une manière qui reflète notre vocation d’êtres humains créés à l’image de Dieu.
L’investisseur Marc Andreessen est probablement l’un des plus éminents avocats du potentiel révolutionnaire de l’IA. En 2023, il publie un « Manifeste techno-optimiste » commençant par une épigraphe du romancier catholique Walker Percy : « Vous vivez à une époque dérangée – plus dérangée que d’habitude, car malgré les grands progrès scientifiques et technologiques, l’homme n’a pas la moindre idée de qui il est ni de ce qu’il fait. »
Andreessen voit juste en estimant que les questions relatives à la nature et à la finalité de l’être humain sont centrales ici. Cependant, son manifeste montre rapidement à quel point il s’éloigne de l’anthropologie chrétienne de Percy.
« Je suis ici pour apporter la bonne nouvelle », écrit Andreessen en termes carrément messianiques : « il n’existe aucun problème matériel – qu’il soit créé par la nature ou par la technologie – qui ne puisse être résolu avec davantage de technologie. » Avec suffisamment de technologie, espère-t-il, nous pourrons « rendre tout le monde riche, tout bon marché et tout abondant. »
Voilà pour la facilité. Ensuite, il y a la justice. Selon Andreessen, la technologie est intrinsèquement libératrice : « du potentiel humain », « de l’âme humaine » et de « ce que être libre, être épanoui, être vivant ».
Dans cette logique, il serait injuste de ralentir le progrès. Andreessen reconnaît qu’il peut y avoir des accrocs en cours de route, mais, selon lui, notre seule option morale est d’avancer à toute vitesse vers l’avenir prospère, libre et juste que l’IA et les technologies qui l’accompagnent nous offriront.
En 2001, le paysan-poète Wendell Berry écrivait : « Il m’est facile d’imaginer que la prochaine grande division du monde se fera entre ceux qui souhaitent vivre en tant que créatures et ceux qui souhaitent vivre en tant que machines. »
La vision de l’humanité qui se cache derrière les éloges à l’IA du type de celui d’ Andreessen, relève de ce second camp. Elle considère les humains non pas comme des créatures appelées à participer à la restauration du monde par Dieu, mais comme des machines devant être optimisées et régulées par d’autres machines plus performantes.
Les auteurs de science-fiction mettent depuis longtemps en garde leurs lecteurs contre les risques du monde des machines. Et ils en ont souvent esquissé les tentations à partir du même binôme que celui que j’observe dans le manifeste d’Andreessen : facilité et justice.
Prenons, par exemple, le roman Alexandria publié en 2020 par Paul Kingsnorth, qui se déroule dans un futur lointain. La civilisation s’est effondrée, les humains ont rendu le monde inhabitable. Dans un ultime effort pour sauver celui-ci — ou, peut-être, pour éviter de devoir vivre différemment — les humains ont créé une IA appelée Wayland. Celle-ci devra prendre en charge et préserver les ressources de la planète qui s’amenuisent.
Mais ce que les humains ont créé n’est pas tout à fait clair. Au moment où se déroule le roman, la plupart d’entre eux sont hébergés par Wayland, dans un état d’existence désincarné, attendant que la Terre se rétablisse lentement. Seuls quelques humains susbistent dans des communautés résiduelles, résistant à l’offre tentante de Wayland de les libérer des tristesses d’une vie incarnée vue comme primitive.
Un des leurs décrit Wayland comme la dernière récurrence de la tentation primordiale : « Nous l’avons créé pour pouvoir vivre éternellement. Le plus vieux rêve. Être des dieux. »
K, un autre personnage du livre, est une sorte d’humain artificiel que Wayland utilise pour persuader les quelques personnes des communautés restantes d’abandonner leur corps. Son offre repose sur ce même binôme familier : l’ascension vers l’entrée de Wayland leur apportera une vie facile et la justice.
K offre une échappatoire à la douleur. Il l’exprime ainsi : « Si votre vie sur Terre doit se résumer au dur labeur sur un sol mourant, ou à la lutte pour survivre dans un bidonville sans foi ni loi, pourquoi la poursuivre plus longtemps que nécessaire ? » C’est la promesse d’une vie facile.
Plus subtilement, cependant, K décrit également l’offre de Wayland comme un « soulagement » nécessaire. Les humains détruisent la terre par leur appétit insatiable. Pour sauver l’écosystème, il faut qu’ils renoncent à leur corps et déplacent leur conscience vers un support moins gourmand en énergie. C’est la promesse de la justice.
Wayland propose de rétablir l’équilibre du cosmos, d’éliminer la souffrance et la violence, d’instaurer un ordre rationnel. Et si la violence, comme l’affirme K, « est inscrite dans la chair [humaine] », alors le seul moyen de l’éliminer est de libérer les humains de leur corps.
De nombreux autres récits de science-fiction présentent les tentations de la technologie en des termes similaires. Dans la nouvelle satirique de Nathaniel Hawthorne intitulée « Le chemin de fer céleste », des prédicateurs comme le révérend Dr Vent-de-doctrine proposent « l’érudition sans même devoir peiner à apprendre à lire », tandis qu’un train à vapeur amène tout le monde à toute vitesse vers le paradis.
Dans The Minority Report de Philip K. Dick, les précogs — des humains mutants capables de prévoir les crimes à venir — sont branchés sur un ordinateur pour effectuer le travail de la police à sa place. Dans Le Meilleur des mondes dystopique d’Aldous Huxley, toute une série de technologies imaginaires nous baigne dans une utopie envoutante. Et dans Un raccourci dans le temps de Madeleine L’Engle, un cerveau désincarné promet d’« assumer toute la douleur, toutes les responsabilités, tous les fardeaux de la pensée et de la décision », si seulement les héros le laissent faire.
Ce qui me fascine dans ces exemples littéraires, c’est que, quelle que soit la technologie imaginée, elle est attirante. Et les moyens déployés pour arriver à ses fins sont considérés comme moralement insignifiants. Ce qui importe est que la technologie facilite l’obtention de résultats présentés comme confortables et justes.
Toutes ces histoires sont antérieures à ChatGPT, mais les tentations dont elles parlent sont bien plus anciennes que les ordinateurs ou la révolution industrielle. Elles me rappellent étrangement la tentation du Christ par le Diable dans le désert (Mt 4.1-11 et Lc 4.1-13).
Satan n’avait pas d’application électronique à faire miroiter au Messie, mais lui aussi prétendait offrir la justice sans effort ni douleur. Il offrait à Jésus la victoire sans la Croix.
Le Diable commence par mettre en doute l’identité de Jésus : « Si tu es le Fils de Dieu… ». La réalité de la divinité de Jésus, insinue-t-il, dépend de l’efficacité de ses actes. Elle dépend de sa capacité à transformer les pierres en pain ou à sauter du haut du temple sans se blesser. Voilà pour la tentation de la facilité.
Plus loin dans les Évangiles, Jésus accomplira des miracles de cette ampleur. Mais ici, il refuse la prémisse du Diable. Sa nature divine n’est pas liée à sa capacité à opérer un tour de magie. Comme il le rappelle à Satan, le bien humain le plus élevé n’est pas simplement d’avoir sa vie physique préservée. C’est d’avoir sa vie soutenue par « toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4.4).
La dernière tentation, celle de régner sur tous les royaumes du monde si Jésus adore Satan, est la tentation de la justice. Elle révèle la division mortelle que le Diable tente d’introduire entre la fin et les moyens : il offre à Jésus la fin appropriée et juste sans passer par son chemin de douleur.
Pourtant, comme le montrent clairement le ministère et la passion du Christ, ce chemin est indissociable du royaume qu’il vient inaugurer. À la grande frustration des foules qui affluent vers lui, Jésus insiste sur le fait que son règne doit passer par son ministère lent et personnel et par sa mort douloureuse. Ce motif jalonne toute sa vie.
Jésus a guéri le serviteur du centurion à distance et nourri 5 000 personnes. Il aurait pu accomplir beaucoup de miracles à grande échelle. Il aurait pu éliminer toute souffrance, toute oppression et tout autre effet de la Chute. Il aurait pu réaliser bien plus que toutes les promesses qu’Andreessen et ses semblables font aujourd’hui au nom de l’IA. Il aurait pu transformer le cosmos en une machine fonctionnant à la perfection.
Mais il ne l’a pas fait. Au lieu de cela, son ministère est constamment empreint de ces choses inutiles et partiales qui exaspèrent tant de ceux qui vivent à l’ère de la machine.
Ses contemporains aussi y étaient sensibles. Après que Jésus a nourri les 5 000 personnes, ils voulaient le faire roi par la force (Jn 6.15). Ils voulaient un chef magique qui nourrirait la nation et, sans doute, battrait les Romains.
Mais la multiplication des pains est l’exception qui confirme la règle. C’est le seul miracle que l’on retrouve dans les quatre évangiles et le seul miracle de masse (à part un autre repas très similaire avec 4 000 personnes). Dans la suite du récit de Luc, Jésus prévient ses disciples qu’il devra souffrir beaucoup et être mis à mort. Il ajoute ces paroles : « quiconque veut être mon disciple doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix chaque jour et me suivre » (9.21-23).
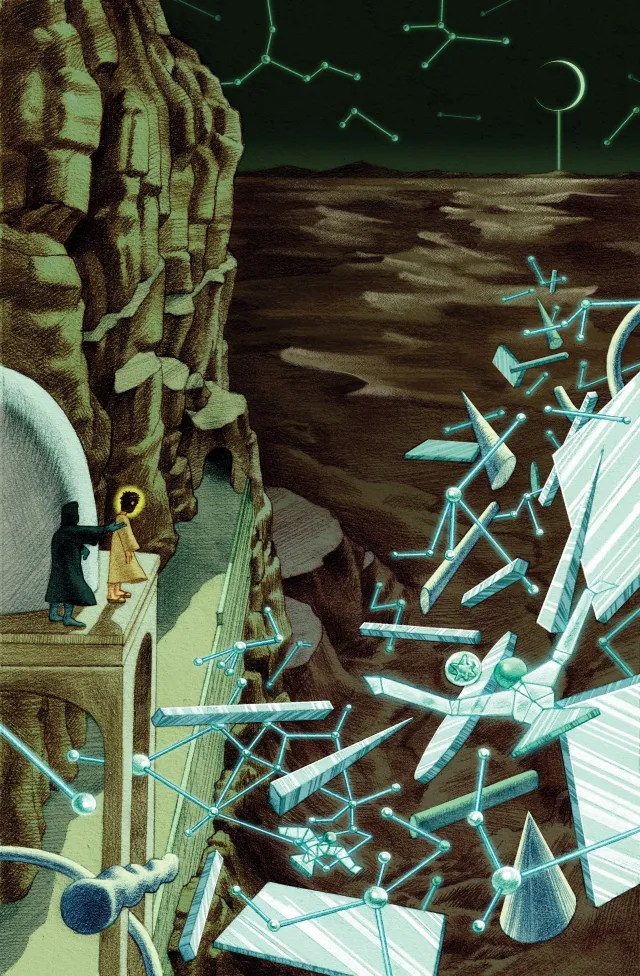
La présence rédemptrice de Dieu dans une création ravagée par le mal n’accomplit pas la justice d’un coup de baguette magique. Pour nous comme pour Jésus, il s’agit d’un travail complexe et douloureux qui requiert beaucoup d’attention personnelle et de soins.
Le royaume de Dieu doit passer par le sacrifice et la souffrance. Pourquoi ? Parce qu’il ne s’agit pas ici que d’égalité salariale ou de plaisirs hédoniques ; il s’agit de la présence de Dieu parmi nous.
Jésus disait aux pharisiens déconcertés : « Le règne de Dieu ne vient pas comme un événement qu’on pourrait voir venir. […] Car, sachez-le, le règne de Dieu est au milieu de vous. » (Lc 17.20-21, TOB). Et, en Jean 17.3, il prie : « la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ».
Une telle rencontre avec Dieu et son royaume échappe nécessairement à nos exigences de rapidité et d’efficacité. Les moyens de l’Incarnation sont également ses fins, et la présence divine ne peut être automatisée, pas plus que la présence humaine. Jésus doit guérir personne par personne, toucher par toucher.
Il est significatif, je pense, que Jésus ne nous dise jamais d’aimer le monde. Dieu aime le monde, mais Jésus nous dit d’aimer notre prochain. Et la parabole du bon Samaritain, qu’il raconte pour dire qui est notre prochain, nous rappelle combien il est tentant d’esquiver le travail personnel de l’amour (Luc 10.25-37).
Le prêtre et le lévite qui passent à côté du blessé pouvaient justifier leur désintérêt pour lui en termes d’efficacité et de justice abstraite. Ils avaient un travail plus important à faire, un travail qui aurait plus d’impact que d’aider un seul homme. Mais notre responsabilité n’est pas de maximiser notre efficacité ; elle est de prendre soin du blessé que nous croisons sur notre route, comme l’a fait le Samaritain.
Jésus conclut la parabole par ces mots : « Va et toi aussi, fais de même. » (NFC) Il nous ordonne d’aimer notre prochain de manière lente, difficile et sacrificielle, comme il l’a fait lui-même ici-bas.
Notre vocation en tant que disciples du Christ est donc de suivre le chemin tracé par Jésus, de marcher lentement avec autrui, de souffrir et, finalement, d’arriver à incarner la présence de Dieu auprès de ceux que nous croisons. La qualité des moyens à déployer est essentielle à cette vocation. Comme nous le rappelle Berry : « L’espérance vit dans les moyens, pas dans les fins ».
Jésus a fait les bonnes choses, lentement. Faisons de même. Le théologien japonais Kosuke Koyama écrit dans Three Mile an Hour God : « Dieu marche “lentement” parce qu’il est amour. S’il n’était pas amour, il irait beaucoup plus vite. » Jésus n’a pas fait le tour du monde en jet, il a fait le tour de la Judée. Il n’a pas proclamé son message instantanément à travers tous les continents ; il a lentement formé des pêcheurs et des collecteurs d’impôts. Aussi tentante que soit la facilité, nous devons refuser les technologies qui promettent d’automatiser nos relations avec les autres et avec le monde.
Les moments passés à faire bouillir la sève des érables de mon jardin, à jouer avec ma fille ou à écouter mes étudiants lire leurs essais et discuter avec eux de leurs écrits, n’ont pas une valeur économique très élevée. Ces activités sont lentes, peu efficaces et, à certains égards, difficiles. Mais elles contribuent à tisser des liens d’attention et de soin réciproque entre moi et ceux que je suis appelé à aimer. En ne regardant qu’à la facilité, je me coupe de la présence du Dieu d’amour en moi.
Jésus a également fait de bonnes choses de manière inefficace. Cela pourrait sembler blasphématoire, mais pensez à la fois où il met de la salive sur les yeux de l’aveugle, lui impose les mains et lui demande s’il voit. À quoi l’homme répond qu’il voit des gens qui sont « comme des arbres [qu’il voit] marcher. » (Marc 8.24). Jésus lui met alors de nouveau les mains sur les yeux et il peut alors voir clairement.
Marc place cette guérison en deux temps à un endroit tout particulier de son Évangile. Ce récit apparait à la suite d’échanges avec ses disciples où il leur demande pourquoi, malgré tout ce qu’ils avaient vu, ils ne comprennent encore que si peu de choses. Dans la suite, comme pour illustrer leur compréhension bancale de l’identité de Jésus, Marc relate l’un derrière l’autre la confession de Pierre qui reconnaît le Christ en Jésus puis ses reproches envers son maître après l’annonce de sa mort.
Même les disciples de Jésus — même son bras droit, Pierre — n’ont souvent perçu que faiblement qui il était. Jésus était-il, à ce point, un enseignant médiocre, incapable de s’expliquer lui-même ? En fait, l’important n’est pas là. Ce qui importe est que les disciples aient pu participer à la vie et au ministère de Jésus. Il en va de même pour nous.
Le travail de l’Église peut, lui aussi, être tâtonnant. Nous ne sommes pas des ordinateurs fonctionnant toujours exactement. On peut le voir lorsque nous prions et jouons de la musique pour Dieu, lorsque nous faisons de la théologie, lorsque nous prenons soin de notre prochain dans le besoin, etc. Mais ces moyens sont essentiels à notre vocation de porteurs de l’image divine. Nous ne pouvons pas nous décharger de ces tâches sur ChatGPT. Si nous essayons, nous allons au-devant de l’échec. Même si l’IA est brillante.
Tout ceci n’est, bien entendu, pas une raison de négliger ou d’ignorer insensiblement des souffrances qui pourraient être atténuées par une utilisation judicieuse de la technologie. Néanmoins, n’oublions pas que les tentatives d’accroissement de la facilité et de la justice entraînent souvent des conséquences inattendues. Méfions-nous donc de toute prétention à utiliser les technologies pour aider autrui comme par magie, sans effort ni sagesse et probité de notre part.
Finalement, Jésus a fait le bien gratuitement. Dans l’une de ses paraboles sur le royaume de Dieu, les ouvriers qui commencent à travailler dans les champs à l’aube et ceux qui arrivent à la fin de la journée reçoivent la même récompense (Mt 20.1-16). Cela ne semble pas juste. Mais la grâce divine dépasse — bien heureusement — les normes humaines. Nous recevons ce que nous ne pourrions jamais mériter.
Aucun algorithme ne peut donner un sens à une grâce aussi inestimable qui s’illustre aussi lorsqu’une femme verse un pot de parfum sur les pieds de Jésus, provocant l’indignation des disciples (Mt 26.6-13). C’était du gaspillage ! Ce parfum n’aurait-il pas dû être vendu au profit des pauvres ? Ne serait-ce pas là un altruisme plus efficace ? Pourtant, Jésus loue le geste d’amour et de révérence de cette femme, rétorquant aux disciples renfrognés qu’on se souviendrait d’elle et de son don partout où l’Évangile serait proclamé.
Même à l’ère de l’efficacité, on peut encore faire énormément de choses gratuitement. Cuisiner de bons petits plats pour sa famille, même si les enfants les engloutiront en quelques secondes, ou écrire des poèmes, même si personne ne les lira jamais. Comme l’écrivain Kurt Vonnegut conseillait à ses lycéens : « Pratiquez n’importe quel art, musique, chant, danse, théâtre, dessin, peinture, sculpture, poésie, fiction, essai, reportage, peu importe que cela marche ou non, non pas pour obtenir argent et célébrité, mais pour faire l’expérience du devenir… pour faire grandir votre âme ».
Si nous suivons les pas de Jésus — si nous vivons lentement, faisons de bonnes choses malgré leur manque d’efficacité, et partageons la grâce extravagante qui nous a été donnée — les attraits de l’IA, comme toutes les fausses promesses et tentations du malin, s’estomperont et n’auront plus prise sur nous.
Nous verrons l’absurdité de ses mensonges et éviterons de placer notre confiance en l’IA pour le discernement et la mise en œuvre de la vérité. Nous pourrons alors nous atteler à la tâche ardue, mais gratifiante, de vivre notre vocation de créatures à l’image de Dieu dans un monde de plus en plus formaté par et pour les machines.
Jésus a résisté aux tentations du Diable qui lui proposait une justice facile plutôt qu’une présence patiente, douloureuse et pleine de grâce. Prenons part à son royaume. Marchons dans ses pas.
Jeffrey Bilbro est professeur agrégé d’anglais au Grove City College et rédacteur en chef de Front Porch Republic (blog culturel, dont on pourrait traduire le nom par « la république de ceux qui se retrouvent pour échanger, discuter sous le porche de la maison », ndlt). Son dernier ouvrage s’intitule Words for Conviviality: Media Technologies and Practices of Hope.
Traduit par Anne Haumont