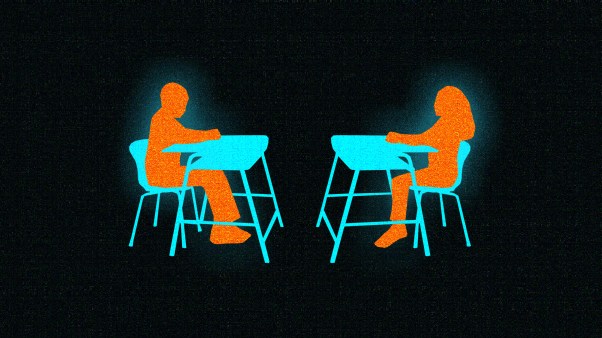Ces dernières années, d’immenses quantité d’énergie ont été dépensées pour essayer de comprendre comment et pourquoi la société américaine dans laquelle je vis — et le christianisme en son sein — est si divisée. Dans l’Église, toute une nouvelle industrie se développe avec la promesse de nous aider à enfin abaisser les barrières qui nous séparent.
Divers suspects sont régulièrement mis en lumière : des baby-boomers qui n’ont jamais adhéré aux mouvements veillant à un meilleur accueil de chacun dans l’Église, des Blancs qui n’ont pas écouté les témoignages de leurs frères et sœurs noirs, des militants politiques d’un bord ou de l’autre, etc.
De nombreux efforts sont déployés pour remédier à ces divisions théologiques, ethniques ou encore politiques. Mais une autre source de division, que l’Écriture met en lumière plus que toute autre, a été largement ignorée : les écarts de richesse.
Si l’on cherche à comprendre ce qui divise les chrétiens américains — à la fois dans la culture et au sein des églises — il est en réalité bibliquement impensable de passer à côté de la question de l’argent. Nous sommes généralement très frileux sur le sujet. Raison de plus pour nous y pencher ! La Bible est pleine de recommandations à propos du potentiel diviseur de la richesse.
Avant de poursuivre, précisons quelques éléments. Parler de l’argent comme d’une source de division ne signifie pas que nous devrions, en tant que chrétiens, nous sentir mal de pouvoir payer nos factures et subvenir aux besoins de notre famille. Certains chrétiens sont appelés à la pauvreté volontaire, certes, mais pas tous. Je ne dis pas non plus que les chrétiens seraient dépourvus de générosité quant à leurs richesses. Au contraire, plusieurs travaux tendent à montrer que mes concitoyens qui vont à l’église (et dans d’autres lieux de culte) donnent plus d’argent aux organisations caritatives, et que la générosité par rapport au temps est également corrélée à la croyance religieuse. Même avec les aléas de la pandémie, les dons des chrétiens se sont pour l’essentiel maintenus.
Il est par ailleurs utile de relever que l’Ancien Testament, où la richesse est souvent considérée comme un signe de faveur divine, peut compliquer notre perception de l’argent. La richesse d’Abraham est par exemple présentée comme un signe de sa bénédiction par Dieu. La richesse initiale de Job est liée à sa fidélité (1.1-3, 9-10), et l’Ecclésiaste dit que les biens viennent de la main de Dieu (5.19-20).
Mais face à ces associations entre richesse matérielle et bénédiction, l’Ancien Testament nous offre autant d’exemples où la richesse est associée à la division au sein du peuple de Dieu. Pensez à Salomon, qui opprime son propre peuple pour construire le temple et des maisons pour les dignitaires étrangers (1 R 5.13-14 ; 12.4), ou à David, réprimandé sous les traits d’un riche opprimant un pauvre paysan (2 S 12).
Le Nouveau Testament met encore plus en évidence les tentations de la richesse et la capacité de l’argent à diviser le peuple de Dieu. La lettre de Jacques devrait à elle seule nous faire réfléchir sérieusement : elle lie notre attrait de la richesse à des distinctions injustes parmi nous (2.1-7) et au meurtre, à la convoitise, aux luttes et aux querelles (4.1-3). Jacques avertit les riches que la richesse accumulée corrode, déforme et conduit à d’autres péchés, comme le dépouillement et l’oppression des pauvres (5.1-6). Nous devrions garder ces choses à l’esprit. Et lorsque Matthieu, Marc et Luc nous racontent tous trois l’histoire d’un homme respectueux de la loi qui n’a pas suivi Jésus à cause de sa richesse, nous devrions également y prêter attention (Mt 19.16-30 ; Mc 10.17-31 ; Lc 18.18-30).
Ces enseignements sont clairs et cohérents. Ce n’est pas que ceux qui ont de l’argent seraient nécessairement immoraux. Mais la richesse attise certaines tentations : prestige, pouvoir, luxe, flatterie, illusion d’autosuffisance.
En 1 Timothée 6.17-19, Paul identifie non seulement l’amour de l’argent comme un problème, mais la richesse elle-même comme une dangereuse source d’espoir de substitution :
Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d’être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s’assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l’avenir, afin de saisir la vie éternelle.
Ces propos éclairent la sagesse de Jacques sur la façon dont la richesse peut diviser une communauté. L’argent nous façonne, oriente nos espoirs, la manière dont nous nous considérons nous-mêmes et considérons les autres, ou encore le genre de vie que nous recherchons. Voilà comment la richesse peut nous éloigner les uns des autres.
Lorsque les premiers chrétiens ont médité sur ces passages et sur le pouvoir de la richesse, certains, comme Clément d’Alexandrie, ont mis l’accent sur la disposition du cœur : une grande richesse n’est pas un problème, enseignait-il, pour autant que l’on soit généreux, car des personnes vertueuses ne sauraient être compromises par leurs possessions. Mais Clément reconnaît également que, dans la réalité, peu de gens sont capables d’une telle vertu.
Une approche plus courante fut celle de Jean Chrysostome, qui prêcha six sermons différents sur Lazare et l’homme riche pour mettre en lumière les dangers de la richesse. Comme le démontre l’éminent historien Peter Brown, Chrysostome était loin d’être le seul à envisager les choses ainsi. Les premiers chrétiens considéraient souvent que la richesse était toxique pour l’âme, et ils encourageaient les riches à se défaire de leurs richesses tout au long de leur vie. Comme l’a montré l’historienne de l’Église Helen Rhee, les prédicateurs de l’Église primitive mettaient en garde contre les dangers de la richesse pour le bien des âmes fortunées.
Évaluer notre degré de richesse en termes absolus est assurément difficile : on peut être manifestement pauvre en Occident et pourtant riche au regard de la population mondiale. Quoi qu’il en soit, l’Écriture et l’Église primitive, dans leurs mises en garde concernant la richesse, soulignent la nécessité de la générosité et de la mise à disposition constante de nos ressources pour le bien des autres. Ne pas réfléchir aux enjeux de la richesse, c’est la laisser façonner nos amours, nos pratiques et, en fin de compte, la manière dont nous nous rassemblons en tant que peuple de Dieu. Ces avertissements de nos prédécesseurs nous rappellent que la richesse et sa poursuite ont des conséquences sur nous. Le chrétien doit donc veiller à la manière dont il s’y attache.
Que faire alors si la richesse nous advient ? Elle peut survenir sans que nous ayons commis une quelconque faute : un héritage, un travail persévérant ou certaines compétences plus valorisées au sein de notre société peuvent nous rapporter beaucoup d’argent, qu’on le veuille ou non.
Mais, quelles que soient les circonstances, la sagesse de l’Écriture et celle de l’Église primitive s’accordent : la richesse s’accompagne de dangers. Nous nous plairions à penser que nous serons suffisamment vertueux pour bien gérer la situation, mais, si nous sommes sages, nous devrions justement en douter. Plus notre richesse est importante, plus nous serions insensés de penser que nous réussirons là où David et Salomon ont échoué. Le péché, avec les éloignements mutuels qu’il induit, domine bien souvent la conclusion de ces histoires.
Considérer la richesse comme une explication des divisions dans l’Église ne signifie pas rejeter ou minimiser d’autres facteurs, tels que les différends générationnels, politiques ou culturels. Mais cela nous aide plutôt à avoir une vision plus complète de la situation. Par exemple, aux États-Unis, il se trouve que les générations les plus âgées ont généralement été en mesure d’accumuler plus de richesses que leurs descendants. Les affiliations partisanes sont également corrélées avec le revenu. Les Américains blancs ont plus de richesses que tous les autres Américains, et les revenus moyens varient considérablement selon les confessions chrétiennes.
La richesse agit sur la manière dont nous nous entourons. Cela n’est peut-être pas agréable à entendre, mais des études démontrent régulièrement le rôle que joue la richesse dans la détermination du lieu où nous allons à l’église, des personnes avec lesquelles nous nous lions d’amitié et de celles qui se trouvent à nos côtés durant le culte. Si nous ne nous intéressons qu’à d’autres sources de division, la richesse opère dans l’ombre, influençant silencieusement tous les aspects de notre vie.
Heureusement, les recommandations de l’Écriture et des premiers chrétiens sont toujours valables : utiliser la richesse pour le bien, et vite.
L’acquisition de grandes richesses ne devrait pas conduire à la licence ou à la construction de greniers plus grands (Lc 12.16-21). Elle impose aux chrétiens une obligation immédiate de service et de générosité. Les églises du Nouveau Testament témoignent d’un mélange de riches et de pauvres. Certains ont beaucoup de moyens. D’autres en ont moins. Les riches ont des responsabilités que les pauvres n’ont pas. Paul nomme et remercie à juste titre ceux qui accueillent les rencontres des églises, car ils contribuent clairement à rendre ces réunions possibles — et souvent à couvrir les dépenses de l’église dans son ensemble, finançant les bâtiments et les moyens de subsistance des pasteurs et des missionnaires.
« On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné » (Lc 12.48). Comme l’écrit Henri Nouwen dans un ouvrage trop peu lu sur la collecte de fonds, le don de richesses devient un moyen pour le donateur de participer à la mission de l’Église. La générosité permet de réorienter les richesses vers la réponse à des besoins réels, parmi lesquels se trouve aussi la nécessité d’échapper aux profonds risques spirituels liés à la conservation de celles-ci.
Myles Werntz est l’auteur de From Isolation to Community: A Renewed Vision for Christian Life Together. Il écrit sur le blog Taking Off and Landing et enseigne à l’Abilene Christian University.