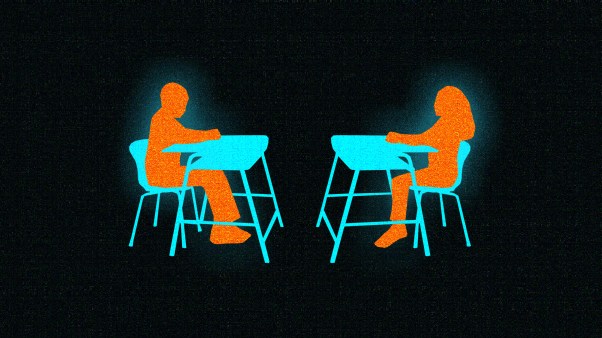Durant ma première année d’université, mes amis et moi avons passé de nombreux vendredis soirs à errer dans les supermarchés Walmart du sud-ouest de l’Ohio. Nous arpentions leurs sols carrelés, plissant les yeux sous leurs lumières fluorescentes, reniflant l’odeur du pain provenant du Subway situé dans le hall d’entrée. Nous déambulions dans les allées, passant devant des palettes déchargées et des chariots abandonnés. Mais nous n’étions pas là pour faire des courses. Nous étions là pour demander aux clients comment nous pourrions prier pour eux.
Notre méthode était simple : identifiez un client, approchez-vous lentement de lui et présentez-vous. Soyez chaleureux et concis. Énoncez clairement votre objectif : « Bonjour ! Je m’appelle Heidie, et voici mon amie Leah. Nous sommes chrétiennes et nous nous demandions si nous pourrions prier pour vous aujourd’hui. » Ensuite, nous souriions et attendions que notre interlocuteur sorte de son étonnement initial.
Beaucoup répondaient « non merci » et s’empressaient de s’en aller, comme le font parfois ceux qui se retrouvent acculés face à un groupe d’enfants vendant des biscuits. Certains nous ignoraient, continuant à chercher des conserves et à cocher des articles sur leur liste. Certains se moquaient ouvertement de nous, émettaient des grognements inamicaux ou marmonnaient des choses comme « espèces de fondamentalistes ». Mais de temps en temps, une personne disait oui. Nous demandions alors pour quoi nous pourrions prier, et commencions à le faire.
Notre offre de prière était sincère, mais elle avait aussi quelque chose d’un prétexte. Ce que nous voulions vraiment, c’était évangéliser. Nous voulions présenter le message de l’Évangile de A à Z, de la création à la fin des temps, et inviter les gens à y répondre. Nous faisions donc ce que l’on appelait des « prières informatives ». Nous situions nos requêtes dans le cadre de l’histoire biblique, en définissant les termes et en citant l’Écriture en cours de route. Les conventions sociales entourant la prière dans notre contexte — vous restez silencieux jusqu’à ce que celui qui prie dise « amen » — laissaient toute la place à ce genre de présentation.
Telle était la stratégie d’évangélisation que nous avions apprise des étudiants en master de théologie de notre pieuse université baptiste. Ils suivaient un cours intitulé « Introduction à l’évangélisation », de sorte que notre campus disposait d’une réserve constante de pasteurs en formation désireux de diriger des sorties d’évangélisation et de donner des conseils en la matière. Si tout ce que vous pouvez faire, c’est prier pour quelqu’un, nous expliquèrent ces étudiants, alors priez l’Évangile. C’est donc ce que nous avons fait. Je priais l’Évangile entre les rayons d’une grande surface. Mon amie Zoe avait opté pour les cafés d’une ville que nous décrivions comme le « Hippie Village ». Mon ami Andrew préférait un centre commercial voisin. Ma colocataire, Alina, arpentait les universités publiques.
Les étudiants en master n’étaient pas à l’origine du fort accent mis par notre école sur l’évangélisation — ils y répondaient plutôt. Lors des cultes quotidiens proposés à l’ensemble du campus, les orateurs prêchaient régulièrement que tous les chrétiens sont appelés à vivre en mission et que nous sommes engagés dans une bataille cosmique pour les âmes. L’action de mon groupe chez Walmart était peut-être une caricature de leurs principes — fruit de la maladresse mêlée de ferveur des nouveaux étudiants que nous étions — mais nous agissions à partir des exhortations de nos aumôniers. Racontez l’histoire. Nommez les enjeux. Indiquez clairement la voie du salut.
Bien sûr, nous savions que nous aurions des réactions négatives. Mais l’Évangile était naturellement offensant pour les non-croyants. Une « pierre d’achoppement », selon les termes de Paul (1 Co 1.23). Il fallait s’attendre à de l’opposition. Il nous fallait simplement « secouer la poussière de [nos] pieds » et continuer (Mt 10.14). Un orateur de nos cultes avait cité Charles Spurgeon à ce sujet. « Si les pécheurs doivent être damnés », avait écrit Spurgeon, « qu’ils doivent au moins sauter par-dessus nos cadavres pour aller en enfer. » L’orateur avait insisté sur le mot « cadavres ». Des amen bouleversés résonnèrent dans l’auditoire de la chapelle.
Mes élans d’évangélisation au supermarché se sont estompés au milieu de ma deuxième année, lorsque la plupart des étudiants en master que je connaissais avaient terminé l’introduction à l’évangélisation et étaient passés au grec biblique. Des vendredis soirs plus tranquilles m’ont alors permis de faire le point. J’étais heureuse d’avoir une réponse à offrir lorsque les orateurs de la chapelle interpellaient la salle en nous demandant comment nous répondions au Mandat missionnaire donné par Jésus. J’étais également reconnaissante pour l’expérience acquise dans ces luttes spirituelles, pour la forme de mort à moi-même que j’avais vécue face à la dérision et aux regards de travers.
Mes efforts étaient tout à fait sincères. L’un des encouragements les plus fréquents que mes amis et moi nous adressions les uns aux autres après un échange difficile avec quelqu’un était, étrangement, un rappel de la réalité de l’enfer. De réelles personnes faisaient réellement face à la condamnation éternelle. Constamment. Une chance de sauver quelqu’un de ce destin valait bien un rejet.
Et pourtant, je n’étais toujours pas satisfaite de notre approche. Les gens acceptaient rarement de prier avec nous, et même ceux qui le faisaient se dépêchaient de partir après notre « amen ». Pas de questions, pas de conversations. Je connaissais notre consolation typique dans ces cas-là : Nous plantons simplement la graine, et Dieu donnera la croissance s’il le veut (cf. 1 Co 3.6). Mais j’avais commencé à perdre confiance dans le fait que nous étions vraiment en train de « planter des graines ». Les difficultés que nous rencontrions m’apparaissaient se trouver en amont de la « plantation » ou même du « rocher qui fait trébucher » (1 P 2.8). Alors que je repassais dans ma tête les souvenirs d’approches ratées, il m’est apparu que ce n’était peut-être pas l’Évangile qui avait repoussé nos interlocuteurs, mais plutôt l’étrangeté de ces deux adolescentes enthousiastes qui prétendaient soudain devoir retenir leur attention au rayon chips.
Mes réflexions ont également été encouragées par quelques leçons d’écriture reçues par la suite. Ces cours comportaient de nombreux éléments sur le potentiel spirituel de la littérature et sur les responsabilités de l’écrivain chrétien, mais il n’y avait pas de pression pour introduire des sermons dans nos histoires ni de sous-entendu selon lequel nos écrits seraient meilleurs si nous le faisions. Au contraire, mes professeurs voulaient que nous abordions la narration avec nuance. Nous parlions de livres qui proclamaient ouvertement l’Évangile, comme la série Narnia de C. S. Lewis et Le voyage du pèlerin de John Bunyan, mais nous abordions aussi d’autres œuvres plus subtilement chrétiennes, pour peu qu’on puisse même le détecter : par exemple les nouvelles de Flannery O’Connor ou les poèmes de T. S. Eliot.
Quoi que nous lisions, nous nous concentrions sur la conception. Nous étions tout aussi préoccupés par le quoi de ce qu’un auteur disait que par le comment il le disait. Les bons auteurs, soulignaient mes professeurs, se soucient de la présentation. Ils sont en contact avec leurs lecteurs. Ils établissent une relation. Ils utilisent l’humour, le ton, la narration, le tact, et c’est pour cela que les gens se sentent si touchés par leurs mots. J’ai vécu là d’importantes avancées pour ma pensée. Ces professeurs m’ont enseigné une leçon que j’avais désespérément besoin d’apprendre et dont les applications vont bien au-delà de la salle de classe : on peut avoir un excellent message, mais le transmettre de façon médiocre.
J’ai passé la première moitié de ma dernière année de bachelor à postuler pour des programmes de master en création littéraire. Au printemps, j’ai été acceptée à l’université de l’Iowa. Celle-ci était le genre d’endroit que les orateurs de notre chapelle décrivaient comme « le monde ». Le président de mon université avait récemment écrit un article dans lequel il critiquait ces systèmes éducatifs enseignant « l’humanisme séculier, la théorie de l’évolution et un athéisme impie ». Je me dirigeais à présent vers l’un d’entre eux.
Et ceci sans aucun semblant de stratégie d’évangélisation, pourrais-je ajouter. Mes réflexions sur mon expérience dans les supermarchés m’avaient persuadé d’abandonner ce genre d’approche « à froid ». Mais elles n’avaient pas supprimé mon souci pour le Mandat missionnaire. Je voulais conduire les gens vers la lumière, arracher les âmes au feu (Jude 23). Mais je me sentais tout de même un peu mal à l’aise de débarquer dans une université en déclarant que j’avais quelque chose à enseigner aux autres. Je ne voulais pas non plus réduire mes futurs camarades de classe à une sorte d’objectif d’évangélisation sans visage, et ce avant même de les avoir rencontrés.
Mes premières semaines dans cette université furent marquées par les diverses questions posées pour faire connaissance. Des camarades de classe me demandèrent ainsi comment était ma précédente école et quels sujets m’intéressaient. Ma réponse tournait généralement autour de quelques mots clés : petite faculté baptiste, très dévote, art chrétien, conversion. Je m’attendais à ce que mes camarades éprouvent le même sentiment d’étonnement et d’inconfort que nos « cibles » chez Walmart. Au lieu de cela, ils posèrent de nouvelles questions.
Et mes réponses ont ouvert à de nouvelles conversations : sur ma conversion au christianisme au lycée, sur mon groupe de disciples en première année d’université et sur une statue de Jésus de 19 mètres de haut installée dans l’Ohio d’où je venais. Je me demandais si toutes ces discussions pourraient être considérées comme une sorte d’évangélisation. Les catégories instillées dans ma tête me disaient que non. Je n’étais pas en train de « nommer les enjeux » ou de les inviter à incliner leur tête pour une « prière informative ». Mais je donnais un aperçu de la vie chrétienne. De ma vie chrétienne. Et c’est aux détails qu’ils semblaient s’intéresser le plus. Le côté terre-à-terre et humoristique, par exemple, de m’imaginer à 14 ans cherchant sur Google une « université sérieuse sur Jésus » semblait donner à mes pairs quelque chose à quoi se raccrocher, une sorte d’exemple leur permettant de situer ou réviser les choses qu’ils avaient entendues à propos de la religion.
Plus tard dans le semestre, un camarade d’études m’a demandé pourquoi j’avais choisi ce master littéraire dans cette université. J’ai expliqué : jeunes mariés, mon mari et moi avons décidé que nous voulions tous deux suivre des études supérieures. Nous nous sommes assis et avons dressé une liste de toutes les universités américaines qui proposaient à la fois un master en littérature créative non fictionnelle et un programme de doctorat en physique théorique. Nous avons déposé des demandes jusqu’à ce que nous n’ayons plus d’argent pour couvrir les frais de dossier. Nous avons ensuite prié pendant des mois. Mon mari a été accepté à l’université de l’Iowa. J’ai été mise sur liste d’attente. Nous avons donc continué à prier et demandé à tous ceux que nous connaissions de faire de même. Quelques semaines plus tard, à la date limite nationale d’acceptation des candidatures, quatre heures avant minuit, j’ai reçu un courriel m’informant qu’une place s’était libérée pour moi.
« Je te l’accorde », m’a dit mon camarade de classe avec un léger sourire. « Cela semble… divin. »
Le moment était significatif : un agnostique entrevoyait quelque chose de Dieu. Mais je n’ai pas voulu conduire la conversation vers un ultimatum cosmique. Peut-être était-ce de la lâcheté. Peut-être était-ce quelque chose comme du tact.
J’ai entendu toutes sortes d’objections à des approches plus subtiles de l’évangélisation : Dieu travaille avec des vases brisés, nous ne devons pas nous conformer aux modèles du monde, la beauté de l’Évangile peut transparaître au moyen de lèvres hésitantes. Je comprends ces idées et je suis reconnaissante de la façon dont elles encouragent les chrétiens qui, avec Moïse, disent : « De grâce, Seigneur, je n’ai pas la parole facile. » (Ex. 4.10 — SEM) C’est une prière qu’il nous arrive tous de faire.
Mais je me demande si notre familiarité avec cette prière ne nous a pas conduits à nous habituer à des expressions maladroites de notre foi, voire à les préférer, même, en interprétant à tort un manque de sensibilité comme du sérieux dans notre évangélisation. Il est commode d’assimiler le sort d’un évangéliste de supermarché à la persécution des apôtres. Il est plus difficile d’admettre que le fait de confronter des étrangers à l’Évangile dans la rue, dans un parc ou dans un magasin peut produire un rejet plus social que théologique. Il est plus difficile d’accepter que les gens n’aiment pas naturellement être entraînés dans des conversations intimes avec des étrangers. Nous trouvons les idées plus convaincantes lorsqu’elles sont émises par des personnes que nous connaissons, lorsqu’il y a un lien, une relation ou un contexte commun.
Certes, certains sont hostiles à l’évangélisation, quelle que soit la manière dont elle est apportée, même entre amis. Lors de l’un de mes séminaires de premier semestre en Iowa, j’ai eu l’occasion d’entendre une conversation sur le prosélytisme. Je ne connaissais pas le mot, mais le ton acerbe sur lequel il était prononcé était marquant. Un camarade de classe le qualifiait de condescendant. Un autre employait le mot fanatique. Mon professeur y voyait un acte de colonialisme. Les gens acquiesçaient. Ce n’est que lorsque quelqu’un a explicitement parlé de religion que j’ai compris de quoi nous discutions. Ils ne décriaient pas la « pierre d’achoppement » (1 Co 1.23) de l’Évangile ; ils rejetaient en bloc l’idée d’évangélisation. Ils étaient irrités par l’idée d’une tentative manifeste de persuasion, par l’idée que quelqu’un puisse essayer de les convertir.
Deux semaines plus tard, des représentants du ministère des Gédéons sont venus à Iowa City. Ils se tenaient sur des trottoirs très fréquentés et distribuaient des nouveaux testaments de poche. J’en ai accepté un en guise de solidarité, bien que j’aie déjà six bibles à la maison, puis je me suis retirée dans un bâtiment universitaire voisin pour observer la scène depuis une fenêtre. Je grimaçais lorsque les étudiants repoussaient les Gédéons, leur jetaient un regard noir ou n’acceptaient un nouveau testament de poche que pour le jeter dans la poubelle au coin de la rue. J’ai vu de nombreux nouveaux testaments tomber dans la poubelle. J’ai vu les Gédéons le voir aussi.
Telles étaient les scènes que j’avais en tête alors que je travaillais sur mon premier essai en atelier — un texte personnel que je devais soumettre à mes camarades de classe pour qu’ils le commentent. Je craignais d’être accusée de prosélytisme, et je détestais cette crainte, alors j’ai rassemblé le courage que j’avais et j’ai écrit sur le sujet de manière indirecte. J’ai écrit sur les leçons bibliques que j’avais données à des élèves de troisième année pendant mes étés de travail dans un camp chrétien, sur le temps que j’avais passé en tant que rédactrice pour la division marketing de mon université baptiste, et sur ma rencontre avec les Gédéons, le tout arrangé entre des réflexions abstraites sur la propagation de la foi religieuse — sur le « prosélytisme ». Le résultat formait finalement un collage inégal que j’ai soumis dans la panique.
Le jour de la discussion en atelier, deux notes claires résonnèrent de la salle. Premièrement, les sections abstraites étaient confuses et inutiles. Deuxièmement, mes camarades avaient aimé les moments où je présentais la religion à travers des histoires personnelles.
Quelqu’un m’a dit que l’essai « prenait vie » dans les scènes du camp d’été. Une autre a déclaré que les détails narratifs lui donnaient l’impression de voir à l’intérieur du christianisme. Une troisième a rapporté que les anecdotes personnelles l’avaient aidée à accéder aux idées de l’essai. Ce n’était pas la réaction à laquelle je m’attendais, surtout pas pour un essai qui portait si clairement sur des croyants tentant de partager leur foi. Mais ces récits étaient parvenus à susciter de l’intérêt. Un autre de mes professeurs l’a exprimé de manière marquante lors d’une conférence que j’ai tenue deux semestres plus tard : « Je ne suis pas intéressé à parler de christianisme. Mais j’aime bien vos histoires. »
Ses paroles m’ont rappelé ce que Paul écrivait au sujet de son propre appel à l’évangélisation : « Avec les Juifs, j’ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs ; avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j’étais sous la loi […] J’ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d’en sauver de toute manière quelques-uns » (1 Co 9.20-22). Et peut-être pourrions-nous ajouter : avec les écrivains, je me suis faite écrivaine.
Le conteur comme l’évangéliste tente d’amener les auditeurs au seuil d’un monde nouveau. Il œuvre avec en tête le fameux « Viens et vois » de Philippe (Jn 1.47). C. S. Lewis, le célèbre allégoriste de l’Évangile que j’avais lu dans mes cours de littérature de premier cycle — également auteur de certains des essais spirituels les plus convaincants du 20e siècle — décrit les histoires, qu’elles soient ou non teintées d’Évangile, comme des fenêtres et des portes. Elles sont des points d’accès. Des portails. Par leur intermédiaire, les gens peuvent « voir avec d’autres yeux, imaginer avec d’autres imaginations, ressentir avec d’autres cœurs ». Je ne vois pas de meilleure description de ce que l’évangélisation espère accomplir chez ses destinataires.
Bien entendu, il ne s’agit pas d’une méthode infaillible ; il n’y en a pas. Mais je suis convaincue que les évangélistes feraient bien d’avoir quelques histoires dans leur manche, surtout face à un public dont le plus grand besoin n’est pas une présentation doctrinale hermétique, mais un meilleur récit de ce que nous sommes et une nouvelle paire d’yeux pour le comprendre. Pour reprendre les termes de Lewis : « L’une des choses que l’on éprouve après avoir lu une grande œuvre, c’est le sentiment d’en sortir. Ou, d’un autre point de vue, d’y être entré. »
Après l’atelier, l’une de mes camarades de classe m’a envoyé un message pour me dire qu’elle me désignait comme sa « conseillère spirituelle ». Son propos avait quelque chose d’un peu hyperbolique, mais elle ne mentait pas. Elle a commencé à m’envoyer ses questions. Comment les saints étaient-ils canonisés dans l’Église catholique ? Combien de Marie se trouvaient dans le groupe d’amis de Jésus ? Que signifie liturgie ?
D’autres camarades de classe se sont également joints à elle. Depuis mon premier atelier, on me demande : « Quelles sont les différentes classes de reliques ? Pourquoi Saint Nicolas et Arius se sont-ils divisés ? Pourquoi les chrétiens se mettent-ils de la cendre sur le front en février ? Les recueils de chants sont-ils identiques aux recueils d’hymnes ? L’enfer est-il une métaphore ? Pourquoi les chrétiens se marient-ils si jeunes ? » Et, toujours avec la même nonchalance : « Comment fonctionne l’Incarnation ? »
J’aime beaucoup ces questions. Je les aime parce qu’elles sont consistantes, parce qu’elles appellent des réponses et parce qu’elles m’invitent à discuter des choses de Dieu avec des personnes en recherche, des sceptiques et des amis. C’est ce à quoi j’aspirais, et ce qu’une année dans les allées de Walmart ne m’avait pas permis de trouver.
Heidie Senseman est étudiante en master de littérature dans le cadre du programme d’écriture non fictionnelle de l’université de l’Iowa. Ses essais ont déjà été publiés dans Vita Poetica, Dappled Things, Plough, Ekstasis, et d’autres publications.