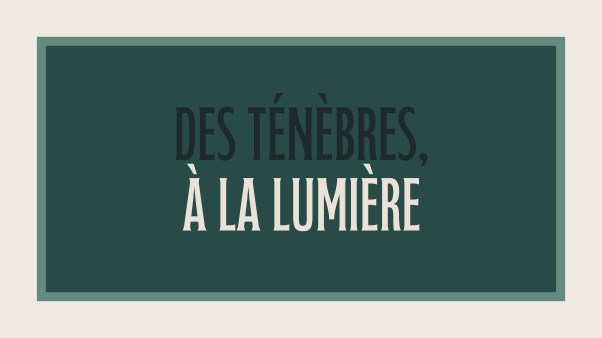Au cours des 50 dernières années, le centre du christianisme s’est déplacé de l’Occident vers le monde majoritaire. « Ceux qui étaient autrefois un champ de mission apparaissent aujourd’hui comme une force missionnaire », me disait encore Lazarus Phiri, responsable missionnaire zambien, dans une interview l’année dernière.
Pourtant, trop souvent, des missionnaires occidentaux bien intentionnés agissent comme si ce changement n’avait pas eu lieu. La raison en est, en partie, que les sources de pouvoir (notamment l’argent, la formation, les institutions, les facilités de voyage, etc.) se trouvent toujours davantage du côté de l’Occident.
S’il reste implicite, ce différentiel de pouvoir dans la collaboration missionnaire entre Occidentaux et partenaires du reste du monde peut entraîner un gaspillage de ressources, un découragement des missionnaires, une baisse de l’engagement et des difficultés relationnelles.
L’autrice et missiologue Miriam Adeney rapporte cette histoire entendue un jour de la bouche d’un responsable chrétien africain :
L’éléphant et la souris étaient les meilleurs amis du monde. Un jour, l’éléphant dit : « Souris, faisons une fête ! ». Les animaux vinrent de près comme de loin. Ils mangèrent, burent, chantèrent et dansèrent. Et personne ne célébra avec plus d’enthousiasme que l’éléphant.
Une fois la fête terminée, l’éléphant s’exclama : « Souris, as-tu déjà assisté à une meilleure fête ? C’était génial ! » Mais la souris ne répondit pas. « Où es-tu ? », appela l’éléphant. Soudain, il recula, horrifié. À ses pieds gisait la souris, le corps enfoncé dans la terre, écrasée par l’enthousiasme de son ami l’éléphant.
« C’est parfois ce que signifie la mission à vos côtés, vous, les Américains », conclut le conteur africain. « C’est comme danser avec un éléphant. »
Lorsque j’ai lu cette histoire pour la première fois, j’ai eu l’impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. J’ai fait défiler mentalement mes 25 années d’engagement dans des missions interculturelles et je me suis demandé si quelqu’un dirait cela de moi. Ai-je été un éléphant ? Dans mon enthousiasme pour la mission, ai-je déjà écrasé les frères et sœurs avec lesquels je pensais collaborer ?
Bien entendu, personne ne se lance dans une mission internationale avec l’intention d’écraser ceux qu’il rencontrera. Mais si vous parlez avec des responsables missionnaires du monde entier, comme mes collègues et moi-même l’avons fait dans le cadre de nos recherches pour le podcast Mission Shift, vous découvrirez que de nombreux éléphants qui s’ignorent dansent sur les champs de mission.
Compte tenu des asymétries de pouvoir dans le travail interculturel, comment nous, Occidentaux, pouvons-nous œuvrer avec d’autres de manière à élever ceux que nous côtoyons plutôt que de les écraser ?
Il nous faut premièrement reconnaître les enjeux de pouvoir liés à l’argent. Mary Lederleitner, autrice de Cross-Cultural Partnerships: Navigating the Complexities of Money and Mission, écrit à propos du pouvoir de distorsion de la richesse : « La personne qui vient du pays le plus riche ou le plus développé suppose qu’elle sait ce qui est le mieux. » Elle ajoute : « Il est tout à fait contre-intuitif d’apprendre de personnes moins riches et moins formées que vous. » Mais l’incapacité à le faire peut conduire à un sentiment de supériorité qui, dans le cadre d’un « partenariat », instaure une relation paternaliste.
Layo Leiva, qui a travaillé avec l’organisation Cru pour le développement de partenariats entre l’Amérique latine et les États-Unis, résume clairement : « Là où se trouve l’argent se trouve le pouvoir — celui qui a l’argent a le pouvoir. » Cela ne veut pas dire que l’argent ne peut pas être utilisé dans la mission. Le partage de ressources au sein du corps du Christ va de pair avec un Évangile véritablement transformateur. Mais nous devons être conscients des défis que celui-ci peut créer dans la collaboration.
Il nous faut également reconnaître les enjeux de pouvoir liés à la prise de décision. Brian Virtue, qui a étudié des centaines de collaborations interculturelles dans le cadre de son doctorat, décrit un scénario qu’il a observé à plusieurs reprises :
Les partenaires [plus faibles] ont accès aux conversations initiales, mais au moment de la prise de décision et de la mise en œuvre, ils n’ont plus été intégrés dans le processus. C’est un peu comme si on leur avait dit : « Nous allons aller en discuter à la table des adultes. Et nous reviendrons ensuite vers vous. »
Qui est à la table des adultes dans un partenariat ? Si la table ne rassemble que des Occidentaux, ou les titulaires des diplômes les plus élevés, ou ceux disposant des budgets les plus importants, votre partenariat est probablement affecté par des asymétries de pouvoir.
Il existe de nombreuses autres sources de pouvoir dans un partenariat missionnaire : la formation, la nationalité, la taille de l’organisation, la langue et l’histoire, pour n’en citer que quelques-uns. Si nous avons des yeux pour voir, nous pouvons utiliser ces choses au profit de la mission. Vous avez de l’argent ? Excellent ! Investissez-le dans la mission de Dieu. Vous avez une formation ? Excellent ! Utilisez-la pour soutenir vos frères et sœurs. « Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. » (Rm 12.6) Mettons-les en pratique, mais conscients de l’influence du pouvoir sur les partenariats, gardons également en tête cet avertissement de Paul : « je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. » (v. 3) L’éléphant pourrait faire beaucoup de bien avec sa taille s’il reconnaissait les dangers potentiels qu’elle représente.
En prenant conscience de ces enjeux de pouvoir, nous devons apprendre à marcher plus doucement dans nos partenariats. Slavko Hadžić, évangéliste en Bosnie-Herzégovine et directeur régional associé de Langham Preaching, fait cette recommandation : « Si vous venez pour la première fois dans un pays ou une région, ne venez pas avec un projet. Venez observer. Ne vous précipitez pas pour faire des promesses. Attendez, apprenez, soyez ouvert à l’écoute. Laissez le Seigneur guider vos pas. »
Marcher plus doucement, c’est notamment reconnaître que Dieu est déjà à l’œuvre sur tous les continents et dans tous les coins de la terre. Et si nous entrions dans chaque situation interculturelle à la recherche des signes de l’œuvre de Dieu plutôt que d’un endroit où planter notre drapeau ou insérer nos propres programmes ? Trop souvent, nous utilisons l’urgence de la mission comme excuse pour blesser nos partenaires dans la mission. Pour marcher plus doucement, il faut marcher lentement.
Milan Michalko, pasteur en République tchèque, encourage également un rythme lent. « Un partenariat sans relation ? Je n’ai pas le temps pour cela », déclare-t-il. Les relations prennent du temps à se construire. Michalko a une théorie qui explique pourquoi cet aspect est souvent difficile pour les organisations américaines : « Parce qu’ils ont de l’argent, ils n’ont pas le temps. » L’abondance d’argent requiert une abondance de résultats rapides, mais les partenariats sains exigent plus qu’un déjeuner de 30 minutes et un tableau partagé sur Google. « Si vous voulez un partenaire de qualité, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Vous devez être ici. Il faut y consacrer du temps. Il faut instaurer un climat de confiance », explique Michalko. Pour marcher plus doucement, nous devons marcher en relation.
Forrest Inslee, coauteur du livre Re-Imagining Short-Term Missions, raconte un moment en Haïti où une équipe a appris à marcher plus doucement dans la collaboration. Sur l’île d’Haïti, l’histoire du colonialisme et des inégalités a ancré l’idée que, grâce à ses ressources supérieures, l’Occident sait toujours mieux que les autres. La manière d’agir des équipes occidentales ne faisait souvent que confirmer cette idée.
Alors qu’une équipe contribuait à des animations au sein d’un quartier avec l’organisation Konbit Haïti, les visiteurs états-uniens pensaient devoir occuper le devant de la scène, comme s’ils compensaient un programme déficient ou incomplet. Mais cette fois, les responsables haïtiens ont osé parler. « Pourriez-vous, s’il vous plaît, rester au fond de la salle plutôt que sur la scène ? » ont-ils demandé.
En s’exprimant ainsi, ils prenaient le risque d’offenser leurs hôtes et de compromettre le flux de ressources en provenance de leurs partenaires états-uniens. Et certains ont effectivement été offensés. Mais la majorité a tiré les leçons de cette situation. Ils se sont tenus plus en retrait. Au fil du temps, le partenariat s’est développé de manière saine dans la réciprocité et la confiance. Pour marcher plus doucement, il faut parfois se mettre en retrait.
Layo Leiva nous fait part d’une méthode peut-être inattendue pour marcher plus lentement. Dans les partenariats missionnaires, le partenaire détenant le plus de pouvoir partage souvent les produits de son système (argent, livres, programmes), mais donne rarement accès au partenaire de pouvoir inférieur aux coulisses de la fabrication de ces produits.
On envoie de l’argent, mais personne n’explique comment collecter des fonds. On traduit des livres, mais personne n’explique comment en écrire. L’un des partenaires garde le contrôle et l’autre devient dépendant.
Layo Leiva demande désormais à ses partenaires de ne pas se contenter d’envoyer le produit, mais de « transférer la technologie » qui l’a produit. Ainsi, au lieu de créer une dépendance sans fin, nous apportons notre force pour accroître celle de nos partenaires. En marchant plus doucement, notre puissance soulève nos partenaires au lieu de les écraser.
Et c’est en prenant conscience de notre pouvoir et en apprenant à marcher plus lentement que nous pourrons faire la découverte la plus importante dans les partenariats. Le principe se retrouve dans une autre histoire de souris, sous la plume d’Ésope :
Un lion dormait dans la forêt, sa grosse tête reposant sur ses pattes. Une petite souris timide lui tomba dessus à l’improviste et, dans sa frayeur et sa hâte de s’enfuir, se heurta au nez du lion. Sorti de sa sieste, le lion posa rageusement son énorme patte sur la petite créature pour la tuer.
« Épargnez-moi », supplia la pauvre souris. « S’il vous plaît, laissez-moi partir et, un jour, je vous rendrai la pareille. »
Le lion fut très amusé à l’idée qu’une souris puisse jamais l’aider. Mais il se montra généreux et laissa finalement partir la souris.
Quelques jours plus tard, alors qu’il traquait une proie dans la forêt, le lion fut pris dans les mailles du filet d’un chasseur. Incapable de se libérer, il emplissait la forêt de ses rugissements rageurs. La souris reconnut sa voix et trouva rapidement le lion qui se débattait dans le filet. Courant vers l’une des grandes cordes qui le liaient, elle la rongea jusqu’à ce qu’elle se rompe, et bientôt le lion fut libéré.
« Tu as ri quand j’ai dit que je te rendrais la pareille », lui dit la souris. « Tu vois maintenant que même une souris peut aider un lion. »
Trop souvent, en Occident, nous définissons le pouvoir par les moyens dont nous disposons : l’argent, la formation, les facilités de déplacement et d’autres ressources. Comme le lion, nous rions à l’idée d’être aidés par une souris. Mais il existe d’autres forces que celles que prennent en compte nos mesures occidentales : la flexibilité et la sensibilité interculturelle, la dépendance à l’égard de Dieu, la disposition à souffrir et l’ingéniosité pour la mission.
Chaque disciple du Christ — même celui qui nous paraît le plus petit – est plein de potentiel. Chaque croyant est rempli de l’Esprit. Chaque croyant est une partie du corps qui a un rôle crucial à jouer. Chaque croyant est formé par Dieu pour sa mission. Et comme le rappelle Paul, ceux qui semblent les plus faibles sont en réalité indispensables (1 Co 12.22-27).
Même les lions et les éléphants ont des besoins. En réalité, nos forces sont parfois même à la source de nos besoins. Nos ressources abondantes peuvent nous rendre lents à prier. L’efficacité de nos systèmes peut entamer nos capacités à improviser. Nos plans établis peuvent nous rendre aveugles à ce que Dieu fait dans les marges. L’Occident a clairement aussi besoin des nombreux atouts du monde majoritaire.
Même Jésus, que Mary Lederleitner décrit comme « le partenaire en position de force par excellence », s’est mis en situation de devoir s’appuyer sur les forces des autres. Il s’est réduit à presque rien en prenant la forme d’un homme. Il a marché avec douceur parmi nous. Il a invité les disciples « dans les coulisses » de sa vie et a tout partagé avec eux. Il leur a confié la mission.
Le Lion de Juda ne s’est pas moqué de la contribution des hommes et des femmes des villages de Galilée. Il les a appelés amis et leur a donné les clés de son royaume. De même, notre Seigneur nous a mandatés et investis de son Esprit. Et chaque fois que nous suivrons son exemple, nos partenariats missionnaires nous donneront à tous de véritables raisons de nous réjouir.
Josh Irby est le directeur des partenariats de Cru City Global pour l’Europe et coanimateur du podcast Mission Shift. Il est ancien missionnaire et coauteur de Cross on a Hill: A Personal, Historical, and Biblical Search for the True Meaning of a Controversial Symbol.