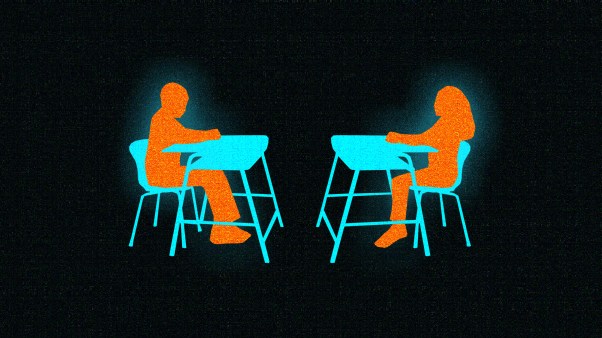En 1822, un groupe de missionnaires protestants arrive à Hawaï. À la différence des dizaines de missionnaires américains partis de la Nouvelle-Angleterre au 19e siècle, ces gens viennent d’une autre île polynésienne, Huahine. Ils sont trois missionnaires anglais et quatre missionnaires tahitiens.
S’il semble que le peuplement d’Hawaï est notamment dû à des Tahitiens alors installés là depuis déjà des centaines d’années, les deux royaumes n’avaient alors eu que peu de contacts jusqu’à récemment. Le groupe de missionnaires considérait le passage à Hawaï comme une simple escale dans le cadre d’un voyage visant à relancer la mission aux îles Marquises. Par une série de coïncidences, les missionnaires tahitiens entrèrent en contact avec la cour royale hawaïenne et mirent à profit leur culture polynésienne commune pour partager l’Évangile avec eux.
Après des siècles d’absence de contact entre l’archipel de Tahiti et celui d’Hawaï, l’explorateur britannique James Cook emprunte sans le savoir l’ancienne voie maritime entre les deux royaumes à la fin de l’année 1777. Lorsqu’il jette l’ancre au large de Kauai en 1778, Cook demande aux Hawaïens s’ils connaissent Tahiti. Ceux-ci lui répondent que Kahiki, comme ils appelaient Tahiti, est leur patrie dans le Pacifique Sud. (En langue hawaïenne, Kahiki désigne à la fois les îles de Tahiti et toutes les terres situées au-delà de l’horizon d’Hawaï, dans toutes les directions.)
Les ancêtres des premiers colons des îles hawaïennes sont probablement des insulaires des îles Marquises arrivés entre l’an 1000 et l’an 1200. Une deuxième vague de colons débarque de Tahiti entre l’an 1200 et l’an 1400.
En 1400, les Tahitiens installés là dominaient Hawaï sur le plan politique et avaient transformé la façon dont les Hawaïens pratiquaient leur religion. Un influent tahu’a (kahuna, prêtre) tahitien introduisit les sacrifices humains et contribua à l’établissement d’une caste royale toute puissante connue sous le nom de aliʻi. Au fil du temps, les membres de l’ali’i devinrent considérés comme des dieux.
Malgré leurs relations étroites, un siècle après cette réforme, la navigation à longue distance entre les deux royaumes cessa.
Après la mort de Cook à Hawaï en 1778, ses cartes, ses gravures et les comptes rendus de son journal permirent à de nombreuses îles polynésiennes d’apparaître sur les cartes du monde de l’Occident. Bientôt, des explorateurs et des missionnaires occidentaux se penchèrent sur le travail de l’explorateur, impatients d’entreprendre leurs propres voyages.
L’un d’eux était William Carey qui, alors qu’il réparait des chaussures, lut un compte rendu détaillé de Tahiti dans les journaux du capitaine Cook sur l’océan Pacifique et ressentit pour la première fois l’attrait de la mission. Pour guider ses prières sur le sujet, celui que l’on considère souvent comme « le père des missions modernes » accroche alors une carte dessinée à la main des itinéraires des voyages de Cook, envisageant Tahiti comme l’endroit le plus prometteur pour une mission auprès d’une nation « païenne », non chrétienne.
En 1795, les navires marchands et les expéditions d’exploration effectuent souvent la traversée d’un mois (environ 2 400 milles nautiques) entre Tahiti et Hawaï. Dans les îles britanniques, l’enthousiasme pour l’envoi de missionnaires à Tahiti grandit en raison du climat chaud, des récits détaillés des explorateurs sur ses habitants et de la croyance erronée que les Polynésiens parlent une langue très simple.
Carey s’embarquera finalement seul vers l’Inde, mais la London Missionary Society (LMS) envoie en 1796 sa première mission étrangère à Tahiti. Presque immédiatement, la mission de Tahiti souffre de conflits personnels internes et peine à toucher les autochtones. Thomas Haweis, un éminent ecclésiastique de l’Église d’Angleterre, avait réuni un groupe de charpentiers, de maçons et d’autres hommes de métier, espérant qu’ils évangéliseraient les Tahitiens en leur enseignant des métiers pratiques. Le plan missionnaire Haweis semble largement échouer et, en 1805, presque tous les missionnaires d’origine sont partis pour l’Australie.
Néanmoins, l’introduction de l’Évangile finit par toucher la société tahitienne. En 1814, un réveil a lieu et les Pomares, une famille royale influente, se convertit au christianisme. Des centaines d’autres suivent après que Pomare II, ayant réussi à triompher de ses compatriotes tahitiens et à prendre le contrôle de l’île, offre à ses anciens ennemis un festin et une célébration plutôt que le massacre habituel. Sa miséricorde chrétienne attire de nombreux Tahitiens à Christ.
Dans les suites de ce progrès inattendu, les organisations missionnaires changent de stratégie et adoptent la théorie des missions évangéliques du séminariste David Bogue. Bogue plaide en faveur d’une formation au séminaire pour les missionnaires ordonnés et du recrutement de jeunes hommes instruits et de leurs épouses en tant que responsables.
William et Mary Mercy Ellis, de Londres, répondent parfaitement à ces critères. En 1816, les Ellis débarquent à la station missionnaire de la LMS dans la baie de Matavai, sur l’île de Tahiti, et rencontrent rapidement un couple de chrétiens locaux, Auna et Aunawahine.
Auna descend d’une famille de prêtres qui servaient le puissant dieu Oro et avait été formé par son propre père pour prendre sa suite. Mais après avoir combattu aux côtés des Pomares, sa vie a pris un tournant décisif. Auna s’est déclaré chrétien et a étudié au collège biblique de la LMS sur les îles, devenant finalement diacre dans l’église de la mission. Quelques mois après leur rencontre, les deux couples se rendent ensemble à Huahine (une autre île de ce qui deviendra plus tard la Polynésie française) pour y implanter une église, qui réunit rapidement une communauté florissante.
Lorsque Auna, Aunawahine et les Ellis quittent Huahine pour arriver à Hawaï en 1822, ils rencontrent rapidement un autre groupe de missionnaires qui se sentent menacés par les nouveaux arrivants : des missionnaires américains qui avaient débarqué en 1820. Les missionnaires américains avaient établi deux stations, mais ne maîtrisaient pas encore la langue hawaïenne et n’étaient donc pas en mesure de traduire la Bible ou de prêcher des sermons sans faire appel à des traducteurs autochtones.
En outre, ils n’avaient pas réussi à toucher les aliʻi. Le peuple hawaïen suivait strictement les directives de ses dirigeants, et les aliʻi exigeaient que les missionnaires apprennent d’abord à palapala (lire et écrire). Le manque de compréhension de la langue entravait la mission.
L’aisance linguistique des nouveaux missionnaires ne fait que souligner cette lacune. La maîtrise de la langue tahitienne par William Ellis lui permet de comprendre et de parler la langue hawaïenne.
« Nous avons constaté que les insulaires des îles Sandwich [terme obsolète désignant les Hawaïens] et les Tahitiens étaient membres d’une même grande famille et parlaient la même langue avec de légères variations : un fait que nous considérions comme très important pour les relations que nous pourrions avoir avec ces populations », écrira-t-il plus tard.
Ce fait facilitera aussi immédiatement une interaction surprenante :
À l’approche de nos bateaux, l’un des indigènes nous a salués d’un Aroha, paix, ou attachement. Nous lui avons rendu son salut en tahitien. Le chef a alors demandé : « Êtes-vous originaire d’Amérique ? » Nous avons répondu : « De Grande-Bretagne ». Il a répondu : « En passant par Tahiti ? » et, sur la réponse affirmative, a observé : « Il y a un certain nombre de Tahitiens sur le rivage ».
Alors que le navire quittait l’île d’Hawaï, le groupe établit un autre contact lorsqu’un Tahitien les dépasse en canoë dans le port d’Honolulu.
« La femme d’Auna a rapidement découvert que ce Tahitien était son propre frère, qui avait quitté Tahiti alors qu’il était enfant, et dont ils n’avaient plus entendu parler depuis près de 30 ans ! », écrit dans son journal l’inspecteur de la station de mission de la LMS, William Tyreman.
Pour une monarque hawaïenne, cette rencontre fortuite revêt une importance encore plus grande. Kaʻahumanu, épouse de feu Kamehameha, qui règne désormais sur le royaume d’Hawaï, ressent du mana (un sentiment de puissance spirituelle) dans cette rencontre. Elle invite immédiatement Auna et Aunawahine à habiter dans son enceinte royale.
Ce soir-là, le groupe de missionnaires tahitiens contribue directement au travail des missionnaires américains. William Ellis se remémore les faits :
Le soir de ce jour, nous étions présents lorsque Auna a lu les écritures et a offert des prières familiales publiquement dans la maison de Kaʻahumanu : nous nous sommes unis avec des sentiments peu ordinaires, pour la première fois, dans l’adoration du vrai Dieu avec les personnes qui nous entouraient. Le lendemain, le 17 avril, jour de l’office religieux hebdomadaire de nos amis américains, j’eus l’occasion de prêcher en langue tahitienne.
Ce soir-là, William Ellis, qui prononce son sermon en langue polynésienne, franchit une première étape clé dans la transformation des relations glaciales entre Kaʻahumanu et les missionnaires américains, en particulier leur chef, Hiram Bingham.
À la mi-mai, Kaʻahumanu commence à exprimer un vif intérêt pour le christianisme et demande qu’Auna, Aunawahine et la famille Ellis emménagent avec les membres de la famille royale.
Auna et Aunawahine quittent alors bientôt Honolulu avec Kaʻahumanu pour visiter Maui et l’île d’Hawaï. Dans les jours qui suivent, Auna accompagna la régente dans l’évolution de ses sentiments à l’égard du christianisme, passant du scepticisme à la conversion, puis à un enthousiasme qui alimente sa passion pour que d’autres trouvent la même foi qu’elle.
« J’ai lu une partie de l’évangile tahitien de Matthieu, puis j’ai prié Jéhovah de les bénir par son salut », écrit Auna en mai depuis Lahaina, dans son journal de bord sur leur voyage. « Après la réunion, nous nous sommes assis à l’ombre des grands arbres tou. Beaucoup se sont rassemblés autour de nous et nous leur avons appris les lettres du livre d’orthographe hawaïen. »
Au cours des semaines suivantes, Auna commence à expliquer les fondements du christianisme en s’appuyant sur la vision polynésienne du monde et organise un culte autour d’une session de surf matinale. À cette époque, un des chefs ordonne à sa communauté de se débarrasser de ses idoles, et plus de 100 d’entre elles sont brûlées.
« Alors j’ai repensé à ce dont j’avais été témoin à Tahiti et Moorea, quand nos idoles avaient été jetées dans les flammes […] et, dans mon cœur j’ai loué Jéhovah, le vrai Dieu, de ce que je voyais maintenant ces gens suivre notre exemple », écrit Auna.
Kaʻahumanu revient de sa tournée à Maui et dans l’île d’Hawaï désireuse de promouvoir le christianisme. Elle soutient la création de la Bible hawaïenne et utilise les dix commandements pour refaçonner le droit civil de son royaume. Peu après, elle commence à parcourir les villages de l’île d’Oahu et des îles voisines, enseignant la Bible et proclamant l’Évangile.
Désireux de rentrer chez lui, et Aunawahine étant malade, Auna retourne aux îles de la Société en 1824, où le couple sert auprès de son peuple. Auna décède en 1835.
En raison aussi de la mauvaise santé de Mary Ellis, les Ellis partent en 1824 pour l’Angleterre, où William devient un promoteur itinérant et collecteur de fonds pour la LMS. Il s’initie à la photographie dès les débuts de cet art et utilise cette compétence pour entrer à Madagascar dans le cadre d’une nouvelle mission étrangère, s’attirant les faveurs des souverains de l’île en photographiant leurs portraits.
L’arrivée des missionnaires tahitiens à Hawaï en 1822 aura durablement lié la mission anglaise du Pacifique Sud aux missionnaires américains d’Hawaï dans le Pacifique Nord et a sans doute sauvé la mission de ces derniers de l’échec. Parce que les missionnaires tahitiens étaient arrivés de Kahiki, patrie légendaire des Hawaïens et source traditionnelle de leur spiritualité, le mana (esprit) des missions trouvait sa place dans l’univers polynésien. Cela fit d’Hawaï l’une des missions protestantes américaines à travers le monde les plus fructueuses du 19e siècle.
« En coopération avec les Hawaïens Thomas Hopu et John Honoli’i, Auna joua un rôle important dans la promotion du christianisme auprès des responsables hawaïens à une époque où ils avaient besoin d’être persuadés dans des termes qu’ils comprenaient », écrivait John Garrett dans To Live Among the Stars: Christian Origins in Oceania. « L’Église des îles Sandwich a une dette importante envers ses visiteurs tahitiens, dette qui n’est pas toujours reconnue à sa juste valeur. »
Christopher « Chris » Cook est un auteur basé à Kauai, Hawaï, et chercheur sur l’ère monarchique missionnaire de l’histoire d’Hawaï. Il est diplômé de l’université d’Hawaï et auteur d’une biographie d’Opukahaia-Henry Obookiah, le premier chrétien hawaiien indigène baptisé. Il blogue à l’adresse suivante www.obookiah.com