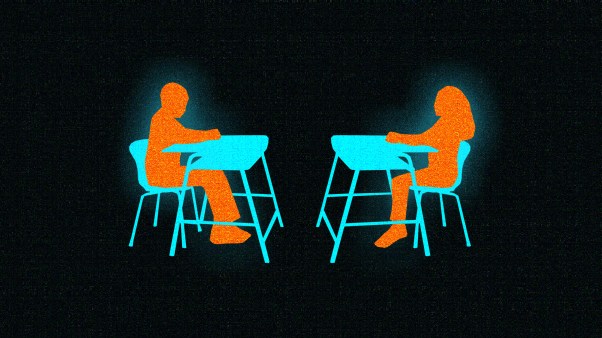Depuis son bureau situé à l’intérieur d’une enceinte fermée dans une région montagneuse du Myanmar, près de la frontière thaïlandaise, cette mère célibataire originaire d’Ouganda tapait des messages sur pas moins de six smartphones. Elle entretenait le contact avec des relations en ligne en mal d’amour issues du monde entier pour les persuader d’investir dans les cryptomonnaies.
Lorsqu’elle y parvenait, elle dirigeait ses contacts vers un site web qui, à leur insu, transférait leur argent sur des comptes appartenant à l’organisation criminelle chinoise qui l’employait.
Mais un jour de mars 2024, celle qui s’était embarquée pour ce nouveau continent en vue de ce qu’elle pensait être un emploi dans une société de marketing, n’était pas à son bureau. Au lieu de cela, elle se trouvait enfermée dans ce qu’elle et ses collègues appelaient la « chambre noire ».
En guise de punition pour avoir refusé de travailler, Brenda Kimuli était assise avec un poignet menotté au-dessus de sa tête — lui coupant la circulation — et l’autre menotté au sol. Tandis que les fers s’enfonçaient dans sa chair, elle tentait de se déplacer sur sa chaise pour retrouver la sensibilité de son bras.
Pendant plusieurs jours, elle resta suspendue, privée de nourriture et de boisson et contrainte de se souiller. Parfois, un soldat d’un groupe militaire local la frappait avec une matraque électrique. Lorsqu’elle demanda de l’eau, il apporta un peu de sa propre urine. Lorsqu’elle refusa d’ouvrir la bouche, il poussa sa joue avec la matraque et lui versa l’urine dans la gorge.
C’était la quatrième fois en six mois qu’elle se retrouvait dans la chambre noire.
« J’ai prié Dieu pour mourir », raconte Brenda Kimuli. « Je me détestais tellement. J’étais tellement fatiguée. »
Après trois jours dans la chambre noire, elle était incapable de marcher et avait perdu toute sensibilité dans sa main droite. Elle ne put faire autrement que de reprendre son travail de « dépeçage de porcs » : une expression forgée pour décrire la manière dont les escrocs cajolent leurs cibles jusqu’à ce que vienne l’heure de la boucherie par le vidage de leurs comptes bancaires.
« Si tu te rebelles encore, nous te couperons les mains », ont prévenu ses ravisseurs.
C’est six mois plus tard, dans un centre de détention pour immigrés situé dans la ville frontalière thaïlandaise de Mae Sot, que Brenda Kimuli m’a raconté son histoire. Elle frottait ses poignets meurtris en détaillant comment ce qui lui avait d’abord semblé être une « incroyable opportunité de carrière » s’est rapidement transformé en un véritable enfer.
En 2023, les Nations unies ont estimé qu’au moins 120 000 personnes pourraient être piégées dans des camps de cybercriminels au Myanmar. Cent mille autres pourraient être contraints à des opérations similaires ailleurs en Asie du Sud-Est, qu’ils soient acteurs de systèmes d’investissement frauduleux, hameçonneurs sur des applications de rencontres ou encore arnaqueurs à la cryptomonnaie.
Les organisations criminelles complexes à l’origine de ces escroqueries font deux groupes de victimes différents : celles qui se font soutirer de grosses sommes d’argent après avoir fait confiance à de faux profils en ligne, et celles qui se cachent derrière ces profils, souvent victimes de la traite des êtres humains et forcées à tromper des inconnus.
Peu de temps après les premiers développements du « dépeçage de porcs » autour de 2020, divers fonctionnaires, groupes de défense des droits humains et organisations chrétiennes — telles que l’International Justic Mission (IJM) ou Global Advance Projects, basé en Australie — se sont mis à pied d’œuvre pour libérer les esclaves de cette industrie.
« Il s’agit d’une menace mondiale. Cela a un impact sur tous les gouvernements de la planète », explique Amy Miller, directrice régionale pour l’Asie du Sud-Est de Acts of Mercy International, l’organisme d’aide et de développement du mouvement d’églises Antioch basé au Texas. « Nous devons tous prendre notre part. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous asseoir et de laisser l’ennemi piller et détruire. »
Mais la lutte contre les escrocs en ligne n’est pas aussi simple que la sensibilisation au sujet. Les autorités asiatiques sont souvent peu compréhensives à l’égard des victimes de la traite des êtres humains qui se sont échappées, car elles peinent à distinguer entre celles qui ont été piégées et celles qui se sont sciemment jointes à des activités criminelles.
Les syndicats de la cybercriminalité ont également appris à contourner la loi. Des défenseurs des droits humains affirment que ces groupes ont de puissants alliés au sein des gouvernements locaux. Et lorsque les autorités répriment les entreprises en ligne illégales, comme l’ont fait les Philippines au milieu des années 2010, les organisations s’installent dans des pays où les gouvernements sont plus faibles ou divisés.
Aucune destination n’a été aussi prometteuse en la matière que le Myanmar ravagé par la guerre civile.

Je me suis rendue à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar pour voir comment travaillent les organisations de lutte contre la traite des êtres humains. Au Cambodge, où j’ai vécu, l’escroquerie forcée est une menace bien connue.
Le trafic à grande échelle d’étrangers sans méfiance à des fins de cyberescroquerie y a commencé pendant la pandémie de COVID-19. Les confinements mondiaux ont vidé les casinos appartenant à la Chine situés dans des zones économiques spéciales destinées à attirer les investissements chinois. Ces casinos et hôtels vacants, qui étaient déjà des foyers d’activité illégale avant la pandémie, ont permis aux groupes criminels chinois d’innover.
Certains avaient déjà touché au « dépeçage de porcs » et ont commencé à publier des offres d’emploi frauduleuses en ligne. Ils ont ainsi attiré des candidats, souvent originaires d’autres régions d’Asie du Sud-Est. Une fois les candidats arrivés au Cambodge, les criminels saisissaient leurs passeports et leurs appareils électroniques, les enfermaient dans des hôtels et les forçaient à se placer devant des écrans pour commencer à escroquer en ligne.
On disait aux travailleurs que s’ils gagnaient un certain montant d’argent, ils pourraient regagner leur liberté. Comme Brenda Kimuli en a fait l’expérience, la désobéissance se traduisait souvent par des passages à tabac et des tortures.
Les escroqueries visaient initialement les citoyens chinois. Mais au fur et à mesure que les groupes criminels recrutaient des travailleurs étrangers parlant couramment d’autres langues, les escrocs ont élargi leurs activités et ont commencé à faire des victimes dans le monde entier.
Andrew Wasuwongse, directeur de l’IJM en Thaïlande, qualifie l’escroquerie forcée de « crise humanitaire » qui s’est rapidement propagée dans toute l’Asie du Sud-Est. « Il s’agit de la forme d’esclavage moderne qui connaît la croissance la plus rapide au monde », affirme-t-il.
Les sommes d’argent en jeu sont également énormes. D’après les témoignages recueillis par l’IJM auprès de victimes et de témoins au Cambodge, un escroc peut rapporter entre 300 et 400 dollars par jour, explique le directeur de l’IJM. Les experts estiment que les revenus de l’escroquerie au Cambodge dépassent à eux seuls 12 milliards de dollars par an, soit le même montant que les acheteurs américains ont dépensé lors du Cyber Monday en 2023. Interpol a déclaré au début de 2024 que l’industrie de l’escroquerie en Asie du Sud-Est rapporte environ 3 000 milliards de dollars par an.
Il n’est pas facile d’enquêter sur les cas de traite humaine en ligne et d’en poursuivre les auteurs. Les victimes forcées à l’escroquerie ne correspondent pas toutes au profil traditionnel des victimes de la traite des êtres humains. Certains sont très instruits, ont beaucoup voyagé et parlent plusieurs langues. Certains ont des diplômes en informatique ou en ingénierie.
« Certains de ceux qui sortent de ces complexes ne sont pas des victimes », souligne aussi Andrew Wasuwongse. « Si beaucoup sont tout à fait victimes de la traite d’êtres humains et ne savent pas dans quoi ils se sont embarqués, d’autres se situent entre les deux. Certains savaient qu’ils commettraient des fraudes et des escroqueries, mais ils ne se rendaient pas compte qu’ils seraient ensuite contraints à le faire. »
Début 2021, ses collègues au Cambodge ont commencé à suivre les informations diffusées par les médias sur les travailleurs étrangers contraints de commettre des escroqueries dans de vastes complexes lourdement gardés. Ils ont reçu les premiers appels de ces victimes en avril 2021 et ont entrepris d’enregistrer ces témoignages et de rassembler des preuves à l’appui. Ils fournissent ensuite des informations aux services de police locaux afin de les aider à traiter les cas les plus probants et à libérer les victimes. Lorsque les victimes s’en sortent, l’IJM les aide à déposer un rapport auprès de l’ambassade de leur pays.
Jusqu’à présent, Andrew Wasuwongse affirme que l’IJM a aidé plus de 100 personnes à échapper à des groupes d’escrocs au Cambodge, et près de 400 dans toute l’Asie du Sud-Est.
Les autorités cambodgiennes ont commencé à sévir en août 2022. Depuis lors, elles affirment avoir secouru plus de 2 000 étrangers, fermé 5 entreprises et arrêté 95 personnes. Pourtant, l’industrie illicite s’y maintient et de puissants acteurs de premier plan opèrent en toute impunité. À ce jour, le gouvernement cambodgien n’a pas arrêté, poursuivi ou condamné un seul propriétaire d’entreprise accusé d’être lié à l’escroquerie forcée, malgré les nombreux rapports à ce sujet, raconte Andrew Wasuwongse.
Pour échapper à l’obligation de rendre des comptes, de nombreuses organisations de fraude en ligne ont déplacé leurs opérations au Myanmar. Avec la guerre civile en cours, une grande partie de la zone frontalière proche de la Thaïlande, du Laos et de la Chine échappe au contrôle du gouvernement.
Au milieu de l’année 2022, l’IJM et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont entendu que des personnes s’échappaient de ces camps du Myanmar et arrivaient dans la ville frontalière thaïlandaise de Mae Sot ou à Bangkok. Dans des centres de détention pour immigrés, certaines personnes accusées d’avoir dépassé la durée de validité de leur visa prétendaient avoir été victimes de l’escroquerie forcée.
À la même époque, Judah Tana, fondateur de Global Advance Projects, une organisation chrétienne luttant contre l’exploitation des enfants, se trouvait à Mae Sot, d’où il pouvait voir des ouvriers ériger de massifs et mystérieux complexes de l’autre côté de la rivière Moei, dans l’État de Kayin, au Myanmar.
Un soir, une amie lui a signalé un message surprenant sur un groupe Facebook de Mae Sot qu’elle suivait. Une Kényane se renseignait sur les visas et affirmait être victime de la traite des êtres humains en Thaïlande.
« Au début, nous avons pensé qu’il s’agissait d’une escroquerie », raconte Judah Tana. Il lui a envoyé des messages pour lui poser des questions sur sa situation et sur la manière dont elle était arrivée en Thaïlande. C’est alors que sa femme est tombée sur un tweet du gouvernement kényan mettant en garde contre les complexes de cyberescroquerie.
Judah Tana a alors contacté l’ambassade du Kenya à Bangkok. Il a continué à communiquer avec la femme et a appris que six autres Kényans dans la même situation appelaient à l’aide. En prenant contact avec différentes personnes au sein des forces de l’ordre thaïlandaises, du gouvernement et des ambassades étrangères, il semblait que personne n’avait la moindre idée de ce qui se passait dans ces complexes.
Grâce à son travail sur les droits humains auprès des réfugiés, des enfants immigrés et des anciens enfants soldats, Judah Tana a développé des liens avec des groupes de résistance appartenant aux minorités ethniques, en position de force dans une grande partie des régions frontalières du Myanmar. Il a pris contact avec certains de leurs chefs et leur a demandé de l’aide pour libérer les Kényans. Ils ont accepté d’en parler avec les patrons chinois de ces entreprises d’escroquerie en ligne.
En octobre 2022, les sept Kényans ont été libérés. À partir de ce moment-là, d’autres personnes piégées dans les enceintes ont commencé à appeler Judah Tana à partir de téléphones dérobés.
Avec d’autres groupes, son organisation a formé une petite coalition pour coordonner les efforts en vue de permettre à ces travailleurs de s’enfuir. Amy Miller, la directrice d’Acts of Mercy, a rapidement quitté le Cambodge pour s’installer en Thaïlande, afin d’être plus proche de ces complexes frontaliers.
L’un d’entre eux était celui où Brenda Kimuli était piégée.

Avant de venir en Thaïlande, elle travaillait dans un fast-food à Dubaï et envoyait de l’argent à ses parents en Ouganda pour payer la scolarité de son fils.
Elle nous a raconté comment elle est devenue victime de la traite des êtres humains et s’est trouvée réduite en esclavage à 3 000 kilomètres de là.
En 2023, une amie et collègue lui parle d’un emploi prometteur dans le domaine du marketing à Bangkok, avec de meilleurs horaires et un meilleur salaire. Brenda Kimuli aimait la télévision thaïlandaise et pensait qu’il serait plaisant de vivre à Bangkok. Sa collègue la met en contact avec une recruteuse du nom de Joanna. Brenda et son amie se joignent rapidement à plusieurs autres personnes pour rencontrer la recruteuse à Dubaï.
Les candidats potentiels peuvent alors poser leurs questions sur la description du poste, les avantages et le processus d’embauche. Joanna répond avec assurance à chacune d’entre elles. L’entreprise, Young An, exige une vitesse de frappe et des compétences informatiques de base et promet une formation en cours d’emploi. La recruteuse leur présente même des vidéos de membres du personnel témoignant positivement de leur environnement de travail. Impressionnée, Brenda Kimuli pose sa candidature et est acceptée après une série d’entretiens.
Elle et les autres personnes recrutées sont alors invitées à entrer en Thaïlande avec des visas de tourisme qui seraient bientôt convertis en visas de travail, une procédure légale dans le pays. En septembre 2023, Brenda Kimuli et quatre autres personnes atterrissent à Bangkok. Un chauffeur de la compagnie les accueille à l’aéroport pour les conduire à leur hôtel.
Les choses prennent alors rapidement une sombre tournure. Le chauffeur leur fait signe de lui donner leurs passeports. Au fur et à mesure que le trajet s’étire sur près de deux heures, la tension augmente. Lorsqu’ils essayent de poser des questions, le chauffeur leur répond : « No English » (pas d’anglais). Personne n’a de téléphone local. Impossible d’espérer appeler quelqu’un.
Lorsque le conducteur fait une pause pour prendre de l’essence et quelque chose à manger, les quatre passagers restent enfermés dans le véhicule. Au cours de la nuit, ils franchissent plusieurs barrages routiers gardés par des soldats armés.
« J’ai crié à Dieu et j’ai prié », se remémore Brenda Kimuli. « J’ai cru que j’allais mourir. »
Le chauffeur s’arrête finalement dans ce qui semble être le milieu de nulle part, et une camionnette arrive. On les force à monter dans le nouveau véhicule, qui démarre en trombe dans l’obscurité. Puis, au bord d’une rivière, un groupe d’hommes armés charge leurs bagages dans un bateau et leur dit de monter.
Ils finissent par arriver aux portes d’une enceinte gardée. Les soldats prennent leurs téléphones et fouillent leurs bagages.
« Je n’arrivais plus à penser correctement à ce moment-là », raconte Brenda Kimuli. « J’étais submergée par la peur et l’épuisement. Toutes les femmes ont été enfermées dans une pièce pour dormir. Je savais que c’était un endroit dangereux. »
Après environ trois heures de sommeil, un Chinois les réveille. Un Birman le traduit pendant qu’il leur explique le déroulement de leurs journées dans l’enceinte de l’établissement.
Tous les responsables étaient chinois, rapporte Brenda Kimuli, mais les soldats qui gardaient l’enceinte étaient originaires du Myanmar. Un rapport de l’ONU confirme que « les garde-frontières sous l’autorité de l’armée du Myanmar ou de ses mandataires » assurent la protection des opérations d’escroquerie. De tels arrangements aident à financer les groupes armés, explique Judah Tana.
Le traducteur de Brenda l’emmène dans une autre pièce, d’où elle comprend vite qu’elle et les autres étrangers kidnappés vont devoir escroquer les gens. Un chef lui donne six téléphones, une longue liste de numéros de téléphone et un script à suivre pour envoyer des messages. Lorsque les victimes de l’escroquerie demandent à discuter en vidéo ou à voir des photos de Brenda, les responsables font venir des mannequins, dont elle apprendra qu’elles sont également retenues contre leur gré.
Pour instaurer la confiance avec leurs cibles, Brenda Kimuli et d’autres tentent d’initier des relations amoureuses. Ils créent des profils Tinder. Certains nous ont rapporté que, si leurs profils sur les applications de rencontres étaient signalés comme suspects et fermés, leurs patrons leur demandaient de créer des comptes sur X et de se lier d’amitié avec des partisans du président Donald Trump. À l’aide d’un scénario, ils discutent de politique, puis présentent aux victimes des investissements en cryptomonnaies ou leur demandent de faire des dons à de fausses organisations conservatrices.
Brenda Kimuli et ses collègues nous ont rapporté qu’ils étaient contraints de travailler de 16 à 20 heures par jour. Ils décrivent des conditions similaires à celles dont d’autres victimes de la traite ont fait part aux médias et aux organismes de protection des droits humains.
« Les sanctions étaient sévères si nous mettions trop de temps à répondre à la personne que nous escroquions », se souvient Brenda Kimuli. « Je ne pouvais pas quitter mon clavier. »
Si elle est lente ou s’endort, un ravisseur lui donne des coups de bâton ou lui applique un aiguillon électrique sur la jambe. La première fois qu’elle est punie pour avoir réagi trop lentement, un garde lui donne un coup si violent à l’arrière des jambes qu’elle aura du mal à s’asseoir pendant deux semaines.
La pire punition, cependant, c’est la chambre noire.
Lorsque Brenda Kimuli perd un client avec lequel elle avait établi une relation, ses ravisseurs l’emmènent dans cette pièce et la menottent suspendue par les bras à un tuyau du plafond. Les soldats lui donnaient des coups de pied, des coups de bâton et l’électrocutaient si elle pleurait ou s’endormait. Ils lui aspergèrent le visage d’eau au point qu’elle pense qu’elle allait suffoquer. Elle entendait les cris d’autres personnes torturées. Parfois, les Chinois venaient aider les soldats.
Un jour de décembre, Brenda et 20 autres Ougandais refusent de travailler et demandent à leurs ravisseurs de les renvoyer chez eux. Une centaine de soldats armés sont alors appelés pour emmener les manifestants dans la chambre noire, où, raconte-t-elle, ils seront torturés et privés de nourriture et d’eau pendant trois jours.
Ensuite, Brenda et quelques autres sont transférés dans un autre complexe. Le lieu est similaire, mais elle escroque désormais des citoyens turcs et pakistanais sur Facebook et TikTok. Une fois qu’elle a réussi à attirer une victime, un travailleur chinois prend le relais pour boucler le volet financier de l’escroquerie.
Après environ cinq mois de travail, un chef demande à Brenda de faire ses valises : elle rentre chez elle. Mais au lieu de prendre le chemin de l’aéroport, elle est ramenée au premier complexe. « Je t’ai achetée », lui dit-on. « J’ai dépensé trop d’argent pour toi. Il faut travailler longtemps pour payer cela. »
Elle sent alors sa détermination s’évanouir.
« Je me suis couchée et j’ai abandonné. » C’est à ce moment-là qu’elle est emmenée dans la chambre noire pour la quatrième fois.
D’autres travailleurs secourus nous ont raconté qu’on leur faisait faire des centaines de flexions des jambes sous un soleil de plomb parce qu’ils n’atteignaient pas leurs quotas. Leurs responsables leur refusaient la nourriture s’ils n’étaient pas à la hauteur des attentes. Ils ont été torturés pour s’être plaints des conditions de vie ou pour avoir fait des fautes d’anglais.
Un rescapé a enlevé sa chemise pour montrer sa poitrine et son dos, couverts de cicatrices et d’ecchymoses dues aux coups de bâton et à l’électrocution ; certaines blessures étaient encore en cours de cicatrisation. Comme Brenda Kimuli, ses bras et ses poignets portaient également des marques de menottes.

Pendant que Brenda vivait son cauchemar, des responsables gouvernementaux s’efforçaient de la libérer. Quelques-uns des Ougandais avaient des téléphones cachés ; Brenda Kimuli en utilise un pour appeler chez elle et est également mise en contact avec Judah Tana et Amy Miller. Vers le mois de décembre, un autre Ougandais parvient à contacter Betty Oyella Bigombe, ambassadrice d’Ouganda dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est.
Consternée par ce qu’elle entend, l’ambassadrice commence à répondre aux appels des Ougandais pris au piège, jour et nuit, les encourageant à rester forts tandis qu’elle essaye de faire quelque chose. Betty Oyella Bigombe a de l’expérience en matière de négociation : dans les années 1990 et au début des années 2000, elle fut la principale négociatrice lors des pourparlers de paix avec Joseph Kony, le chef du groupe rebelle militant de l’Armée de résistance du Seigneur.
Finalement, elle est mise en contact avec Amy Miller et Judah Tana. Elle contacte ensuite les Forces de garde-frontières, une milice du Myanmar qui contrôle la région où se trouvent les complexes. Par l’intermédiaire de la milice, elle négocie avec les chefs criminels, qui demandent d’abord une rançon de 10 000 dollars par personne que l’ambassadrice refuse de payer.
Le week-end de Pâques 2024, les responsables réveillent Brenda Kimuli et 22 autres Ougandais plus tôt que prévu. Elle raconte qu’ils avaient forcé certains travailleurs à enregistrer des vidéos dans lesquelles ils disaient avoir eu une bonne expérience avec l’entreprise ; tous ont été contraints de signer des aveux indiquant qu’ils avaient accepté le travail de leur plein gré et qu’ils avaient été bien traités.
Ils sont ensuite conduits jusqu’à un pont sur la rivière Moei, en face de la Thaïlande.
C’est lorsqu’elle aperçoit Judah Tana et Amy Miller sur le rivage thaïlandais que Brenda Kimuli comprend qu’elle est vraiment libre.
Les Ougandais posent le pied en Thaïlande trois mois après leur premier appel téléphonique à Betty Oyella Bigombe, qui s’est empressée de les accueillir à Mae Sot.
« Cette histoire n’aurait jamais pu se produire sans Jésus », témoigne Amy Miller. « L’ambassadrice a prié à genoux pour eux pendant des mois. Nous étions constamment en train de prier. »
En février 2024, alors que je réalisais ce reportage, j’ai reçu un appel d’une amie nommée Heidi Boyd, qui vit dans le nord-ouest des États-Unis.
Lors de notre échange, j’ai demandé à Heidi comment se passait sa vie sentimentale. Elle a la quarantaine et avait du mal à rencontrer des hommes célibataires de son âge. Elle a essayé l’application de rencontres Bumble, mais a été déçue par les quelques rendez-vous qu’elle a eus.
Elle était sur le point de quitter l’application en 2023 lorsqu’un homme nommé Sim est entré en contact avec elle. Il avait été intéressé par son profil, disait-il, parce qu’elle se décrivait comme attirée par les personnes qui aidaient les autres.
Sim et Heidi ont commencé à se parler quotidiennement. Heidi s’était rendue en Chine à plusieurs reprises, et Sim était un ressortissant de Hong Kong qui disait vivre à Los Angeles, une ville où elle avait déjà vécu. Son profil et ses informations semblaient cohérents. Il lui a dit qu’il se trouvait à Hong Kong pour s’occuper de son père malade, et qu’ils ne pourraient pas se rencontrer avant un certain temps.
Finalement, ils ont senti qu’il était temps de construire quelque chose d’exclusif entre eux, et ils ont déplacé leurs conversations de Bumble à WhatsApp. Ils n’ont discuté par vidéo qu’à quelques reprises, car leurs fuseaux horaires étaient difficiles à gérer.
Environ trois mois après l’approfondissement de leur relation, ils parlaient de voyager ensemble dans le monde entier pour servir les autres.
C’est à cette époque que Sim a fait savoir qu’il avait réussi à investir dans les cryptomonnaies. Heidi, qui se considère comme une experte en matière d’investissement, s’est intéressée à la question. Elle pensait que l’argent qu’elle gagnerait ainsi pourrait servir à soutenir des ministères internationaux.
« Je suis consciente de mes privilèges et de la responsabilité qui m’incombe d’aider les gens avec mes ressources », me dit Heidi. Elle m’a montré des captures d’écran de leurs discussions. « Je voulais donner de l’argent à des gens qui en avaient besoin. »
Sim lui a recommandé une application d’investissement dans les cryptomonnaies. Heidi a enquêté sur la plateforme de cryptomonnaie et son site web ; ils semblaient légaux. Elle a téléchargé l’application sur son téléphone et a commencé à y déposer des fonds. Certains jours, elle gagnait de l’argent, d’autres, elle en perdait. Elle pouvait retirer des fonds quand elle le souhaitait.
Elle a parfois rencontré des difficultés lorsqu’elle a essayé de transférer de l’argent de sa banque vers son compte d’investissement. Mais Sim lui a dit que c’était normal, car les grandes banques ne voulaient pas perdre leurs clients.
Au cours des mois suivants, son investissement s’est accru. Lorsqu’elle a atteint 150 000 dollars, la plateforme de cryptomonnaie a soudainement signalé son compte comme suspect, l’informant qu’elle avait besoin de preuves supplémentaires de son identité. La plateforme imposait une nouvelle restriction : elle ne pouvait pas retirer ses fonds à moins de verser un acompte de 20 %.
Heidi a emprunté de l’argent à sa mère pour effectuer le dépôt. Elle m’a dit qu’elle était sur le point de le payer lorsque sa sœur lui a envoyé un article sur ce qu’on appelle le « dépeçage de porcs ».
Heidi a lu l’article et s’est rendu compte que c’était ce qu’elle était en train de vivre.
« Je pense que je suis victime d’une escroquerie », m’a-t-elle dit au téléphone. Elle commençait lentement à reconnaître que Sim en avait fait partie.
Elle m’a dit qu’elle voulait lui écrire pour lui dire à quel point il était une personne horrible.
J’ai suggéré que Sim pourrait lui aussi être une victime, qu’il pourrait en fait même être plusieurs personnes, dont certaines avaient été réduites en esclavage par des groupes criminels.
« J’ai 50 % du cœur brisé par la perte d’une relation qui semblait réelle », m’a plus tard partagé Heidi. « Je pensais avoir un avenir avec quelqu’un. Pendant cinq mois, j’ai partagé avec eux une grande partie de ma vie. L’autre partie de moi est blessée parce que j’ai perdu mon capital de retraite. »
Ces deux trahisons l’ont profondément blessée et lui ont causé une honte incroyable. Si elle a accepté de partager son histoire, dit-elle, c’est parce qu’elle espère que la mise en lumière de cette honte la priverait de son pouvoir — et aussi parce qu’il est possible que sa honte soit partagée par quelqu’un à l’autre bout du monde.
« Je me sens poussée à prier », m’a dit mon amie. « Dieu m’a donné une pleine assurance de son amour et du fait qu’il aime toutes les personnes victimes de la traite. Dieu aime les seigneurs du crime chinois. J’ai prié pour que leurs cœurs soient changés. »
Des histoires comme celle de Brenda Kimuli, où un groupe entier de travailleurs est libéré avec l’aide de représentants de son gouvernement, sont une source d’inspiration. Elles sont également rares.
Le plus souvent, les victimes sont libérées parce qu’elles ont payé une rançon, parce qu’elles ont atteint leur quota ou parce qu’elles sont peu performantes.
« Normalement, ils savent qu’ils vont sortir », raconte Amy Miller, de l’association Acts of Mercy. « Ils communiquent et nous allons les chercher. Ils ont subi des traumatismes ; ils ont besoin de temps pour respirer et se voir offrir des choix ou pour se promener et faire l’expérience de la liberté. »
Lorsque les travailleurs pris au piège contactent le monde extérieur pour demander de l’aide, il faut parfois des mois de communication pour coordonner leur libération, et les risques sont très élevés.
Il arrive parfois, dans des cas dramatiques, qu’une victime contacte Judah Tana et Amy Miller pour leur dire qu’elle est en train d’être déplacée ou vendue à un autre complexe. Des victimes les ont parfois informés de l’endroit où elles se trouvaient, puis ont sauté d’un véhicule en marche pour s’enfuir.
De telles évasions sont évidemment dangereuses : les victimes s’enfuient sans sac ni passeport et peuvent être blessées.
« Je ne suis ni stupide ni naïf face aux risques », analyse Judah Tana. « Mais j’aime tellement Jésus, et je me dis qu’Il le ferait ».
Pourtant, échapper aux complexes n’est que le début d’un voyage de retour qui peut s’avérer ardu.
Les travailleurs victimes de la traite des êtres humains, qui ont d’abord été amenés en Thaïlande, sont souvent piégés au Myanmar à l’expiration de leur visa. S’ils parviennent à rentrer en Thaïlande, ils le font en étant soupçonnés d’avoir dépassé la durée de validité de leur visa, d’avoir égaré leur passeport et de s’être livrés à des activités criminelles.
Dans de telles situations, les travailleurs clandestins peuvent se rendre aux services d’immigration thaïlandais et payer une amende de 4 000 bahts (110 $). Après quelques jours en prison, ils seront envoyés dans un centre de détention jusqu’à ce qu’ils puissent trouver de l’argent pour acheter un billet de retour.
« Le centre de détention pour immigrés est un endroit difficile », rapporte Amy Miller. « Ils n’ont presque pas de nourriture et les conditions peuvent être pires que dans les complexes. »
Une autre option consiste à passer par le National Referral Mechanism, un programme international visant à reconnaître les victimes de la traite des êtres humains et à leur fournir un logement et d’autres formes d’assistance. Des fonctionnaires thaïlandais interrogent les victimes pour vérifier leurs dires et recueillir des preuves qui pourraient un jour être utilisées pour poursuivre les trafiquants de main-d’œuvre.
Les 23 Ougandais ont choisi d’essayer de faire reconnaître par le gouvernement leur statut de victimes de la traite des êtres humains, avec l’ambassadrice Bigombe à leurs côtés. Le 11 avril 2024, après deux jours d’entretiens, les 23 ont été reconnus comme victimes.
Ils ont eu de la chance. Selon Amy Miller, seuls 10 % des candidats au programme sont reconnus. « Nous essayons de les aider à comprendre le processus et les questions qui seront posées. Mais le gouvernement a sa propre charge de la preuve et [ses idées sur] ce qui fait qu’une victime est une victime. Ce n’est pas toujours clair. »

L’organisation de Amy Miller et Judah Tana, avec d’autres groupes chrétiens de défense des droits humains, font pression pour que l’on prenne davantage conscience, au niveau mondial, du combat difficile que doivent mener les victimes de la traite des êtres humains, même lorsqu’elles ont recouvré la liberté.
« Il y a encore trop de réunions à huis clos sur ces choses, et seuls les chefs d’État ou les principaux acteurs sont invités […] de sorte que les profanes ne sont pas informés », estime Judah Tana. « Le corps du Christ dans son ensemble doit faire passer le message à ce sujet. »
Les travailleurs des centres d’escroquerie en ligne rentrent chez eux traumatisés, incapables de parler de leur expérience. Beaucoup sont musulmans ou chrétiens et éprouvent une profonde honte pour ce qu’ils ont fait.
« Ce que j’ai fait est haram » — interdit par la loi islamique — commente un jeune musulman d’Asie du Sud peu après avoir fui un complexe. « Ma famille ne doit jamais savoir. »
À un moment donné, dit-il, ses ravisseurs lui ont offert une prostituée pour son bon travail, ce qu’il a refusé.
Amy Miller et Judah Tana affirment que des musulmans qui ont été contraints de se livrer à l’escroquerie leur ont dit que, si les gens savaient ce qu’ils avaient fait, la honte les contraindrait à se suicider.
Si la lutte contre la traite des êtres humains est l’une des causes clairement soutenues par des évangéliques en Occident, les ministères engagés dans ce domaine affirment que les églises d’Afrique et d’Asie ont également un rôle important à jouer.
Elles sont en première ligne pour sensibiliser les populations les plus exposées à la traite des êtres humains. Une victime ougandaise m’a dit qu’elle aimerait que l’Église fournisse davantage d’instruction et de formation professionnelle pour que les gens puissent travailler localement, ce qui les rendrait moins enclins à rechercher des opportunités trompeuses à l’étranger.
Les organisations de lutte contre la traite des êtres humains souhaiteraient également que davantage d’églises deviennent des lieux sûrs où les anciens travailleurs de l’escroquerie pourraient parler de leur culpabilité et de leurs traumatismes. L’un des objectifs de Amy Miller et Judah Tana est de créer une base de données mondiale des églises qui offrent des services de conseil, de suivi et d’aide à l’emploi aux fraudeurs forcés rapatriés.
« Ils ont besoin que les responsables des églises et des ONG les écoutent et comprennent ce qu’ils ressentent », explique Amy Miller. « La guérison se produit dans le fait d’être avec et d’accompagner les personnes dans leur souffrance. Jésus est présent avec nous dans nos souffrances. »
Même après que les Ougandais ont été officiellement reconnus comme victimes de la traite, Brenda Kimuli est restée dans un refuge gouvernemental à Mae Sot pendant encore deux mois.
Il y avait de la paperasse à traiter. Il y a eu la lenteur de la logistique pour obtenir des fonds de l’ONU pour la nourriture, les frais juridiques, le logement et les billets d’avion. Le nombre de travailleurs rescapés comme Brenda Kimuli ne cesse de croître dans toute l’Asie du Sud-Est, mettant à rude épreuve les petits programmes humanitaires qui tentent de leur venir en aide.
Le 23 mai, les Ougandais ont finalement pris l’avion pour rentrer chez eux. Brenda Kimuli rêvait d’un simple repas de manioc et de thé à la table de la cuisine familiale.
Pendant cette longue attente, elle a beaucoup réfléchi à la providence de Dieu.
Elle avait d’abord répondu à l’annonce pour un emploi en Asie parce qu’elle avait un fils à charge et qu’elle voulait faire plus pour lui que ce qu’elle pouvait faire avec son emploi dans la restauration rapide à Dubaï.
Mais Dieu s’occupait déjà de lui.
Pendant qu’elle restait piégée pendant sept mois dans des travaux forcés, elle a appris plus tard que l’école de son fils lui avait accordé une bourse pour couvrir ses frais de scolarité et de nourriture. « J’ai disparu, et Dieu s’est quand même occupé de mon fils », témoigne-t-elle.
L’argent égarait tout le monde dans ce complexe du Myanmar : ses ravisseurs, ses victimes en ligne, et même elle-même.
« J’avais été attirée par l’argent », reconnaît Brenda Kimuli. « Dieu m’a montré que l’argent n’est pas tout. Je sais maintenant que Dieu peut me donner tout ce dont j’ai besoin. Je rentre chez moi sans rien, mais avec la confiance en Dieu. »
Erin Foley vit en Thaïlande et travaille dans le domaine de la communication pour des ministères s’occupant de réfugiés et d’orphelins.