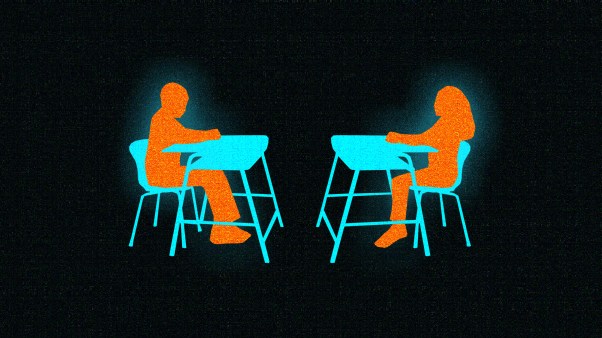Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement nous entendre ? La question vous est peut-être venue face à l’une ou l’autre récente manifestation de mépris intolérant qui foisonnent dans nos sociétés polarisées. Si seulement nous pouvions apprendre à nous supporter les uns les autres… Mais si la tolérance est une vertu citoyenne importante, elle n’est probablement pas suffisante.
Nous avons sûrement tous déjà prié pour qu’une réunion délicate où il faut éviter à tout prix d’aborder certains sujets se passe sereinement, que ce soit en famille ou dans un autre contexte. Mais, même si nous parvenons à passer à travers sans disputes, ces moments nous laissent fréquemment un sentiment de tristesse. Nous aurons peut-être réussi à supporter nos « adversaires », mais il nous manque ce à quoi nos cœurs aspirent le plus : l’amour.
Lorsque ces « adversaires » sont loin de nous, la question de l’amour que nous avons pour eux peut être assez aisément laissée de côté. Mais quand ils se trouvent de l’autre côté de la table, dans la même réunion de comité ou dans un projet de groupe commun, le caractère contre-culturel de la sagesse du commandement de Jésus — aimer ton ennemi, qui est ton prochain (Mt 5.43-44) — se fait très apparent.
Paul me semble offrir un précieux éclairage sur le sujet dans les derniers chapitres de sa lettre à l’Église de Rome. On voit souvent l’épître aux Romains comme un traité théologique très dense, mais c’est aussi — peut-être même avant tout — une lettre pastorale cherchant à réconcilier chrétiens d’origine juive et chrétiens d’origine païenne.
Dans son épître aux Galates, Paul soulignait le fait qu’il n’y avait plus « ni Juif ni non-Juif […], car vous êtes tous un en Jésus-Christ » (3.28). Une dizaine d’années plus tard, cette réalité peinait encore à prendre corps pour les chrétiens de Rome. Ce n’est pas tant la vérité fondamentale de l’Évangile qui était mise en doute ici (Paul ne doit plus combattre l’exigence de la circoncision), mais bien sa mise en pratique. Une myriade de petits griefs menaçait de transformer le prochain en ennemi.
L’un de ces griefs provenait des différences culturelles concernant la nourriture partagée lors des repas pris en commun (Rm 14.1-3). Devait-on observer les prescriptions alimentaires juives lors des repas communautaires au sein de l’Église ? Avant l’expulsion des Juifs de Rome par Claude en 41 apr. J.-C. l’Église chrétienne, en grande partie juive, pouvait considérer ces règles comme normatives et même essentielles. Mais à mesure que des personnes d’origine non juive se joignaient aux croyants, elles perdaient de leur prévalence.
Cependant, bien plus que de simples préférences ou habitudes, les pratiques alimentaires — tout comme aussi la circoncision, le sabbat, les fêtes, etc. — démarquaient les Juifs en tant que peuple de l’alliance avec Dieu. Ces pratiques définissaient l’identité et les frontières, déterminant qui faisait ou non partie de la communauté. Dans un contexte aussi polarisé, avec des divisions si tranchées entre les groupes, la stratégie rhétorique de Paul est d’estomper les lignes de démarcation en remplaçant juif et non-juif par faible et fort.
Au premier abord, il semblerait y avoir de quoi accentuer l’opposition entre les parties en attribuant à l’une une étiquette péjorative par rapport à l’autre. Mais le génie de la stratégie de Paul réside dans son ambiguïté volontaire : il n’y a toujours pas de consensus scientifique quant à savoir qui est « faible » ou « fort » dans la communauté. De part et d’autre, Paul laisse une place à des individus dont les croyances et les pratiques ne s’alignent pas sur l’identité de leurs semblables.
Paul veut avant tout définir une éthique de l’accueil : « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu » (15.7). Appliqué à l’ensemble de l’Église, le devoir des « forts » est d’accueillir « celui qui est faible » (14.1). « Nous qui sommes forts, nous devons [bastazein] les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. » (15.1, SEM)
Paul n’appelle pas simplement à supporter un comportement indésirable aussi longtemps que l’on en est capable. La tolérance ne peut jamais être qu’une stratégie provisoire pour maintenir la paix jusqu’à ce que l’on parvienne à une véritable réconciliation. L’exhortation radicale de Paul est de « porter », d’accepter ou de soutenir les faibles.
Ce soutien implique, pour l’apôtre, un changement de comportement important pour les forts : « Cessons donc de nous juger [krinōmen] les uns les autres. Jugez [krinatē] plutôt préférable de ne rien faire qui amène quelqu’un d’autre à se détourner de Dieu ou de la foi. (14.13, SEM. Voir aussi les versets 14-15).
En d’autres termes, Paul joue subtilement du verbe « juger » (krinō), pour dire en substance ce qu’a traduit la Nouvelle Bible Segond : « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres ; usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d’achoppement ou une cause de chute. » Au lieu de juger les autres, c’est notre propre comportement qu’il nous faut reconsidérer.
Bien que les deux parties au conflit soient invitées à s’accueillir mutuellement, Paul poursuit en exhortant les forts à soutenir les faibles. Il faut qu’ils tiennent compte des préférences alimentaires de ceux-ci et changent de comportement. Et cela même si celui-ci est légitime et correct, comme l’admet Paul.
L’objectif plus large de l’apôtre est d’initier un nouveau type de raisonnement moral façonné par l’amour sacrificiel du Christ. Tout comme le Christ a donné sa vie, les forts doivent renoncer à leurs préférences alimentaires pour le bien des faibles. C’est ce que signifie, dans ce contexte particulier, « marcher dans l’amour » (2 Jn 1.6).
En respectant la conscience de chacun, nous reconnaissons également que « le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit » (Rm 14.17). C’est le royaume de Dieu, manifesté dans son Église, qui importe avant tout. Pour préserver ce bien supérieur, il faut pouvoir renoncer à des biens secondaires — en l’occurrence, manger ce que l’on voudrait manger.
Tout cela encourage à reconsidérer quelque peu certaines valeurs et habitudes bien ancrées dans notre société : premièrement, notre conception de la liberté ; deuxièmement, notre tendance à caricaturer nos adversaires ; et troisièmement, dans certains contextes, la tendance à sacraliser la politique.
Selon le philosophe politique John Stuart Mill, dans une société démocratique, être libre c’est avoir une autonomie personnelle. À moins de causer un préjudice physique aux autres ou à leur propriété, je devrais être libre de vivre comme je l’entends selon mes propres goûts et intérêts.
Ce principe de Mill, connu comme le principe de non-nuisance, inspire clairement notre compréhension de la liberté et de ses limites dans une société démocratique. La liberté ainsi définie est largement reconnue comme bien suprême. La réduire pour tenir compte des scrupules religieux de notre prochain, constituerait pour Mill — et je soupçonne pour bon nombre de nos contemporains — un affront à la notion même de liberté citoyenne.
La définition que donne Paul de la liberté est radicalement différente : nous devons être libérés du pouvoir asservissant du péché, non pas en vue de notre autonomie personnelle, mais en vue de la justice. Pour Paul, le choix ne se fait pas entre l’esclavage ou la liberté. Nous avons à choisir entre deux types d’esclavage différents : « libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice » (6.18).
Lorsque Paul oppose « le manger et le boire » à « la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit » (14.17), il souligne par là que la liberté ne consiste pas simplement à obtenir ce que l’on veut. Il s’agit de vivre une nouvelle forme de vie dans laquelle l’Esprit nous libère pour aimer notre prochain.
À l’opposé, l’aspiration à une autonomie individuelle la plus large possible — l’accomplissement de tous nos désirs contraint uniquement par la nécessité de ne pas directement nuire à autrui — conduit à la polarisation. Quand nous considérons notre autonomie comme bien suprême, nos désirs contradictoires créent la division. Des clans se forment pour protéger leurs intérêts, cherchant chacun à obtenir le pouvoir par la règle de la majorité. Et dans un système où — idéalement au moins — la majorité l’emporte, il est évidemment avantageux d’être du côté « fort », et non du côté « faible ».
C’est cette logique que remet en question la définition que donne Paul de la liberté : une justice manifestée par l’amour du prochain. Se libérer de l’emprise du péché, entrer dans le royaume de justice, de paix et de joie de Dieu, conduit à promouvoir l’unité plutôt que la division. La vision de Paul est une vision communautaire — juifs et non-juifs adorant Dieu ensemble (15.7-13) — qu’une focalisation polarisante sur l’autonomie ne peut atteindre.
Deuxièmement, nous nous faisons souvent une idée erronée de nos adversaires, créant des stéréotypes rigides et trompeurs : « Si vous pensez ceci, alors vous devez aussi croire cela ». L’auteur américain Alan Jacobs, avec d’autres, souligne comment nous nous construisons ainsi des hommes de paille plus faciles à combattre. Plutôt que de chercher à comprendre les nuances des points de vue de nos adversaires, nous les réduisons à des formules réductrices : « En d’autres termes, mon adversaire pense que nous devrions faire du tort aux plus vulnérables ».
La vision de la liberté que propose Paul, elle, nous invite à considérer nos adversaires comme nous-mêmes. En Romains 14-15, l’apôtre brouille les lignes de démarcation entre les groupes opposés, contrant notre tendance à caricaturer nos adversaires et leurs motivations. Il exhorte les deux camps à agir par fidélité incarnée au Christ, qu’ils observent certains jours ou non, qu’ils choisissent de manger tel plat ou de s’en abstenir (14.5-6).
Cette approche n’est pas simplement rhétorique. Elle s’enracine dans une valeur fondamentale : nous appartenons au Seigneur dans la vie comme dans la mort (14.7-8). Paul compare les croyants à des domestiques qui ne doivent pas se juger les uns les autres puisqu’ils servent tous le même maître (14.4). Cette perspective nous encourage à considérer les autres comme des compagnons de service, une étape essentielle pour arriver à les aimer comme nous-mêmes.
Troisièmement, l’éthique de Paul nous met en garde contre le danger de sacraliser la politique et notre prétention orgueilleuse à imaginer que Dieu pense et juge comme nous et que sa volonté s’aligne sur nos propres objectifs. Lorsque nous sacralisons nos programmes politiques (ou autres), nous domestiquons Dieu à notre image et nous invoquons son autorité pour juger les autres.
L’écrivaine Anne Lamott nous met en garde contre l’idée que Dieu déteste les mêmes personnes que nous. Elle dénonce un état d’esprit qui alimente la violence, à la manière du slogan de la première croisade : Deus vult (« Dieu le veut ! »). Cet état d’esprit nous fait courir le danger de confondre nos biens secondaires avec le bien ultime voulu par Dieu, et de défendre ceux-ci comme s’ils avaient la même priorité.
Paul souligne que Dieu est au-dessus de nos divisions et que nous serons tous confrontés de la même manière à son jugement : « chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même » (14.12). Notre redevabilité ultime devant Dieu ne peut que réfréner notre envie de le mettre au service de nos luttes contre nos « ennemis » et de juger ceux-ci selon nos propres standards imparfaits.
Julien C. H. Smith est professeur de sciences humaines et de théologie au Christ College, le collège d’honneur de l’université de Valparaiso. Son dernier ouvrage s’intitule Paul and the Good Life: Transformation and Citizenship in the Commonwealth of God.
Traduit par Anne Haumont