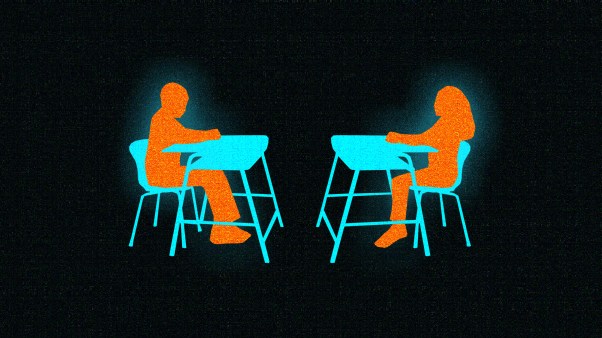Je ne me souviens pas du moment où j’ai réalisé que je n’avais pas de communauté.
C’était peut-être un dimanche, après le culte, lorsque, portant mon fils de neuf mois, je suis passée de la garderie à la salle principale et que j’ai éprouvé exactement ce que j’avais ressenti quand, immigrante de 14 ans, je suis entrée pour la première fois dans une école américaine. Horrible impression de déjà-vu. J’avais face à moi un océan de visages que je ne connaissais pas, des gens rassemblés en petits groupes d’amis, qui souriaient, bavardaient, hochaient la tête. Tout le monde semblait avoir sa place quelque part, et j’étais comme une nouvelle venue dans une église que je fréquentais depuis cinq ans.
Ou peut-être était-ce le samedi où ma mère passait un scanner pour un cancer du pancréas en Corée du Sud et où mon mari, David, avait dû s’absenter. J’étais mère seule à la maison, essayant de ne pas pleurer devant mon fils, Tov. J’aurais tellement aimé qu’un ami se présente à ma porte et s’assoie avec moi, prie à haute voix ou joue avec Tov pendant que j’essuyais mes larmes.
La question de la communauté ne m’avait pas beaucoup préoccupé jusqu’à ce que j’en aie vraiment besoin et que je constate son absence.
Les chrétiens connaissent souvent bien Genèse 2.18 : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. » Ce verset est le plus souvent appliqué au mariage, mais il s’agit d’une réalité qui nous touche tous : le Créateur, qui lui-même vit une forme de communauté dans l’intimité de la Trinité, a créé toute l’humanité pour être avec et pour d’autres personnes. Il n’est pas bon d’être seul, car nous ne sommes pas faits pour cela. Nous sommes sortis du ventre de notre mère en hurlant pour que quelqu’un nous prenne près de lui.
Mais à mesure que nous vieillissons et que nous devenons plus autonomes, occupés par les défis de la vie, nous apprenons à vivre de manière indépendante, comme certains s’accommodent d’une cheville cassée. Et nous continuons à boiter, relationnellement handicapés, jusqu’à ce que nous fassions face à une colline escarpée et que nous réalisions que nous avons besoin d’aide.
Des forces à l’œuvre dans la société, écrit le journaliste Derek Thompson dans The Atlantic, ont créé un écosystème social dans lequel nous sommes « à la fois poussés et attirés vers un niveau de solitude pour lequel nous ne sommes ni faits ni émotionnellement préparés ». Beaucoup de gens passent moins d’heures à socialiser en face-à-face qu’auparavant.
L’augmentation de la solitude semble être corrélée avec la détérioration de l’état de santé : le désespoir, la dépression et les pensées suicidaires chez les adolescents ont augmenté presque chaque année au cours des dix dernières années. L’espérance de vie aux États-Unis, après avoir progressé pendant des décennies, est tombée à son niveau le plus bas depuis 1996, en partie à cause des overdoses de drogues et des suicides.
L’année dernière, l’administrateur de la santé publique des États-Unis, Vivek Murthy, rapportait que la moitié des adultes américains déclaraient souffrir d’une grande solitude avant même la pandémie, une « épidémie de solitude et d’isolement » qui pourrait être aussi mortelle que le fait de fumer tous les jours.
Nous connaissons la solution à cette crise de l’isolement : nous avons besoin les uns des autres. Nous savons également que nous avons besoin d’une certaine infrastructure sociale pour établir et maintenir des rythmes réguliers de contacts humains de personne à personne. Cette infrastructure s’est réduite. Après avoir quitté l’Église et rejoint les non-affiliés, le chroniqueur du Washington Post Perry Bacon Jr écrit qu’il s’est senti « dans un trou à la forme d’une église ». « Notre société a besoin de lieux qui rassemblent les gens par-delà les divisions ethniques et de classe. »
C’est drôle. J’appartiens à une église. Et j’ai moi aussi l’impression de connaître un trou en forme d’église.
En juillet dernier, j’ai publié un message sur les réseaux sociaux à la recherche d’exemples « d’amitiés chrétiennes, belles, durables et profondes ».
J’aurais dû écrire « communautés » au lieu de « amitiés ». Plusieurs personnes ont répondu en décrivant des amitiés entretenues depuis des années. Mais ces amitiés étaient essentiellement vécues à distance, perpétuées via FaceTime et des messages vocaux.
J’ai des amis. J’ai été demoiselle d’honneur dans de nombreux mariages. Mais ce sont des amitiés qui datent de mon adolescence et de ma vingtaine. Nous sommes maintenant dispersés, à travers le pays, les océans et les étapes de la vie. Ce sont mes amis, mais ce n’est pas ma communauté. L’échange d’images amusantes ou de petits messages tout au long de la semaine ne me fournit que des étincelles de lien.
Des auteurs tels que la psychologue Susan Pinker ont documenté que les interactions numériques ne peuvent pas remplacer la présence physique — la valeur d’une étreinte, d’une main tenue, de l’odeur du même café chaud, du simple fait d’être assis tranquillement côte à côte. La communauté se distingue de ces amitiés par son caractère continu. Au lieu d’une constante solitude seulement interrompue par de brèves interactions, la communauté est une question de vivre ensemble, où les moments de solitude ne font qu’interrompre des interactions permanentes.
Mais nous sommes tous très occupés. Il faut des semaines pour programmer un rendez-vous. Et si vous avez des enfants, les plans sont souvent annulés à la dernière minute, comme lorsque mon amie a reporté notre rendez-vous pour la troisième parce que son enfant était encore tombé malade. C’était il y a presque un an, et nous n’avons toujours pas réussi à le faire. Nous avons une bonne excuse : bien que nous vivions toutes deux à Los Angeles, une heure de circulation nous sépare. Mais je n’ai pas de raison valable pour expliquer pourquoi il faut des mois pour organiser un dîner avec des voisins qui vivent dans mon quartier. Est-il possible que nous soyons vraiment si occupés ?
Lorsque j’étais enfant en Corée du Sud, ma famille faisait partie d’une petite église presbytérienne très unie. Nous vivions dans une ruelle où les voisins entraient et sortaient librement de leurs maisons respectives, partageant leur traditionnel kimchi fait maison.
Lorsque nous avons déménagé à Singapour après que mon père soit devenu missionnaire, nous avons vécu dans le foyer d’un collège biblique, partageant la cuisine et le salon avec des missionnaires du Myanmar et de Thaïlande.
Quand nous avons immigré aux États-Unis, nous nous sommes rapidement plongés dans l’église chinoise que mon père avait implantée, passant au moins 15 heures par semaine avec ces frères et sœurs en Christ. À l’université, je faisais partie d’une petite église dans le quartier coréen de Los Angeles, où je passais mes week-ends à organiser des soirées pyjama et des barbecues.
Mais j’étais jeune à l’époque, dans une culture et un lieu différents. Je n’avais pas besoin de chercher la communauté. Elle était juste là. Aujourd’hui, j’ai une trentaine d’années, je suis mariée, mère de famille et je vis dans l’une des villes les plus changeantes du monde. Où se trouve ma communauté dans cette saison ?
Une réponse à ma question sur les réseaux sociaux a attiré mon intérêt. Dans un courriel, Brian Daskam, de Denton, au Texas m’expliquait que sa communauté « ressemble souvent aux séries avec lesquelles nous avons grandi : Sauvés par le gong, Dawson’s Creek, Friends. Chaque événement auquel nous assistons rassemble curieusement les mêmes personnages, la même poignée d’amis. »
Pendant des décennies, depuis le temps de leurs études et leur mariage, les Daskam et leurs amis ont organisé à tour de rôle des clubs de lecture le dimanche soir. Ils discutaient de Rousseau, de Locke et de Nietzsche. Ils ont continué à se rencontrer après l’arrivée des premiers bébés. L’espace était plein à craquer, encombré de chaises de bébé et de matelas à langer. Ils ont bercé ensemble leurs nouveau-nés et discutaient de ce qu’ils avaient à cœur, qu’il s’agisse de la suspension téléologique de l’éthique ou de l’apprentissage du sommeil.
Telle était la communauté que Brian et sa femme, Keri, ont cultivée pendant 20 ans. C’est dans ce village qu’ils ont élevé leurs enfants, qui sont aujourd’hui les meilleurs amis des enfants de leurs meilleurs amis.
Aujourd’hui, Brian a 45 ans et Keri 44. Avec trois enfants âgés de 16, 14 et 8 ans, ils sont plus avancés que moi dans la vie. Mais ils semblaient expérimenter exactement ce que j’attendais d’une communauté.

Lorsque j’ai rendu visite aux Daskam en septembre 2023, la première chose que j’ai remarquée à Denton, c’est que les gens conduisaient tranquillement, sans la rage et la frénésie que je connais à Los Angeles. Denton est une ville d’environ 148 000 habitants, située juste au nord de la zone métropolitaine de Dallas-Fort Worth. Il y règne une ambiance de ville universitaire. En la comparant au comté de Los Angeles, avec ses 10 millions d’habitants et ses 88 villes, j’ai commencé à douter : pourrais-je apprendre chez eux quelque chose qui soit applicable chez moi ?
Un vendredi soir, j’ai retrouvé Brian à la piscine de Denton, où son aînée, Cate, participait à un match de water-polo. Toute sa famille était présente, ainsi que plusieurs de ses amis dont les filles font également partie de l’équipe.
Je me suis assise sur un banc entre Keri et sa meilleure amie, Jeannie Naylor. Elles s’étaient rencontrées en tant que colocataires à l’université de North Texas à Denton et sont restées inséparables depuis lors.
« Je m’excuse d’avance, mais je vais être très bruyante », nous a dit Jeannie. Elle criait et applaudissait à tout rompre. À ma droite, les applaudissements de Keri étaient plus retenus. « Keri est trop gentille », taquinait Jeannie. Les deux sont très différentes : Jeannie est exubérante et grégaire. Keri est réservée et introvertie. Et elles ne peuvent imaginer la vie l’une sans l’autre.
Il y a quelques années, les deux familles ont été brièvement séparées par quelques 3000 kilomètres. En 2018, les Daskam ont déménagé à Olympia, dans l’État de Washington, après que Brian ait accepté un nouvel emploi en tant que responsable de communication. Brian et Keri étaient tristes de quitter leur communauté, mais confiants dans leur capacité à en bâtir une nouvelle.
« Nous avions déjà appris à créer une communauté », se souvient Brian. « Nous pensions reproduire le modèle dans l’État de Washington. Nous serions des missionnaires de la communauté ! »
Pour Brian, qui, au lycée, avait décoré son casier de posters de montagnes et de lacs, vivre dans cette région des États-Unis était un rêve. Ils ont acheté une cabane en rondins installée sur près d’un hectare de nature sauvage, au milieu des baies, des cerfs, des aigles et, à l’occasion, des pumas. Le week-end, ils randonnaient dans des forêts de conifères, récoltaient des huîtres sur la plage et faisaient du kayak parmi les phoques des baies du Pacifique.
Il ne manquait qu’une chose : la communauté.
Les Daskam ont essayé d’organiser un club de lecture. Ils ont préparé un festin et ont attendu. Personne n’est venu. « C’était comme si on nous laissait tomber juste avant une danse », se souvient Keri. Ils n’arrêtaient pas d’inviter des gens. Certains ont refusé. D’autres ont annulé à la dernière minute ou se sont présentés une fois puis ont disparu. Certaines semaines, la seule interaction sociale des Daskam consistait à sourire aux gens à l’église.
Il s’est avéré que la création d’une communauté était un réel défi pour des trentenaires transplantés dans un autre État. « Nous étions naïfs », estime Keri. « Nous avons essayé de toutes nos forces, mais cela n’a pas fonctionné. Je ne sais toujours pas pourquoi nous n’avons pas réussi à obtenir cette alchimie magique que nous connaissons ici [à Denton]. »
C’est alors que le COVID-19 a frappé. Finalement, Keri a demandé à Brian : « Est-ce qu’on pourrait revenir en arrière ? Est-ce que tu peux me sortir d’ici ? »
Il a fallu faire des sacrifices importants pour revenir. Brian a quitté son emploi et envoyé une douzaine de CV par jour pour des postes qui lui permettraient de travailler à Denton. Ils ont vendu leur belle cabane et se sont mis en quête d’une nouvelle maison.
En juin 2022, quatre ans après leur départ, ils ont tout remballé et sont rentrés chez eux. Lorsqu’ils sont revenus, c’était comme si leurs amis leur avaient gardé leur place. Comme s’ils n’étaient jamais partis.
Nous nous retrouvions donc dans cette piscine, une soirée de plus à traîner ensemble. Après le match, j’ai continué à bavarder avec Jeannie pendant que Keri distribuait des cookies faits maison. Le soleil était couché, mais les suites d’un après-midi d’automne à 35 degrés se faisaient encore bien ressentir. Je comprenais pourquoi Brian s’était réfugié dans les montagnes.
« Je ne sais pas pourquoi je vis ici », a observé Jeannie. Mais elle ne peut pas partir, car, comme les Daskam, elle reste attachée à sa communauté. « Ce dont nous aurions besoin », s’est-elle exclamée, « c’est de déménager tous ensemble. »
Mais je me suis demandé si ce groupe serait en mesure de maintenir la profondeur et la fréquence de ses interactions dans une autre ville. Denton n’est pas seulement une toile de fond. Cette ville fait partie de leur communauté. Le fait qu’ils aient vécu leurs années de formation ici, passant ensemble d’étudiants à jeunes mariés, puis à jeunes parents, est important. Ils vivent toujours à neuf minutes en voiture les uns des autres et leurs enfants fréquentent les mêmes écoles. Cela change les choses. Ce qui compte, c’est qu’ils croisent souvent les mêmes visages dans les cafés et les épiceries, qu’ils se plaignent et souffrent ensemble des mêmes étés torrides.
J’ai vécu dans 12 maisons différentes, dans trois pays, et je rêve toujours de déménager. Pas une seule fois je n’ai pris en compte la communauté. J’ai supposé que je trouverais les miens où que j’aille — et non pas que j’irais là où se trouveraient les miens.
Le samedi soir, je suis arrivée chez Kevin et Emily Roden, des amis de longue date des Daskam. Brian avait encouragé les membres de son entourage à lire le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare et avait invité Matthew Lee Anderson, professeur à l’université Baylor, à animer une discussion sur la pièce et sur la manière dont les gens transfigurent leurs désirs et leurs aspirations.
Il y avait de l’eau gazeuse, des carafes à l’ancienne, des boules de mozzarella et des bretzels. J’ai salué le pasteur des Daskam, un veuf au visage sympathique, et j’ai serré la main de plusieurs habitués de leurs repas dominicaux. Ensuite, nous nous sommes tous assis — plus de 30 personnes au total — pour débattre et rire de ce que peut être notre vie en tant qu’êtres humains.
« C’est bizarre, ce que vous faites », s’est amusé le professeur. « Passer le samedi soir à penser à ces choses. »
Mais j’ai senti que cette soirée n’était pas simplement un événement unique ; il y avait là le fruit d’une institution que les Daskam avaient affinée pendant deux décennies. Ces repas du dimanche soir, où l’on débutait la semaine en partageant le pain avec les siens, constituaient une puissante liturgie. Ils forgeaient en leurs participants des identités qui n’étaient pas celles d’individus ou de familles nucléaires, mais de parties d’un collectif de croyants qui réfléchissent et échangent intentionnellement et en profondeur. Leurs conversations façonnaient leurs pensées, leurs valeurs et leurs intérêts.
J’ai encore pu échanger avec l’animatrice, Emily Roden, une petite femme aux cheveux auburn bouclés coupés à hauteur du menton. Les Roden et les Daskam s’étaient rencontrés à l’université, alors qu’ils vivaient dans le même complexe de maisons victoriennes. Aujourd’hui, leur fille aînée, Rosie, est la meilleure amie de Cate. Avant de déménager à Washington, les Daskam ont passé leurs deux dernières nuits à Denton chez les Roden. C’était comme une grande soirée pyjama.
« Et ils sont partis », se souvient Emily. « Sauf que cette fois-ci, ils n’allaient pas à deux minutes d’ici, mais à plusieurs États de distance. » Elle secoue la tête. « Je pourrais presque pleurer rien qu’en y repensant. » Elle se souvient s’être sentie perdue. « L’une des principales raisons de notre présence à Denton a disparu », a-t-elle dit à son mari à l’époque.
L’absence des Daskam a laissé un vide dans leur communauté. Cela a changé la dynamique. Qui pourrait remplacer la curiosité et le côté intello de Brian ou la douce sagesse et les talents de cuisinière de Keri ? « Ce genre d’amitié n’arrive qu’une fois dans une vie », me dit Emily.
Et pour certains, jamais.
J’ai ressenti une douleur. Si David et moi déménagions, quelqu’un dirait-il que notre départ a laissé un vide dans son monde ?
Je me suis également sentie étrangement gênée. Lorsque je disais aux gens pourquoi je visitais Denton, ils me regardaient presque avec compassion. « Oh, je suis vraiment désolé. »
Je ne m’étais jamais sentie gênée jusqu’à ce moment-là. Tout le monde n’a-t-il pas eu du mal à trouver une communauté ? Pas eux, semble-t-il. Ils plaisantaient sur leur désir de fuir Denton, mais dans une résignation satisfaite. Que ferions-nous d’autre ? Nous sommes chez nous.
« Ce que tu es en train de me dire », demandai-je plus tard à Brian, « c’est que je devrais retourner à l’université, y retrouver mes meilleures amies, acheter des maisons dans le même quartier, avoir des bébés en même temps et passer 20 ans ensemble pour avoir la même communauté que toi. »
Il a ri. Il voit bien qu’une grande partie de ce qu’il a est simplement une grâce de Dieu : « Nous savons que c’est injuste, que certaines de ces choses ne sont pas à la portée de tout le monde. »
Peut-être pas. Les Daskam avaient essayé dans l’État Washington, et en étaient revenus. Mais ce que j’ai vu à Denton, c’est le fruit de 20 ans de rencontres organisées et de nombreux échanges spontanés. Le groupe s’est réuni fréquemment, que ce soit de manière cohérente et intentionnelle, ou aléatoire et spontanée. Ses muscles sociaux, constamment étirés et entraînés, étaient à la fois souples et forts.
Je suis retournée à Los Angeles avec un trou dans le cœur. Le sentiment n’était pas insoutenable, mais j’avais vu de mes propres yeux ce à quoi j’aspirais ardemment pour moi et ma famille. Je me sentais aussi réconfortée par les luttes des Daskam à Washington. Je n’étais pas seule ; il est réellement difficile de créer une communauté.
Mais comment en est-on arrivé là ?
David et moi nous sommes mariés le 10 avril 2020, en plein âge d’or des règles de distanciation sociale. Un mois plus tôt, la pandémie avait arrêté le monde. Les écoles et les églises étaient fermées. Les salles de sport et les cinémas avaient fermé leurs portes. Même les terrains de jeux et les plages étaient fermés par des rubans adhésifs.
Nous nous sommes mariés dans le jardin de David en présence de Dieu, de notre pasteur et d’une caméra à travers laquelle nos amis et notre famille ont été témoins de nos vœux. Notre « réception » s’est déroulée sur Zoom, et David et moi avons dîné de sushis apportés par un livreur. Sur l’écran de notre iMac, ma belle-mère avait l’air malheureuse ; mon beau-père pleurait, mais pas de joie.
Je n’y ai pas trop prêté attention. Nous avions économisé des milliers de dollars. Personne ne pouvait dire que mon maquillage était hideux ou que je portais des baskets sous ma robe. D’ailleurs, un mariage n’est-il pas simplement une question d’amour et d’engagement entre un mari et sa femme ? Qu’est-ce que cela faisait, alors, si lorsque la fenêtre Zoom s’est refermée, nous étions soudain seuls dans notre maison pour le reste de la journée, pour le reste de la semaine et pour les mois suivants ? Un mariage, c’est juste l’union de deux personnes, non ?
C’est ainsi que notre nouvelle vie a commencé. Notre église ne s’est pas réunie en personne pendant plus d’un an. J’ai pris l’habitude de suivre le sermon en direct tout en faisant mousser le lait pour mon café. Nous avons cessé de participer aux « dîners » de quartier bihebdomadaires sur Zoom. Ces rencontres virtuelles nous semblaient bizarres et inutiles.
David se plaignait de se sentir isolé ; moi, je me sentais libérée, à l’abri des petits drames de mon entourage, des fêtes d’anniversaire ou des baby showers. Mes projets s’articulaient autour de mes intérêts et de mon confort.
Puis lentement, progressivement, le monde extérieur est revenu. Notre église s’est à nouveau réunie physiquement pour les cultes. Nous avons retrouvé des amis au restaurant. Mais à ce moment-là, j’avais pris l’habitude de vivre en autarcie avec moi-même. Faire une heure de route pour rencontrer un ami me semblait soudain inutile et épuisant. Fallait-il faire tous ces efforts alors qu’il suffisait d’envoyer un SMS ou d’appeler ?
Le samedi matin 18 septembre 2021, mon mari a reçu un appel de son père. J’étais encore au lit, mais j’entendais les sanglots bruyants et rauques de mon beau-père à travers le téléphone.
Alors que mes beaux-parents faisaient leur promenade quotidienne habituelle, un voisin au volant de son pick-up avait traversé à toute allure un carrefour très fréquenté et heurté ma belle-mère.
Lorsque David et moi avons pris l’avion pour Bismarck, dans le Dakota du Nord, les médecins l’avaient déclarée morte. Mon beau-père nous a accueillis dans la maison d’enfance de David, les yeux rougis et les joues gonflées, l’air frêle et dévasté dans sa sombre maison de quatre chambres.
Nous sommes restés trois semaines à Bismarck. Des proches sont venus de tout le pays. Amis et voisins ont sonné à la porte et déposé des plateaux de biscuits, de la soupe et des croquettes de pommes de terre. Nos téléphones portables ont vibré toute la journée au rythme des messages d’amis et de collègues : « On prie pour vous » « Dites-nous si vous avez besoin de quelque chose. » « Nous sommes sans voix. »
Lorsque nous sommes rentrés à la maison, mon mari n’était plus le même. Il ressentait des besoins qu’il ne parvenait pas à nommer. Je ne savais pas comment être la femme dont il avait besoin, et ses amis ne savaient pas comment être les amis dont il avait besoin.
Notre église nous a demandé si nous voulions recevoir des repas. Nous avons refusé. Nous vivions loin de la plupart des membres de la communauté et, de plus, je déteste les plats cuisinés.
Je me rends compte aujourd’hui que refuser cette offre était une grave erreur. Les gens voulaient une raison de venir frapper à notre porte, de s’inviter, et je leur avais barré la route. Au fil du temps, les gens ont donc oublié. Ils avaient leurs propres problèmes. Certains ont envoyé des SMS pour demander comment allait David, mais ils n’ont pas su comment réagir lorsqu’il leur a dit qu’il était toujours en deuil.
Cinq mois après la tragédie, j’ai appris que j’étais enceinte de six mois.
Lorsque j’ai donné naissance à notre fils, nous l’avons appelé Tov pour nous rappeler que Dieu est tov – « bon » en hébreu. Dieu a créé le monde et l’a déclaré tov. Il a également déclaré : Lo-tov heyoth ha’adam levaddo. « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. »
C’est grâce à Tov que j’ai réalisé que j’étais seule. Lorsqu’il est né, j’ai à nouveau décliné les offres de repas de notre église ; je voulais juste qu’on me laisse tranquille. Le post-partum et la maternité ont bouleversé mon univers. J’avais perdu ma liberté sur mon corps, mon temps et mon attention. J’étais dégoûtée par tout ce qui s’écoulait de mon corps, dégonflé mais encore boursouflé. Du jour au lendemain, j’étais devenue responsable d’un être humain sans défense. Je ne voulais voir personne ni être vue.
Neuf mois se sont écoulés jusqu’à ce qu’un dimanche, à l’église, j’émerge de la garderie et, sortant la tête du brouillard de la maternité, je ne voie que des visages inconnus.
Au cours de ces neuf mois et des va-et-vient que connaît Los Angeles, notre communauté d’environ 100 personnes s’était transformée. Je ne l’avais pas remarqué. Mais mon manque d’attention n’était pas uniquement dû à la maternité. Il découlait aussi de mois de concentration sur ce qui me paraissait simplement plus commode et confortable pour moi.
Il y avait aussi d’autres obstacles à ce vécu communautaire. L’arrivée d’un bébé a diminué notre flexibilité. Nous ne pouvions pas participer à certains repas de quartier ou soirées de prière incompatibles avec l’heure du coucher. Nous avons investi dans les relations avec une autre famille, en espérant que nos fils deviendraient les meilleurs amis du monde, puis la famille a déménagé à 350 km de Los Angeles. Je faisais partie d’un groupe de discipulat, mais en raison de conflits entre nos agendas, nous nous réunissions une fois toutes les six semaines. « On devrait se voir un jour » est devenu un mensonge si courant que nous le disons avec autant de désinvolture qu’une simple salutation.
Oui, nous étions occupés. Mais être « trop occupé » pour ceux qui nous entourent, c’est tout simplement donner la priorité à d’autres choses que la communauté. À quoi ressemblerait notre vie aujourd’hui si nous avions fait d’autres choix, comme celui d’accepter ces repas que nous proposait l’église ?
Après avoir visité Denton, j’ai effectué plusieurs changements.
Tout d’abord, j’ai appelé quelques amis proches et j’ai pris des rendez-vous mensuels pour passer du temps ensemble. Si nous n’avions pas un programme structuré, je savais que nous ne nous rencontrerions qu’une ou deux fois par an.
Ensuite, David et moi avons dressé une liste de nos valeurs familiales. En haut de la page : le dimanche est sacré. Plus question que notre heure passée à l’église soit simplement suivie de quelques courses avant de nous poser devant la télé. Le dimanche sera consacré à notre famille dans la foi, même si cela implique d’exclure certaines activités extrascolaires pour Tov.
Troisièmement, nous avons décidé de trouver une église plus proche de chez nous. Nous ne pouvions pas nous imaginer former une communauté cohérente dans une église lointaine avec des rythmes de communion auxquels notre famille ne pouvait pas participer. L’adage le dit bien : loin des yeux, loin du cœur.
Dans notre nouvelle église dans le voisinage, nous avons trouvé un petit groupe qui se réunissait le dimanche après-midi. Lors de notre première visite, d’autres enfants plus âgés ont joué à l’extérieur pendant que Tov restait avec nous. Il sautait dans tous les sens, comme un lapin sous l’emprise d’une boisson énergisante, éparpillant des miettes partout. Nous nous sentions très mal, mais personne n’a semblé gêné. Une étudiante s’est mise à genoux et l’a distrait avec de petits tours de passe-passe.
Cette première rencontre avait quelque chose de gênant. Il est toujours difficile de s’introduire dans un groupe qui a déjà formé sa propre culture et sa propre dynamique. Tout le monde était amical, mais nous n’avons pas immédiatement sympathisé avec qui que ce soit. Nous étions juste… tellement différents.
Lors de la réunion suivante, nous nous sommes retrouvés chez quelqu’un d’autre. La première chose que j’ai vue, c’est une grande pancarte de campagne devant la maison à l’appui d’un candidat que je ne soutiendrais jamais. J’ai gémi. Je savais que la position politique d’une personne ne devrait pas avoir d’importance au sein du corps du Christ, mais ce panneau me laissait une certaine impression.
À quoi m’attendais-je ? À ce que nous tombions directement sur de nouveaux amis avec lesquels nous commencerions à aller faire les courses ensemble et à nous répandre en confidences autour d’un feu de bois ? La première communauté que Jésus a bâtie était celle de ses 12 disciples, des hommes aux opinions politiques, aux personnalités et aux milieux sociaux très divers, dont les chamailleries sont bien attestées dans les Évangiles (Lc 9.46). Pourquoi pensais-je que ma communauté devrait partager mes intérêts, mon humour et mes opinions politiques ?
Je me débattais encore avec ces pensées lorsque j’ai mis la main sur un livre intitulé When the Church Was a Family: Recapturing Jesus’ Vision for Authentic Christian Community, de Joseph H. Hellerman. J’avais lu de nombreux ouvrages sur l’amitié et la communauté, mais c’était le premier que je trouvais à mettre directement cette question en lien avec l’Église.
« En tant qu’Américains chrétiens pratiquants, nous avons été formés pour croire que notre épanouissement individuel et notre relation personnelle avec Dieu sont plus importants que tout lien que nous pourrions avoir avec nos semblables, que ce soit à la maison ou à l’église », écrit Hellerman. « De manière très subtile et insidieuse, cette idée nous a conditionnés. »
Les chrétiens contemporains placent souvent les besoins de la famille au-dessus de ceux de la communauté, et considèrent même cela comme biblique. Mais Hellerman affirme que ce n’est pas ce qu’enseignent les Écritures et l’Église primitive.
« En présentant l’Église comme une famille, le Nouveau Testament va à l’encontre de notre orientation culturelle individualiste », écrit-il. La vision qu’a Dieu de l’Église comme notre première famille « offre un puissant antidote » aux maux de notre société.
J’étais encore en train de lire l’introduction du livre lorsque j’ai réalisé que Joseph Hellerman se trouvait être le « Pasteur Joe » qui prêchait à l’église que David et moi fréquentions depuis quelques semaines.
Je lui ai envoyé un courriel. Il habite en fait à cinq minutes de chez moi. Nous nous sommes retrouvés dans son café préféré. Il avait grandi dans le quartier et élevé deux filles dans la maison à deux chambres de son enfance. Alors que nous échangions sous la chaleur du soleil californien, des voisins s’arrêtaient pour nous saluer.
À 71 ans, Joseph Hellerman, dégage quelque chose d’estival. Il exerce son ministère depuis plus de quarante ans, utilisant son église comme une sorte de « laboratoire », comme il le dit, pour tester ses convictions sur la communauté. Il prêche régulièrement contre l’individualisme occidental et tente de donner l’exemple dans sa propre vie. « Cela n’a pas été facile », me dit-il.
Il est fier de son église. Mais sur environ 400 membres, il estime qu’une centaine de personnes vivent véritablement l’église comme une famille. « Nous avons travaillé, travaillé, travaillé, et c’est le mieux que nous puissions faire. »
La pandémie a été la période la plus conflictuelle de son expérience dans le ministère. Il a été horrifié et déçu de voir les membres de l’église se chamailler et s’attaquer les uns les autres sur les réseaux sociaux au sujet des vaccins et des masques. Certains s’en sont allés en raison de leurs divergences.
L’orthodoxie n’était pas le problème, dit Hellerman : « J’ai vu trop de bonne théologie associée à un mauvais relationnel au fil des ans. » Nous savons intellectuellement ce que nous devons faire, ce à quoi nous aspirons, explique-t-il. Mais nous ne savons pas comment mettre cela en pratique, ou nous ne voulons pas le faire. Il y a trop de forces contraires :
« Quand je regarde ma propre vie, mes propres réticences en matière de communauté, je vois que ma femme et moi ne comprenons pas le concept de communauté comme nous le devrions. Cela nous attire et nous effraie à la fois. C’est notre maison. Notre argent. Notre vie. »
Je ne crois pas avoir été dépitée par le fait que Hellerman, qui a consacré un livre entier à ce sujet, ait encore du mal à mettre les choses en pratique. Au contraire, je me suis sentie encouragée : 100 des 400 membres de son église parvenaient tout de même à vivre en communauté. Et le pasteur était plein d’empathie pour ceux qui n’y arrivaient pas, parce qu’il nage contre les mêmes courants.
La semaine où nous nous sommes vus, Hellerman travaillait à un sermon sur le rôle du Saint-Esprit dans la communauté. Il peut prêcher autant qu’il veut, m’a-t-il dit, mais en fin de compte, « si c’est la vérité, alors quand elle est partagée, c’est le Saint-Esprit qui la confirmera pour les gens. »
Je suppose que c’est ce qui s’est passé en moi : l’Esprit a confirmé ce que je savais et désirais depuis toujours. « David et moi ne voulons plus passer d’une église à l’autre », ai-je dit à Hellerman. « Nous voulons planter nos racines ici. Je veux que mon fils grandisse dans une église où il peut trouver des oncles et des tantes de substitution. Je veux qu’il soit élevé non seulement par David et moi, mais aussi par la communauté ecclésiale. Je veux qu’il aime l’église comme une famille. »
C’était la première fois que je l’exprimais à haute voix, mais c’est une prière qui a progressivement mûri dans mon cœur. Tout avait commencé par une aspiration centrée sur mes besoins et ceux de ma famille : avoir une communauté.
Au fil du temps, le Saint-Esprit m’a éclairée et corrigée, révélant mon égoïsme et mon entêtement, approfondissant et élargissant mes prières vers quelque chose de plus proche du cœur de Dieu, quelque chose qui, je l’espère, reflète les prières nocturnes de Jésus avant de choisir les disciples qui bâtiraient son Église (Lc 6.12).
Et si c’est ce que Dieu veut pour nous, notre chemin est simple : suivre et recevoir. Suivre, même si cela signifie que nous renonçons à certains projets, que nos habitudes sont chamboulées et que nous sacrifions du temps et des ressources. Recevoir, parce que la communauté est un don de Dieu, même si les personnes qui m’entourent ne se conforment pas à mes préférences. Même si elles me blessent, m’ennuient ou me gênent parfois.
Cela semble si simple. Pourtant, c’est tellement, tellement difficile. Parfois, je me dis que cela va aller. D’autres fois, je me sens démunie : Y arriverons-nous vraiment ?
L’année dernière, quelques jours avant Noël, j’ai appris que nous allions avoir un autre bébé. Notre vie va devenir encore plus chaotique, encore plus occupée. Et selon ce que nous choisirons, nous risquons d’être encore plus isolés.
Mais nous devons le faire. C’est parti pour le deuxième tour. Et cette fois, j’accepterai les repas proposés. Merci.
Sophia Lee est reporter internationale pour CT.