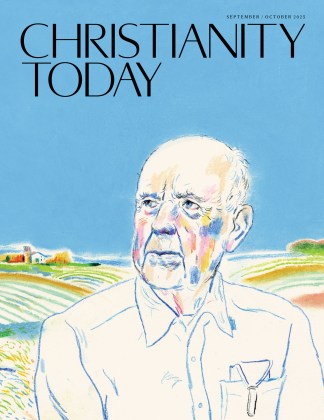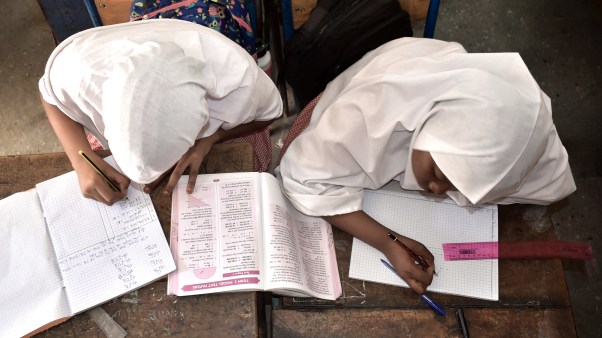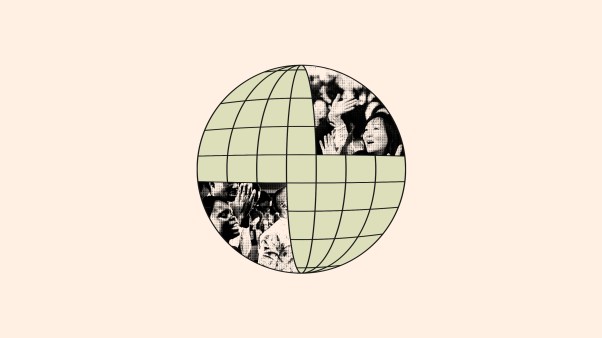J’ai grandi sur la côte de Kupang, en Indonésie, où je passais la plupart de mon temps libre au bord de la mer. Outre la natation et la pêche, j’adorais jouer au football sur la plage, ce qui n’était possible qu’à marée basse. En plaisantant, mes amis et moi demandions souvent aux flots de se retirer plus tôt ou de revenir plus tard pour que nous puissions jouer plus longtemps. Évidemment, la mer ignorait nos demandes. Ces expériences m’ont appris qu’elle était aussi imprévisible que redoutable.
Dans la Bible aussi, la mer est évoquée de cette façon. Les Psaumes décrivent les eaux écumeuses (46.3), les vagues mugissantes (65.7) et la mer déchaînée (89.9) comme des situations qui nécessitent de toute urgence l’intervention de Dieu. Comme quand le prophète Jonas, en fuite, est jeté d’un bateau pour calmer la mer déchaînée (Jon 1.15). Ou comme quand, dans les Évangiles, Jésus sauve ses disciples d’une terrible tempête (Mc 4.35-41).
Nous avons tendance à lire des passages bibliques comme ceux-ci en prêtant à la mer un caractère dangereux et menaçant. Selon Kenneth W. Lovett, spécialiste de l’Ancien Testament, cette compréhension est notamment fondée sur d’anciens mythes du Proche-Orient où la mer est symbole de chaos et de destruction.
Dans l’antique poème mésopotamien L’épopée de Gilgamesh, la mer joue, par exemple, le rôle d’un ennemi. Une inondation y est décrite comme « une armée au combat ». Dans le mythe babylonien de la création Enuma Elish, le personnage de Tiamat, qui personnifie la mer primordiale, symbolise un chaos monstrueux.
La façon dont la Bible elle-même décrit la mer contribue également à ces interprétations négatives. Dieu utilise souvent la mer comme un « outil de jugement contre le péché », explique Lovett, et, dans la vision de Daniel, Satan et d’autres bêtes malfaisantes émergent des eaux.
Ce qui échappe cependant à Lovett et à d’autres théologiens est que, dans les Écritures, la mer évoque surtout l’incapacité de l’humanité à la contrôler et à la maîtriser. Une interprétation plus large et complète de ce qu’elle représente pourrait bien avoir quelque chose à nous dire de l’incontrôlabilité de Dieu, de sa puissance, de sa majesté et de sa sainteté.
En ne considérant la mer que comme chaos et destruction, nous adoptons une perspective anthropocentrique, dans laquelle nous interprétons le monde en fonction de nos valeurs et expériences humaines. C’est ce que j’appelle l’anthropocentrisme bleu, reflet de nos aspirations illusoires à dominer sur la mer.
En tant qu’êtres humains limités, nous ne pouvons pas maîtriser les eaux. Nous ne contrôlons pas comment les courants se déplacent, comment les créatures marines se nourrissent de ce qui pousse dans la mer et comment celle-ci réagit à d’autres phénomènes naturels, tels que les tremblements de terre et les éruptions volcaniques.
Pourtant, nous pensons à tort que la mer est un objet au service de nos intérêts. Nous la percevons comme une source d’abondants profits économiques et un moyen d’assouvir notre avidité. Nous voyons toujours en elle un moyen de conquête, comme le firent l’Empire romain et les colonisateurs européens.
À travers l’Écriture, Dieu met en évidence ce désir égoïste de dominer la mer et tout ce qui s’y trouve.
Alors qu’il interroge Job, Dieu pointe une créature marine mythique, le Léviathan. « Peux-tu tirer le Léviathan avec un hameçon ou attacher sa langue avec une corde ? », lui demande-t-il (Job 40.25). Pour la théologienne Catherine Keller, autrice d’un chapitre de l’ouvrage Christianity and Ecology,le Léviathan symbolise la résistance absolue à l’arrogance, au pouvoir et à la cupidité de l’homme, en particulier dans ses efforts pour domestiquer et commercialiser la nature.
Dieu poursuit à propos de ce monstre marin : « Tout espoir de le vaincre est trompeur. A son seul aspect n’est-on pas terrassé? » (41.1). Dans ses propos, c’est la vulnérabilité de l’humanité que le Créateur dévoile. Nous sommes des créatures limitées, au même titre que le reste de la création.
Mais notre finitude, indéniable, n’est pas une chose à regretter ou à déplorer. Au contraire, nous devrions en être reconnaissants, car les limites humaines révélées par le Léviathan nous invitent à reconnaître et à accepter notre condition de créature. Le Léviathan nous délivre d’une vision de la mer qui ferait de l’homme le centre de son existence. Nous ne sommes, en effet, pas plus puissants que ses créatures.
Un autre récit où l’Écriture nous rappelle nos fragilités est un épisode de la vie de Jésus avec ses disciples. Alors qu’ils naviguent sur la mer de Galilée, un « vent violent » (Mc 4.37) s’élève. De puissantes vagues s’abattent sur le bateau et manquent de le submerger. Pendant tout ce temps, Jésus dort. Lorsque ses disciples effrayés lui demandent pourquoi il ne se soucie pas qu’ils se noient, Jésus leur répond : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? » (v 40)
Jésus ne se moque pas ici de ses disciples et de leur peur face à la mer. Il sait parfaitement qu’ils sont incapables d’en contrôler les flots. En réalité, sa question reflète plutôt sa divinité. Lui seul peut calmer les eaux. La question de Jésus présuppose déjà son pouvoir sur toute la création, y compris sur ce des éléments aussi impétueux que la mer.
L’incapacité des disciples à maîtriser les vagues rugissantes qui les entourent n’est pas une faiblesse ou un échec. Ce à quoi Jésus les appelle, c’est à accepter leurs limites humaines et à lui faire entièrement confiance.
Et quand les disciples assistent à ce que fait Jésus quand il calme la mer, ils s’émerveillent : « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent ! » (v. 41) L’Écriture nous invite à voir comment la nature bouillonnante et imprévisible de la mer témoigne d’un Dieu lui aussi indomptable et incontrôlable, un Dieu bien plus saint et puissant que nous ne pourrons jamais l’imaginer. Un Dieu insaisissable, comme l’exprime le psalmiste : « Tu as fait ton chemin dans la mer, ton sentier au fond de l’eau, et personne n’a reconnu tes traces. » (Ps 77.20)
La mer est sacramentelle dans le sens où elle nous parle d’un Dieu qui échappe à notre contrôle et à nos prévisions, affirme le prêtre anglican Edmund Newell. « Les différentes humeurs de la mer résonnent avec nos expériences de paix et d’agitation, de joie et de tristesse, de vie et de mort », écrit-il dans son livre The Sacramental Sea. « Éternelle, insondable, insaisissable, puissante, mystérieuse, d’apparence infinie, vivifiante et pourtant redoutable : dans son essence même, la mer parle de Dieu. »
La mer est un lieu de danger et de peur, mais aussi de fascination et d’émerveillement. Ces deux réalités y coexistent et témoignent ensemble de notre Dieu infiniment puissant et majestueux. La mer n’est pas un ennemi à vaincre, mais une part essentielle de la création de Dieu qui en révèle davantage sur qui il est.
Cette autre interprétation de la mer déchaînée dans les Écritures pourrait nous aider à la traiter avec plus de respect et de révérence, sachant qu’elle nous dessine les contours d’un Dieu incontrôlable, irréductible et incompréhensible.
Mais elle nous fait prendre conscience aussi que notre anthropocentrisme face à l’eau est lourd de conséquences. Il restreint notre perception de la mer — dans les Écritures et dans la vie — aux idées de chaos et de destruction. Il place les intérêts humains au-dessus du caractère naturel des eaux que Dieu a créées. Il refuse de laisser la mer exister selon l’ordre et l’autorité de Dieu.
Si cet « anthropocentrisme bleu » persiste, il continuera à façonner notre relation avec les étendues d’eau qui nous entourent et nous poussera à toujours plus utiliser la science et la technologie pour dominer la mer et la réduire à un simple objet de consommation. Cet anthropocentrisme nous fait négliger la crise écologique maritime, oubliant que les pratiques de pêche destructrices, le blanchiment généralisé des coraux principalement dû aux émissions de carbone et l’augmentation de la pollution plastique dans les océans sont autant de facteurs qui mettent en péril la vie sur la planète bleue.
Or, selon l’océanographe Sylvia Earle, chacune de nos respirations est liée à la mer, car une très grande partie de l’oxygène de cette planète provient du phytoplancton et des créatures marines. Notre Dieu nous a créés et placés dans un monde interconnecté et interdépendant.
Plutôt que d’essayer de dominer et de maîtriser la mer déchaînée ou de ne voir en elle que chaos et destruction, accueillons-la comme un reflet de la nature magnifique et illimitée de Dieu. Une sortie de pêche, les eaux d’un lac traversé sur une barque cahotante ou les puissantes vagues qui s’écrasent sur un rivage sont autant d’occasions de rencontre avec la grandeur incommensurable de Dieu.
Pour reprendre les mots de C. S. Lewis, la mer déchaînée nous rappelle que notre Dieu n’est pas inoffensif, mais aussi qu’il est bon.
Elia Maggang est vicaire de l’Église protestante évangélique du Timor, en Indonésie (GMIT) et enseigne la théologie de la mer et l’écothéologie à l’université chrétienne Artha Wacana de Kupang, en Indonésie. Il est titulaire d’un doctorat de l’université de Manchester, au Royaume-Uni.
Traduit par Anne Haumont