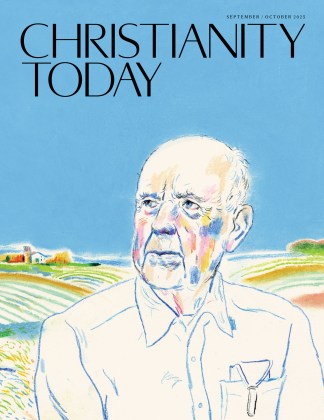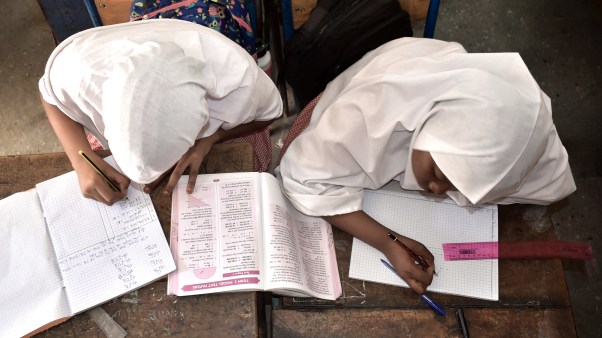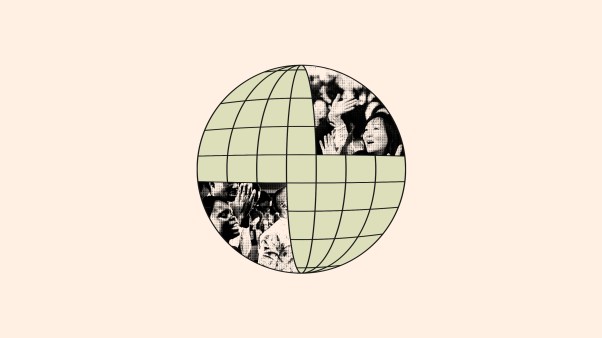Ce texte a été adapté de la newsletter de Russell Moore. S’y abonner ici.
Expulser des membres de gangs étrangers ou d’autres criminels qui se trouveraient illégalement dans un pays est légitime. Les chrétiens ne devraient pas avoir, et n’ont probablement pas, d’objection à une telle politique.
Un des motifs bibliques les plus clairs concernant le rôle de l’État est la responsabilité de celui-ci de faire respecter la loi et de protéger ses citoyens (Rm 13.1-5). Les démocraties libérales ont été pourvues par leurs fondateurs de moyens permettant de s’acquitter de cette tâche et de veiller à ce que les lois soient fidèlement mises en œuvre. Un pays comme le mien devrait donc poursuivre les criminels dangereux et renvoyer du pays ceux qui sont en situation irrégulière.
L’objet de ce type de renvois devrait être clair, de même que les raisons qui les sous-tendent. En tant que chrétiens et citoyens, nous devrions cependant garder à l’esprit que nous devons également nous préoccuper des moyens employés.
Ce qui m’a alarmé dans les récents reportages sur les déportations massives par les États-Unis de membres présumés du tristement célèbre gang Tren de Aragua, ce n’est pas que ces gens aient été arrêtés ou expulsés. Ce n’est pas non plus, dans un premier temps, la question de la régularité de la procédure employée à l’encontre de ces criminels présumés. Les forces de l’ordre sont souvent accusées d’avoir violé les droits de la défense d’une manière ou d’une autre. Face à ces accusations, les agents du gouvernement tentent d’expliquer pourquoi, sur la base de la loi, ils ont considéré avoir le droit d’agir comme ils l’ont fait.
Dans une certaine mesure, c’est ce qu’a fait le « tsar des frontières » de la Maison-Blanche, Tom Homan, lorsque des journalistes lui ont demandé si l’exécutif disposait bien des pouvoirs qu’il revendiquait en vertu de la « Loi sur les étrangers et la sédition » pour expulser ces délinquants présumés vers une prison salvadorienne. Il a répondu que c’était bien le cas et qu’il se battrait pour ce droit devant les tribunaux. Jusque-là ces attitudes font sens. Les tribunaux sont précisément là pour trancher ce genre de question.
Ce qui me préoccupe, c’est ce que Homan a dit ensuite.
Dans une émission de la chaîne ABC News, Homan a répondu ainsi à une question sur la régularité de la procédure : « Où était la régularité de la procédure pour Laken Riley ? Où était-elle pour toutes ces jeunes femmes qui ont été tuées et violées par des membres du Tren de Aragua ? Qu’en était-il pour cette jeune femme brûlée dans le métro — où était son droit à une procédure régulière ? »
Laken Riley était une étudiante infirmière assassinée en 2024 dans l’État de Géorgie par un immigrant clandestin. Les cas mentionnés par Homan sont tous criminels et devraient être moralement scandaleux pour toute conscience humaine en bon état de marche. Cependant, la rhétorique employée ici induit des confusions qui ne sont pas sans conséquences sur des enjeux plus larges de taille et de portée de l’État.
Si votre voisine est arrêtée par la police pour avoir installé dans sa cave un laboratoire de production de méthamphétamine, cette arrestation est une bonne chose. Vous ne voulez pas vivre dans une société où les autorités négligent l’application des lois contre le trafic de drogue. Les trafiquants de ce type ne suscitent généralement guère de sympathie.
Mais que se passe-t-il si le laboratoire de méthamphétamine de votre voisine a été découvert non pas à la suite d’un soupçon d’activité criminelle, suivi d’une enquête judiciaire, mais parce que le gouvernement a installé des caméras de surveillance secrètes dans chaque maison ?
Si vous objectiez à ce type d’espionnage illégal, certains de ses partisans ne manqueraient pas de pointer vers les résultats : « Cela ne vous intéresse pas que nous ayons arrêté des trafiquants de méthamphétamine ? Vous êtes pour le trafic de drogue ? »
Vous n’êtes pourtant pas plus en faveur de la drogue que du meurtre. Votre objection à ce type de dérive vers un État policier serait une objection au fait que le gouvernement viole la loi, quand bien même la violation en question a donné de bons résultats. Vous soutiendriez là l’un des meilleurs aspects de la démocratie libérale : l’idée qu’un peuple doit prêter attention non seulement à la légalité des fins, mais aussi à la légalité des moyens. Ce qui compte, ce ne sont pas seulement les résultats, mais aussi la manière dont nous les obtenons.
Beaucoup de gens tiennent ce genre de système pour acquis. Mais certains, comme le journaliste américain Jonah Goldberg, affirment depuis des années que nous devrions reconnaître que ce type de fonctionnement est un réel miracle. Il y a quelque chose de prodigieux à ce qu’une nation ne soit pas gouvernée en fonction de liens de loyauté tribale, mais selon un système de lois redevable à l’égard du peuple, qui va jusqu’à protéger les droits de la minorité lorsque la majorité démocratique veut l’opprimer.
Un très laïc partisan de la démocratie libérale et du républicanisme constitutionnel affirme que ce « miracle » peut être attribué à au moins une source peut-être inattendue : le calvinisme.
En 2017, le politologue Francis Fukuyama écrivait que la plupart de ses collègues négligent l’importance de la Réforme protestante dans l’émergence de l’État moderne et le fait que les ailes luthérienne et calviniste de la Réforme ont toutes deux contribué à l’ordre politique que nous considérons aujourd’hui comme acquis.
Le luthéranisme a notamment soutenu l’alphabétisation de masse en encourageant la lecture de la Bible par les laïcs. Et dans une interview ultérieure, Fukuyama explique que c’est l’« éthique personnelle austère » du calvinisme qui avait été cruciale pour l’élimination de la corruption, en particulier « dans la fondation des bureaucraties modernes aux Pays-Bas, en Prusse, en Angleterre et aux États-Unis ».
Fukuyama ne dit pas que le calvinisme lui-même était de nature libérale et démocratique. Les anabaptistes — qui fuyaient la Suisse sous la menace d’être noyés par des magistrats calvinistes pour avoir refusé de faire baptiser leurs bébés — auraient pu en témoigner, tout comme Michel Servet, que la Genève calviniste conduisit au bûcher pour hérésie.
Ce que Fukuyama affirme, c’est que le type d’éthique personnelle promu par le calvinisme conduit en fin de compte à quelque chose de contre nature : un état impersonnel. Il poursuit :
Je pense que la corruption est au fond quelque chose de très naturel. Vous avez envie d’aider vos amis et votre famille. L’idée qu’il faudrait agir de manière impersonnelle et ne pas voler au nom de ses amis ou de sa famille ne vient à l’esprit de personne à moins d’y être contraint. Le calvinisme imposait aux croyants une forme de morale propice à un ordre strict, dans lequel on peut dire à un fonctionnaire qu’il agit mal. Si vous n’intériorisez pas ces règles, aucune surveillance externe ne rendra les gens vraiment honnêtes.
Fukuyama souligne là quelque chose d’important. La « distinction ami-ennemi » est en effet naturelle dans ce monde où l’humanité évolue loin de Dieu. Si nous fondons notre éthique, notre politique ou notre culture sur la nature, nous aboutirons à quelque chose qui s’apparente à la loi de la jungle : ceux qui ont le plus d’armes ou de chars d’assaut gagnent, et tous les autres leur sont soumis.
Cela conduit, par définition, à un État illimité et sans restriction. On en vient généralement assez vite à un régime de corruption et d’intimidation dans lequel le caractère criminel de vos actes n’est pas défini par ceux-ci, mais par vos relations.
Ce n’est que si l’on considère que l’État reste redevable à l’égard de quelque chose d’autre — un ordre moral qui ne se borne pas à savoir qui a le plus de voix — que l’on peut espérer que celui-ci n’outrepasse pas toutes les limites.
En tant que citoyens, nous devrions nous intéresser au comment et pas seulement au quoi de toute action gouvernementale. Les États démocratiques disposent de constitutions dont le respect devrait nous tenir à cœur, quand bien même leurs dispositions iraient à l’encontre de la dernière tendance populaire. En tant que chrétiens, nous devrions nous préoccuper des moyens tout autant que des fins, car nous croyons que rendre à César ce qui lui appartient n’implique pas de faire de César un dieu.
Qu’il s’agisse de gangsters étrangers, de trafiquants d’êtres humains ou de criminels en col blanc, tous devraient être poursuivis, et un pays devrait pouvoir expulser ceux qui se trouvent illégalement sur son territoire.
Mais nous devons nous préoccuper de la manière dont nous le faisons. La démocratie libérale peut ralentir certaines choses que nous aimerions voir advenir, mais elle nous manquera si elle venait à disparaître. L’État de droit est faillible, mais il reste une précieuse idée à laquelle il ne faut pas renoncer.
Russell Moore est rédacteur en chef de Christianity Today et dirige son projet de théologie publique.