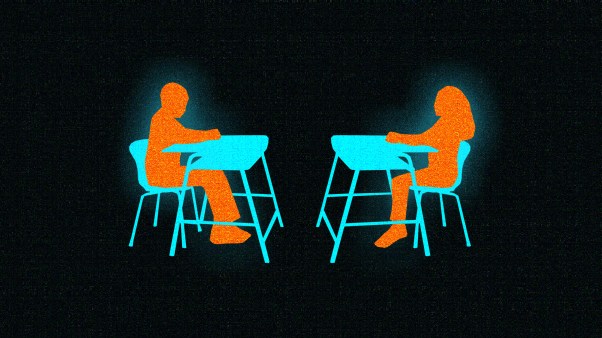Dans un récent épisode de TheBulletin, Mike Cosper, directeur média pour Christianity Today, s’est entretenu avec Krista Tippett. Dans son émission On Being, cette journaliste de renom mène depuis plus de 20 ans des conversations en profondeur sur la religion et la spiritualité dans toutes les traditions.
Dans cet entretien, ils abordent le climat politique tendu aux États-Unis, l’individualisme qui nous ronge et la manière dont espoir et communautés peuvent offrir une voie vers la guérison. Cette interview a été adaptée au format écrit et raccourcie pour en faciliter la lecture.
 Illustration de Ronan Lynam
Illustration de Ronan LynamMike Cosper : Ce que j’aime dans votre travail depuis des années, c’est que vous nous éveillez aux courants spirituels sous-jacents de notre culture. Qu’est-ce qui vous a appris à vous arrêter et à observer les éléments spirituels de notre monde ?
Krista Tippett : Il y aurait beaucoup de façons de répondre, mais je dirais simplement que j’ai grandi dans une culture et une famille où il n’y avait pas beaucoup d’écoute et d’attention approfondies.
Parfois, nous apprécions les choses parce qu’on nous en a donné l’exemple, et parfois c’est à cause de leur absence. Vivre un manque difficile à cerner et rechercher ce qui pourrait le combler peut être un véritable cadeau.
Pour ce qui est de la spiritualité, j’ai grandi chez les baptistes du Sud dans un monde très religieux. Mais je ne dirais pas que c’était un monde très spirituel. Lorsque j’ai quitté la maison, je n’étais pas vraiment opposée à la religion, mais je n’étais pas sûre de sa pertinence pour le monde dans lequel j’évoluais à ce moment-là. Plus tard, j’ai fait des études de théologie et j’ai aimé cela.
Dans mes jeunes années, c’est la politique qui m’intéressait. J’ai passé la majeure partie de ma vingtaine dans un Berlin divisé, en plein dans la guerre froide, grand drame géopolitique des années 80. Je n’ai pas pu le formuler ainsi avant longtemps, mais Berlin était une ligne de faille dans le paysage géopolitique de l’époque.
C’est là que j’ai commencé à percevoir un manque d’attention à la dynamique spirituelle derrière la division du monde et les armes que nous pointions les uns sur les autres. Dans le Berlin divisé, on avait une ville avec un peuple, une langue, une culture, mais divisée en deux parties auxquelles on avait attribué deux réalités concurrentes totalement différentes et qui avaient des missiles pointés l’une vers l’autre. J’aimais des gens des deux côtés. Et je les voyais créer, aussi bien les uns que les autres, une vie de dignité, de beauté, de sens et d’intimité — ou échouer à le faire.
Et peu importe de quel côté du mur ils avaient atterri. Ce n’est pas la matière brute qu’ils ont reçue qui a compté, mais ce qu’ils en ont fait. Cela m’a ramenée à ce « nous » essentiel, originel.
Spirituel est un mot que j’utilise peu parce qu’il est assez vague. Mais quand même, c’est à cette dimension spirituelle que les décideurs politiques et les personnes qui déplaçaient les missiles sur la carte ne prêtaient pas attention.
La question suivante me fascinait : Comment être alertes au milieu de et en dépit de ce que le monde politique et économique, « officiel et sérieux », fait autour de nous ? Y prêter attention m’a plutôt bien servi, considérant ce que nous vivons actuellement.
MC : Dans votre livre Becoming Wise, vous dites : « L’espérance […] est un choix qui devient une habitude qui devient une mémoire musculaire spirituelle ». Et vous poursuivez en la décrivant comme une « ressource renouvelable ». Pouvez-vous nous expliquer cela, plus particulièrement dans le contexte actuel ?
KT : Je pense beaucoup à l’espérance. Et ces jours-ci, je me risque à dire : « L’espérance est un muscle ». Un muscle n’est pas un vœu pieux. L’espérance, c’est autre chose que supposer ou croire que les choses finiront par s’arranger. La façon dont je conçois l’espérance est basée sur la réalité. Ce n’est pas de l’optimisme.
J’ai quelques modèles dans ce domaine. Je pense à John Lewis, [fervent défenseur des droits civiques aux États-Unis], qui a beaucoup parlé d’espérance. Cela tient du prophétisme que de refuser la façon dont on vous dit que les choses doivent être, de refuser que le monde « doit être ainsi ».
L’espérance, le muscle, c’est d’investir tout ce que nous pouvons de notre vie, de notre volonté, de notre énergie, de notre intelligence, de notre créativité, de notre attention dans ce refus.
L’un des grands cadeaux de ma vie d’entretiens a été d’échanger avec des personnes qui ont réellement fait basculer le monde d’une manière ou d’une autre. Des personnes qui ont vu une possibilité à laquelle, presque toujours au début, personne ne croyait ou dont on se moquait. C’est un peu vrai, en fait, pour tous les élans humains de créativité, d’innovation et de transformation sociale.
Il s’agit donc d’un saut dans l’imagination. On s’accroche à une meilleure alternative. C’est ce que les êtres humains ont fait à travers le temps. C’est ainsi que l’on va de l’avant, en mettant notre vie au service de cette meilleure potentialité.
MC : Cette idée fondamentale que l’espérance est un choix, je pense, est très importante dans une période comme celle-ci. Si je ne me trompe pas, les auditeurs de The Bulletin sont souvent des personnes qui se sentent — dans une certaine mesure spirituellement et dans une large mesure politiquement — isolées. Elles ne sont pas bien représentées par les options qui s’offrent à elles.
Dans ce genre de solitude et d’isolement, une des tentations est celle du désespoir. L’autre tentation est d’adopter une idéologie qui finit par être très radicale. Comment choisir l’espérance dans la situation dans laquelle tant de gens se trouvent aujourd’hui ?
KT : Tout d’abord, je tiens à dire que je ne suis pas optimiste pour tout. L’espérance n’est pas universelle. Je ne dirais pas de manière générale, par exemple, que j’espère en notre culture politique. Ce ne serait pas raisonnable. Il y a des gens qui travaillent sur ce sujet, j’en connais, et il y a une très jeune génération de nouveaux politiciens qui arrivent et qui me donnent de l’espoir. Mais je constate aussi qu’il leur reste 20 ans avant de prendre les rênes. Je pense donc qu’il faut faire preuve de discernement.
La politique n’est pas vraiment mon domaine. Je pense à Bryan Stevenson, [avocat fondateur de l’Equal Justice Initiative aux États-Unis,] qui parle de préciser ce à quoi nous sommes appelés. Pour lui, discerner ce que nous voulons être dans le monde et comment nous voulons être au monde va dépendre d’une certaine proximité. On doit s’investir dans quelque chose que nous pouvons voir, toucher et connaitre.
Lorsque je dis que l’espérance est fondée sur la réalité et qu’elle doit être raisonnable, c’est que, pour moi, il doit s’agir un choix éclairé. Or, nous ne sommes pas tous informés de tout. L’espérance est centrée sur quelque chose. En cette période, ce n’est pas possible d’avoir une espérance généralisée. Ce ne serait pas l’espérance robuste dont je parle. Ce serait une illusion.
L’autre chose très importante que je tiens à dire, c’est que l’un des principes les plus corrosifs de la culture américaine, qui a infecté tous les autres domaines, y compris nos vies religieuses, est le culte de l’individu. Et nous n’en sommes même pas conscients. Nous avons été élevés dans l’idée que tout tourne autour du fait d’être un individu. Or, le courage de l’individu ne suffit pas. Les vertus ne sont pas censées être exercées individuellement.
Je le dis souvent lorsque je m’adresse aux jeunes, parce c’est mon expérience : ces jeunes générations ressentent très tôt et très profondément ce que nous devons tous affronter, à savoir que tout ce que nous faisons pour rendre ce monde meilleur aujourd’hui sera le travail du reste de notre vie.
Nous ne disposons pas de plans sur deux, cinq ans ou dix ans. Nous sommes confrontés à des crises profondes, à l’échelle de notre civilisation, voire de notre espèce. Ou à des appels, pour le dire de manière plus positive. Et dans ce cas, aucun d’entre nous ne sera capable tout seul de constamment ressentir cette espérance, de la conserver jour après jour, ou de persévérer dans la compassion, le courage ou l’amour.
Nous sommes appelés à nous entourer d’autres personnes et, ce faisant, nous briserons cette fiction de l’individualisme avec laquelle nous avons grandi. Nous devons nous entourer d’autres personnes qui seront capables de perpétuer l’espérance durant les jours, les semaines et les années où cela sera trop lourd pour nous-mêmes.
C’est la réalité de l’époque dans laquelle nous vivons. C’est ainsi que je vois les choses. Nous vivons une période compliquée, et si nous restons seuls face à cela, nous n’y arriverons pas.
MC : Comment ce message peut-il toucher des gens à qui l’on vend constamment le contraire ? Je pense à l’exemple de notre culture des réseaux sociaux, qui impose à tout le monde de jouer le rôle du personnage principal. Comment convaincre les gens qu’ils font partie d’une famille et d’une communauté et que ces choses-là sont importantes ?
KT : Je n’ai pas de réponse à cela, mais je pense que c’est la bonne question. Vous m’avez probablement déjà entendu citer le poète Rainer Maria Rilke qui évoque l’idée de vivre de ses questions. Il écrit à un jeune poète : « Ne cherchez pas pour le moment des réponses qui ne peuvent vous être apportées, parce que vous ne sauriez pas les mettre en pratique, les “vivre”. » Je pense que ce qu’il voulait dire, c’est que se précipiter vers une réponse conduirait à nier la gravité de la question. Ce que nous sommes appelés à faire, c’est vivre la question, aimer la question et maintenir la question jusqu’à ce que nous puissions vivre notre chemin vers la réponse. Une façon de décrire notre époque est de dire qu’elle est faite de questions vastes, douloureuses et ouvertes.
Mais cette mentalité, cet individualisme, est tellement ancrée en nous qu’il est en dessous du niveau de conscience. Nous devons déraciner quelque chose dont nous ne sommes même pas conscients. Je pense que cela commence par des conversations comme celle-ci, en nommant les choses et en réveillant les gens.
L’une des choses que j’ai toujours dites dans mon émission, c’est qu’il m’a fallu quelques années de travail pour me rendre compte que j’étais animée par les grandes questions de sens qui inspirent nos traditions. Qu’est-ce que cela signifie d’être humain ? Comment voulons-nous vivre et qui serons-nous les uns pour les autres ?
Et avec toutes les crises ou tous les appels qui se présentent à nous, qu’ils soient écologiques, raciaux ou économiques, si nous ne mettons pas au centre cette question de savoir qui nous serons les uns pour les autres, je pense que nous ne ferons que survivre. Et nous gâcherons l’occasion de nous épanouir en tant que communautés, en tant que nations, en tant qu’espèce.
MC : On pourrait en quelque sorte ramener cela à « Aime ton prochain ».
KT : On pourrait.
MC : Ce ne serait pas une mauvaise synthèse, n’est-ce pas ?
KT : En effet, et cela nous mène à un de mes autres sujets préférés du moment, car l’expression « Aime ton prochain » ne parle pas non plus d’un sentiment. C’est l’agapè. C’est l’amour en action.
Nous devons redécouvrir que l’amour n’est pas simplement un « savoir être », mais bien la chose la plus difficile qui soit. Les Beatles avaient raison ; c’est ce qui nous sauvera. Mais seulement si nous apportons à notre vie citoyenne l’intelligence que nous possédons dans notre vie privée, dans notre vie d’amour.
Parce que, dans notre vie amoureuse, dans les relations les plus intimes, l’amour est très souvent quelque chose que nous faisons en dépit de ce que nous ressentons, n’est-ce pas ? Il s’agit très rarement de se sentir parfaitement compris ou de comprendre parfaitement l’autre.
La façon dont l’amour fonctionne — non pas en tant que sentiment, mais en tant qu’action — est très souvent liée à ce que nous choisissons de ne pas dire à tel ou tel moment. Sur les réseaux sociaux, au contraire, nous disons tout et tout de suite. Mais quand nous choisissons de rester en relation, nous choisissons de ne pas dire certaines choses directement.
Donc, si nous vivons « l’amour du prochain » comme une manière d’être robuste, réaliste, pragmatique et concrète, et pas seulement comme une belle manière d’être, c’est exactement ce dont nous avons besoin.
MC : C’est un excellent point de départ, je pense. Merci de nous avoir rejoints dans cette émission.
KT : Merci à vous. Ce fut un plaisir.
Krista Tippett est autrice et journaliste primée. Elle est la créatrice et l’animatrice de The On Being Project.
Mike Cosper est directeur de CT Media, animateur de The Rise and Fall of Mars Hill et coanimateur de The Bulletin.
Traduit par Anne Haumont