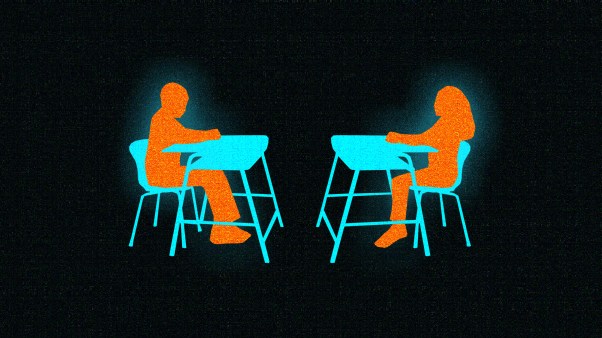J’aime les films de Bollywood. Qu’y a-t-il de mieux que trois heures de chants et de danses raffinés, de décors et de costumes colorés, de romance à l’eau de rose et d’une pincée d’humour burlesque ? Tous les Indiens savent que l’on regarde ces films pour la musique et la danse, pas pour l’intrigue. La plupart du temps, les intrigues se ressemblent : un homme tombe amoureux d’une fille provenant du mauvais côté de la ville (ou inversement) et ne peut pas l’épouser parce que ses parents ont arrangé les choses pour qu’il se marie avec une personne de sa classe sociale. D’une manière ou d’une autre, l’histoire se termine bien, mais, quoi qu’il arrive, le protagoniste doit toujours se réconcilier avec ses parents.
Trompés par notre individualisme
368 pages
Pourquoi ? Parce que la famille passe avant l’amour, avant les affaires, avant de « suivre ses rêves ». Les Indiens (et les Indiens-Américains comme moi) le comprennent, mais certains de mes amis occidentaux se demandent à quoi rime tout cela. Sois toi-même ! Écoute ton cœur ! Suis tes rêves !
E. Randolph Richards et Richard James ont écrit Trompés par notre individualisme pour aider à former les lecteurs occidentaux contemporains de la Bible sur le système de valeurs collectiviste à l’œuvre dans le monde biblique. L’hypothèse de fond de ce livre est que la plupart des occidentaux interprètent le monde à travers un prisme centré sur les désirs, les besoins et les valeurs de l’individu. (Richards et James citent judicieusement le personnage de Porcinet de A. A. Milne dans cette expression bien connue : « Les choses qui me rendent différent sont les choses qui me font, moi. ») Mais les sociétés collectivistes, dans l’Antiquité comme aujourd’hui encore dans la majeure partie du monde, orientent leurs valeurs en fonction de la famille et du groupe.
Des dynamiques collectivistes
Richards et James posent les bases de la compréhension des cultures collectivistes en soulignant comment ces cultures utilisent l’honneur et la honte comme outils de renforcement des valeurs sociales. L’honneur consiste à cultiver une bonne réputation aux yeux de son groupe social. Lorsque la réputation d’une personne est entachée aux yeux de ce groupe, elle est affectée par la honte. Honneur et honte façonnaient la pensée dans le monde biblique.
Richards et James consacrent également beaucoup d’espace à l’importance de la famille et des liens de parenté dans la structure sociale du monde méditerranéen antique. De nombreux lecteurs connaîtront ou comprendront déjà ces éléments à partir d’expériences faites dans leur propre culture ou en observant des cultures collectivistes. L’attention portée à des structures collectivistes spécifiques, telles que le patronage et la médiation — des réseaux faits de dons, où des faveurs sont échangées et où la réciprocité est attendue — permet de tirer un profit plus concret de la perspicacité interculturelle des auteurs. Les « patrons » avaient du pouvoir et un statut et aidaient leurs « clients » dans le besoin (avec, par exemple, de l’argent ou un accès à des relations). En échange, les clients devaient des faveurs aux patrons. Souvent, il s’agissait d’améliorer la réputation du mécène, de parler de lui ou d’elle et d’étoffer son entourage. (Pensez à Gaston et LeFou dans La Belle et la Bête de Disney.)
Richards est un bibliste très respecté, qui apporte une approche et une interprétation fiables dans l’étude des textes. James (« Richard James » est un pseudonyme), lui, a été impliqué dans le ministère d’implantation d’églises au Moyen-Orient. Pour nous aider à comprendre la vision du monde et les valeurs des populations collectivistes, ils nous les introduisent au moyen des récits d’expériences interculturelles contemporaines. Ceux-ci entrent ensuite en résonance avec les récits et les passages de l’Ancien et du Nouveau Testament qu’ils examinent.
J’ai apprécié que le livre insiste à plusieurs reprises sur le fait que nous ne sommes pas censés considérer les collectivistes comme intrinsèquement « bons » ou « justes » et les individualistes comme intrinsèquement « mauvais ». Les auteurs envisagent ces deux systèmes comme des pommes et des oranges : ils sont simplement différents. Le livre n’est pas conçu pour nous aider à imiter les anciennes cultures méditerranéennes. Il s’agit plutôt de mieux comprendre les dynamiques sociales et culturelles qui se jouent, souvent de manière invisible, à l’arrière-plan des textes bibliques.
Par exemple, on peut penser que le but de l’histoire de David et Goliath est de souligner la bravoure personnelle de David. Mais, dans une perspective collectiviste, l’accent porterait plutôt sur la défense par David de l’honneur du Dieu d’Israël, dont le nom et la réputation étaient traînés dans la boue par les Philistins. À maintes reprises, Richards et James interprètent les textes avec habileté et illustrent les valeurs à l’œuvre avec perspicacité.
J’aurais aimé disposer d’un tel manuel il y a 15 ans quand j’apprenais à bien lire la Bible. C’est une chose d’étudier des événements historiques comme la destruction du temple de Jérusalem en l’an 70 de notre ère, ou des détails géographiques comme les caractéristiques urbaines de la ville romaine de Philippes. Mais ici, en un livre relativement court, Richards et James nous offrent les éléments clés de compréhension des cultures collectivistes qui aideront le lecteur biblique à éviter de nombreuses erreurs d’interprétation courantes.
Il est toutefois important de souligner que tous les collectivistes ne sont pas identiques. Le collectivisme n’est pas non plus un phénomène culturel rigide. Richards et James le reconnaissent, et ils ont une belle formule à ce sujet : « Les généralisations sont toujours fausses, mais généralement utiles. » Les collectivistes ont en commun une tendance naturelle à placer le groupe au-dessus de l’intérêt personnel, l’honneur au-dessus du gain personnel, et le bénéfice du groupe au-dessus du choix et de la liberté personnels. Mais qu’est-ce exactement qu’un individualiste ? Les individualistes sont-ils égoïstes ? Le collectivisme exclut-il la recherche de l’intérêt personnel ?
Revenons à mes films de Bollywood. Si la morale de l’histoire souligne généralement l’importance d’honorer sa famille et ses parents — et les Indiens y sont très attachés —, les intrigues tournent aussi généralement autour du fait de « tomber amoureux » ou de « suivre ses rêves personnels ». C’est de là que tout part.
Des élans d’individualisme
Il y a quelque temps, nous avons regardé en famille le film de Disney Mulan. Situé dans la Chine ancienne, le film met en scène une jeune femme qui ne demande qu’à être elle-même, une guerrière endurante et talentueuse dotée d’une remarquable énergie vitale, ou Qi. Son désir d’être elle-même est freiné par une culture selon laquelle elle est destinée à être mariée et à servir de bonne épouse et de mère pour l’empire. La guerre est réservée aux hommes.
Dans l’histoire, le père âgé et fragile de Mulan est enrôlé dans l’armée pour partir combattre, mais elle prend secrètement sa place et se fait passer pour un homme par amour et respect pour son père. D’un côté, son action indépendante est individualiste. Elle veut embrasser ses talents naturels et ses passions. Mais ses intentions sont également orientées vers l’honneur de sa famille et de l’empire.
Disney nous a habitués aux fins heureuses, je ne gâcherai donc rien en disant que Mulan obtient finalement tout ce qu’elle espérait. Alors que l’empire aurait pu l’exécuter pour avoir dissimulé son identité féminine, elle est finalement récompensée pour avoir fait passer sa famille en premier et avoir ainsi respecté une valeur fondamentale de l’héritage culturel impérial. En fin de compte, « individualisme » et « collectivisme » peuvent aussi s’entremêler.
Ce constant m’amène à m’interroger sur la manière dont l’accent mis ici sur le collectivisme dans la Bible pourrait occulter d’importants élans individualistes. Pensez à Abraham quittant sa famille, son pays et son clan pour errer en suivant la voix d’une nouvelle divinité. Ou encore à Moïse fuyant les deux seuls peuples qu’il ait jamais connus — les Égyptiens et les Israélites — pour vivre dans le désert et reconsidérer son identité et l’orientation de sa vie. Ou encore à Jésus, qui offense la plupart des habitants de Nazareth (« aucun prophète n’est bien accueilli dans sa patrie » — Lc 4.24) et qui voyage avec son message nouveau sans avoir d’endroit où poser sa tête (Lc 9.58). Ou à Paul, rejeté par les siens pour avoir suivi Jésus et plusieurs fois lapidé, battu et emprisonné.
Certes, aucune de ces personnalités ne peut être qualifiée d’individualiste au sens contemporain, mais elles semblent toutes rompre avec les stéréotypes de la pensée et du comportement collectivistes. Et elles n’étaient pas les seules à leur époque, ce qui rend leurs exemples d’autant plus intéressants à méditer lorsque nous essayons de lire la Bible avec soin et sagesse.
L’idée que nous lisons tous l’Écriture à travers nos propres lunettes culturelles est centrale dans ce livre. Et elle est très juste. Nous avons deux yeux, mais une seule perspective. De nombreux lecteurs de la Bible dans l’Occident contemporain voient le monde différemment des auteurs bibliques et des nombreux personnages de notre Livre saint. Ce cours accéléré sur le collectivisme et l’individualisme que nous offrent Richards et James sera précieux pour nous aider à éviter bien des faux pas.
Nijay K. Gupta est professeur de Nouveau Testament au Northern Seminary à Lisle, en Illinois. Il est l’auteur de Paul and the Language of Faith.