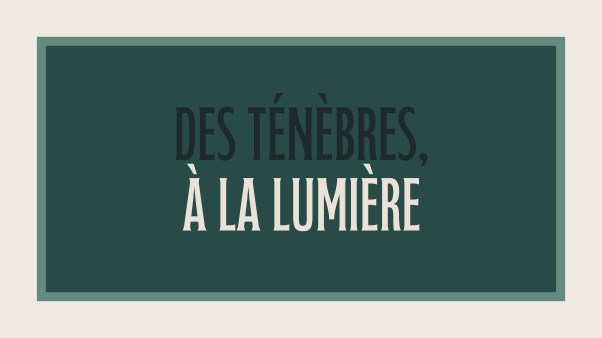Imaginez une église qui s’apprête à annoncer un dimanche matin sa transition vers un modèle égalitarien et à s’engager à inclure des femmes dans la conduite pastorale. Avant le début du culte les responsables se retrouvent pour prier et faire un dernier point sur leur stratégie de communication. L’esprit du pasteur qui annoncera la nouvelle du haut de la chaire bruisse de cette question brûlante : comment l’assemblée réagira-t-elle ?
Lors des mois écoulés il a bien vu que sa communauté avait des avis partagés en ce qui concerne les ministères des femmes. Mais lui et les responsables sont convaincus que, pour leur église, l’adoption d’une approche égalitarienne est la voie à suivre. Il rassemble donc ses forces, entre dans la salle de culte et annonce la nouvelle.
Finalement, la déclaration semble bien passer. L’assemblée n’applaudit pas, mais personne ne hue ni ne quitte la salle – et c’est déjà une victoire. Tout semble sous contrôle. Le culte se termine sans trop de tension et le pasteur et les autres responsables poussent un soupir de soulagement.
Ce scénario n’est qu’imaginaire, mais il n’est pas très différent de ce qui se passe dans la réalité lorsque des églises de type complémentarien passent à des modèles égalitariens. Souvent, les personnes impliquées dans le processus sont tellement épuisées par tout le travail qu’il a fallu faire pour accompagner l’église dans la réflexion qui l’a conduite à adopter une approche égalitarienne du ministère que la réécriture finale du positionnement officiel de l’église sur le ministère des femmes apparaît comme l’heureux dénouement. Enfin, le but serait atteint. Il ne s’agit pourtant que du début d’un parcours ardu.
Chaque église gère ce processus à sa manière. Ce qui est cependant indéniable dans toutes les situations, c’est que, quelles que soient les précautions prises et la volonté avec lesquelles une église aborde cette transition, le processus est plus long et plus difficile que prévu. Il est souvent douloureux et inévitablement désordonné. Cela a pour conséquence que de nombreuses stratégies de communication donnent, sans le vouloir, la priorité au discours (avec les éléments apologétiques appropriés et une articulation soignée des positions) et au contrôle des dommages collatéraux. Cette situation limite considérablement l’énergie et l’attention disponibles pour que les femmes puissent réellement s’épanouir.
Pour avoir connu de l’intérieur ce genre de transitions, je peux dire que deux choses sont généralement vraies : premièrement, ce sont souvent des personnes bien intentionnées qui mènent ces efforts, faisant de leur mieux avec les ressources disponibles. Deuxièmement, ces efforts bien intentionnés engendrent parfois beaucoup de souffrance.
Bien qu’aucune église ne puisse suivre cette voie à la perfection, il est possible d’atténuer la souffrance et la frustration qui en découlent souvent. J’aimerais faire quelques suggestions aux responsables d’église – des pièges à éviter – qui entament un parcours vers l’égalitarisme ou envisagent plus simplement de réévaluer la position de leur église à l’égard des femmes. Les femmes devant prédicatrices sont bien plus nombreuses qu’au cours des décennies précédentes. Il est donc impératif de continuer de discuter de la manière dont ces transitions peuvent être menées à bien.
L’un des pièges les plus courants pour les églises nouvellement égalitariennes est de penser qu’une déclaration à ce sujet change tout. Rien ne pourrait être moins vrai. Avoir révisé la position officielle ne signifie pas encore que les systèmes et les valeurs qui sous-tendent la culture de l’église ont radicalement changé. Des décennies de tradition continuent de peser de tout leur poids. Les présupposés et les attentes ancestrales à l’égard des femmes restent intacts. Ainsi se cumulent des couches de complexité et des défis qui sont autant d’écueils entre lesquels les femmes devront naviguer.
Les femmes qui pensent que de nouvelles opportunités de service s’offrent à elles se heurtent à des barrières invisibles et trébuchent sur des règles tacites dont elles ignorent complètement l’existence. Dans de tels contextes, les femmes nommées à de nouveaux postes vont au-devant de l’échec.
Comment atténuer ce phénomène ? Pour commencer, examinez comment le contexte de votre église – et non votre déclaration sur les femmes – encourage (ou compromet) l’intégration des femmes.
Quelques questions directrices peuvent être utiles : dans la culture des ministères dans notre église, quels sont les traditions, les présupposés ou les attentes au sujet des femmes ? Existe-t-il des mécanismes permettant d’identifier les systèmes de valeurs ? Existe-t-il des structures qui sont obsolètes ou qui nécessitent une attention particulière ? Avons-nous réfléchi à la manière dont nos pratiques de recrutement et les cahiers des charges des employés pourraient être ajustés en fonction de notre nouvelle position sur le ministère des femmes (par exemple, à quoi ressemblerait un congé de maternité pour un pasteur) ? À quoi ressemblerait notre église si elle incluait pleinement les femmes à tous les niveaux de direction et d’influence ?
Un autre écueil fréquent pour les églises est de penser qu’en nommant une femme à un poste de direction, toutes les femmes seront désormais représentées et incluses. C’est particulièrement vrai dans le domaine de la prédication. Dans de nombreux cas, une fois qu’une église a trouvé une femme prédicatrice en qui elle a confiance, elle ne fait plus beaucoup d’efforts pour inclure d’autres femmes parmi ceux qui la servent. Après tout, on peut maintenant dire que « des femmes prêchent dans cette église ». Vraiment ?
À maintes reprises, lorsque j’entre dans des églises qui étaient autrefois de tendance complémentarienne et que je demande si des femmes y prêchent, la réponse correspond plus ou moins à : « Oh oui, Béatrice prêche très souvent. » Ce que cette phrase dit aussi – et qui peut facilement passer inaperçu – est le fait qu’Ambre (qui se trouve être formée à la prédication) ne prêche pas dans cette église, pas plus que Sarah, Anna ou Michelle. Dans cette église, Béatrice est la seule femme qui prêche. Oui, on peut se réjouir du fait qu’une femme prêche, cela ne fait aucun doute. Mais il y a un monde entre une église où Béatrice prêche et une église où les femmes prêchent.
À quoi ressemblerait un engagement plein et entier en faveur de la prédication féminine dans nos églises ? Y a-t-il d’autres domaines – au-delà de la prédication – où une femme se trouve supposée représenter toutes les autres ? Lorsque les églises font la liste de toutes les femmes actuellement engagées dans des ministères, n’y aurait-il pas des spécialisations, des origines ethniques ou des expériences de vie non encore représentées parmi elles ?
Un troisième écueil, et peut-être le plus douloureux, est de ne pas comprendre quelle est la charge émotionnelle que ces transitions ecclésiales importantes font peser sur les femmes. Le fait de savoir que le but ultime de toutes ces discussions est de déterminer ce que nous, les femmes, avons le droit de faire ou de ne pas faire en fonction de notre sexe est particulièrement difficile à vivre. Ce que je suis en tant que femme, en tant prédicatrice et pasteure, est profondément affecté par ce débat. Pour beaucoup d’entre nous, ces débats sont des expériences très personnelles qui nous marquent au plus profond de notre être.
De plus, il arrive que l’on nous demande de partager notre expérience personnelle avec les responsables masculins de la communauté. On peut se réjouir d’un effort sincère pour écouter et essayer de comprendre notre expérience, mais beaucoup de ces conversations restent unilatérales. Nous partageons nos expériences personnelles et nos souffrances – et eux ne le font pas.
Lorsque cette dynamique est en place, les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tous. Cela ne fait qu’exacerber la douleur que certains d’entre nous portaient bien avant que ces discussions ne débutent et qui ne font que rouvrir ces plaies que l’église dit vouloir soigner. Une fois que la décision a été prise de s’engager officiellement dans une direction égalitarienne, la plupart des efforts des responsables sont consacrés à la défense de ce positionnement et de son ancrage biblique et à une articulation minutieuse de la prise de position officielle, sans accorder suffisamment d’attention aux femmes qui se trouvent prises au milieu de tout cela.
Les églises qui veulent vraiment passer à un modèle égalitarien devraient se poser la question suivante : sommes-nous conscients de la manière dont ces « conversations unilatérales » ont affecté, et affectent encore les femmes qui servent dans notre église ? Avons-nous des personnes engagées, hommes et femmes, dont le rôle principal est d’intercéder et de prier pour les femmes, de les encourager et de ne jamais les perdre de vue ? Quelles lignes directrices pourrait-on envisager pour aider à garantir que les conversations entre les hommes et les femmes soient mutuelles et équitables ? Est-il possible de formuler des processus clairs, de créer des espaces protégés et des ressources pour que les hommes et les femmes puissent exprimer leurs besoins et leurs luttes spirituelles et émotionnelles ? À quelle fréquence les responsables d’église vont-ils réévaluer leur position et leurs pratiques à l’égard des femmes dans le ministère ?
Finalement, la question principale est la suivante : notre église s’engage-t-elle vraiment à inclure les femmes dans la vie de la communauté et à ouvrir des voies qui leur permettent d’exercer pleinement leurs dons ? La réponse à cette question influencera les réponses à toutes les autres questions concernant les femmes dans la direction de l’église.
Jamais le parcours ne sera sans difficulté et les églises commettront des erreurs. Mais la manière dont les responsables d’église aborderont chaque échange, chaque annonce et chaque situation fera toute la différence dans la création d’un espace où toutes les femmes et tous les hommes peuvent ensemble s’épanouir et utiliser leurs dons dans la réciprocité et le respect. Le mot clé ici est « intentionnalité », et pas « perfection ». Une intentionnalité aimante, sincère et persévérante sera toujours un atout.
Gaby Viesca est directrice des programmes de Missio Alliance et présidente de l’unité d’études évangéliques de l’American Academy of Religion. Elle a exercé un ministère pastoral à temps plein en Israël, au Mexique et dans la région du Pacifique.
Traduit par Matthias Radloff pour Servir Ensemble et révisé par Christianity Today