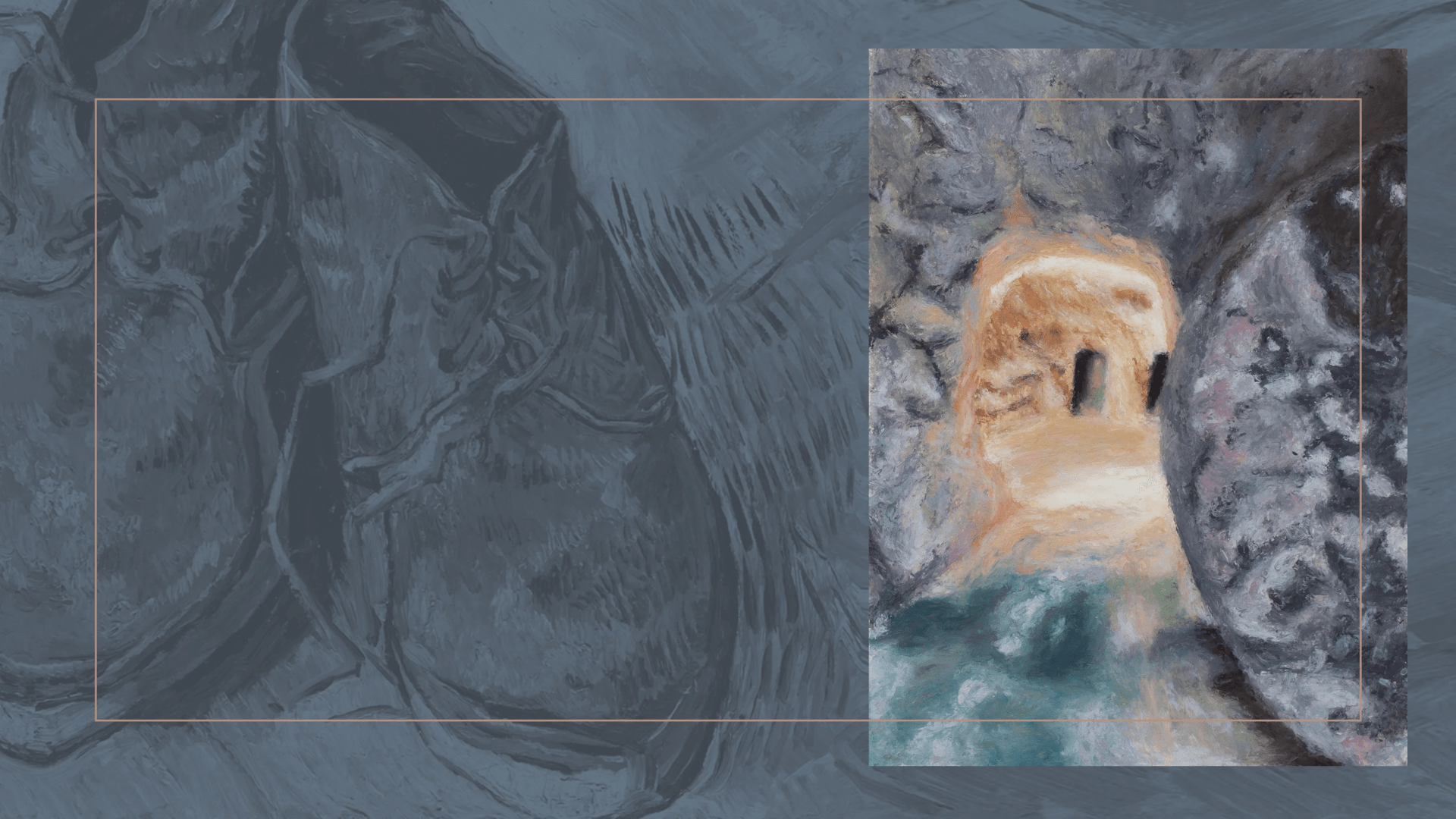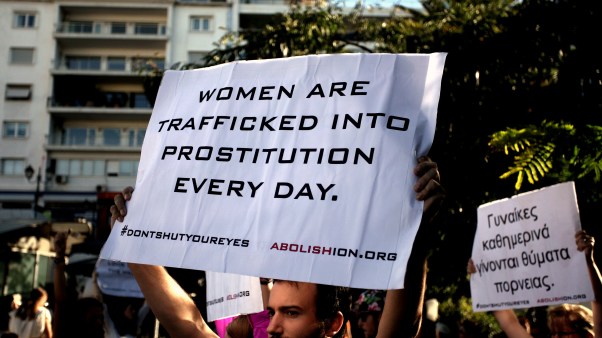Le mari d’une amie de notre Église, dans la cinquantaine, est décédé de manière inattendue pendant la pandémie. Elle n’a pas été autorisée à être à son chevet lorsqu’il est décédé à l’hôpital, et elle n’a pas pu lui organiser de véritables funérailles. Elle est retournée seule dans la maison vide qu’ils venaient d’acheter. Les cartons de déménagement étaient encore fermés. La chaleur et la promesse d’un foyer confortable en prévision de la retraite avaient été brutalement remplacées par le froid de la tombe.
Le foyer est plus qu’un emplacement physique : il nous offre un ancrage stable, souvent partagé avec ceux que nous aimons. Jésus, sachant sa mort proche, promet à ses disciples qu’il les précède pour leur préparer une place dans la maison de son Père (Jean 14.2-4). Pourquoi, me suis-je souvent demandé, promet-il cela en particulier ?
Une réponse est peut-être que cette promesse fait ressortir un thème important pour ses disciples, dont l’identité était marquée par les réalités de l’exil et de la vie en territoire étranger. Les disciples n’étaient peut-être pas des vagabonds dans le désert comme leurs ancêtres, mais ils avaient tout quitté pour suivre celui qui n’avait pas d’endroit où poser sa tête. La promesse d’une demeure éternelle a dû résonner profondément en eux.
En tant que disciples de Jésus, cette promesse résonne aussi en nous. Pendant le carême, et tout au long de l’année, nous aspirons aussi, de multiples façons, au passage miraculeux du désert à la sécurité, de l’exil à la maison, de l’étranger à notre chez nous.
Le calendrier liturgique est l’une des façons dont l’Église a exprimé ce désir. Au fil des siècles, la tradition chrétienne a judicieusement associé le carême au désert, symbole de l’exil. Ainsi, la prière introductive du premier dimanche de Carême dans le Livre de la prière commune se concentre sur les tentations du Christ dans le désert, et les lectures quotidiennes des offices de cette période sont saturées de passages de l’Exode, du Deutéronome, de Jérémie et de la dernière moitié de la Genèse, soulignant la longue histoire d’exil et de déracinement des Israélites. En cette saison, les Églises du monde entier méditent sur ce que signifie cheminer pas à pas vers la maison.
Dans ma propre vie, la nostalgie du foyer a été imprimée en moi dès la naissance. Ma mère a immigré aux États-Unis depuis la Corée du Sud avec mon père dans les années 1980, en emportant seulement ce qui pouvait entrer dans sa valise. Elle a tout laissé derrière elle — ses parents, ses aspirations personnelles, la capacité de communiquer, tout ce qui lui était familier — pour en arriver à passer la plupart de ses journées seule dans un petit appartement, perdant l’espoir et des touffes de cheveux à cause d’une dépression très invalidante. Je suis née peu de temps après. Chaque année, le jour de mon anniversaire, lorsque je mange du miyeok-guk (soupe aux algues) en l’honneur de ma mère, comme le font les Coréens depuis des siècles, je médite sur la façon dont ce goût évoque pour moi les larmes.
De l’autre côté, la famille de mon mari vit depuis plus de cent ans sur la même ferme de trois mille hectares dans une région reculée de l’Oklahoma. Dans la maison construite par les grands-parents de mon mari, les édredons cousus par les mains des arrière-arrière-arrière-grands-mères, assemblés à partir de vieilles robes et de chemises de travail, réchauffent doucement nos enfants endormis la nuit, sixième et précieuse nouvelle génération.
Cependant, mon mari, nos enfants et moi vivons dans le Michigan et ne nous rendons à la ferme qu’une fois par an, au mieux. Il est déchirant de réaliser que nous pourrions être les dernières générations à avoir des souvenirs de cet endroit. Même là, où la permanence semblait autrefois si sûre, la crainte de la perte du foyer nous atteint.
Je crois que chacun d’entre nous, à sa manière, sait ce que signifie la perte du sentiment d’appartenance et la nostalgie d’un temps et d’un lieu où nous étions en sécurité. Parfois, nos maisons nous sont enlevées physiquement, comme lorsqu’un ouragan dévaste notre jardin, que la guerre frappe à notre porte ou qu’un voleur entre par effraction. Parfois, même assis dans notre propre salon, nous pouvons éprouver des pertes dévastatrices, comme lorsque la violence menace notre sécurité, qu’un membre de la famille décède ou qu’un fossé se creuse entre nous et un être cher. Même nos foyers spirituels — nos Églises, nos groupes de maison et nos ministères — peuvent nous être enlevés et nous laisser seuls et abandonnés. Même si nous échappons parfois longtemps à de telles pertes, la réalité est que, de ce côté-ci du ciel, nous sommes de toute façon tous des exilés face à la mort. À la fin, nous devrons tous quitter notre maison terrestre.
 Vincent Van Gogh/Wikimedia Commons
Vincent Van Gogh/Wikimedia CommonsSi la mort est l’exil ultime, Pâques est l’ultime promesse de retour au pays. Car s’il est vrai que nous sommes un peuple habitué au mal du pays, nous sommes aussi un peuple avec lequel Dieu habite. Tout comme les Israélites errants avaient la présence de Dieu pour les accompagner, nous avons aussi un Sauveur ressuscité qui nous dit : « Je serai toujours avec vous. »
Récemment, mon amie privée de son mari a commencé quelque chose qu’elle appelle la « manne du lundi ». Du plus profond de son chagrin, elle parvient à préparer une marmite de soupe, à faire cuire une miche de pain et à inviter des amis chaque semaine en signe de gratitude. Tandis qu’elle lit et prie, son visage rayonne au-dessus des pages de sa bible usée. Ce sourire émerge des cendres. Manger à sa table, c’est entrevoir un temps où la mort, les larmes et l’exil ne seront plus. Aujourd’hui encore, la pierre roule peu à peu et l’ange plane au-dessus de nos tombeaux.
Les ancêtres pionniers de la famille de mon mari amarrèrent leur horloge au chariot et partirent à la recherche de quelque chose de mieux, tout comme mes propres parents. Ils avaient soif du lait et du miel promis au-delà du sable du désert, et ils ont tout enduré d’un cœur résolu. À présent, la sixième génération revient en visite, courant à travers la prairie et faisant peur aux sauterelles, et une pluie de fin d’été fait reverdir les champs pour encore un autre jour. Entre-temps, mes parents — couple d’immigrants solitaire — ont trouvé une Église où ils ont engagé leur vie pour le Christ aux côtés d’amis qui sont devenus comme une famille. En joignant leur vie à celle de Jésus, ils sont devenus le moyen par lequel beaucoup d’autres ont intégré la famille du Christ au fil des ans — y compris moi. L’histoire continue.
Aucun œil n’a vu et aucune oreille n’a entendu, mais je devine que notre foyer pascal auprès de Jésus aura le goût d’un bol de la soupe de ma mère et offrira la douce sensation d’un vieil édredon serré autour de soi. Ce sera comme si nous retrouvions nos chers grands-pères aux yeux fatigués, debout devant la charrue, se tournant vers nous pour nous embrasser. Ce sera comme s’asseoir autour d’une table et rire avec des gens qu’on aime. Comme voir un sourire s’épanouir sur le visage de la veuve. Ce sera comme rentrer à la maison.
« Heureux ceux qui trouvent leur force en toi : ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés », chantent les fils de Koré dans le psaume 84. « Lorsqu’ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. » Pâques réaffirme que notre désir de rentrer chez nous n’est pas vain et sans objet. Dans nos cœurs sont pavées les routes de la maison du Père. Comme les Israélites, comme les disciples, comme tous ceux qui nous ont précédés, il nous faut simplement continuer à marcher. Et en marchant, nous découvrons que le Christ, qui marche à nos côtés, fait en sorte que nos pas arrosent la terre.
Sarah Kyougah White est rédactrice en chef pour le Mouvement de Lausanne. Elle vit à Grand Rapids, dans le Michigan, avec sa famille.
Cet article fait partie de notre série « À l’aube d’une vie nouvelle » qui vous propose des articles et des réflexions bibliques sur la signification de la mort et de la résurrection de Jésus pour aujourd’hui.